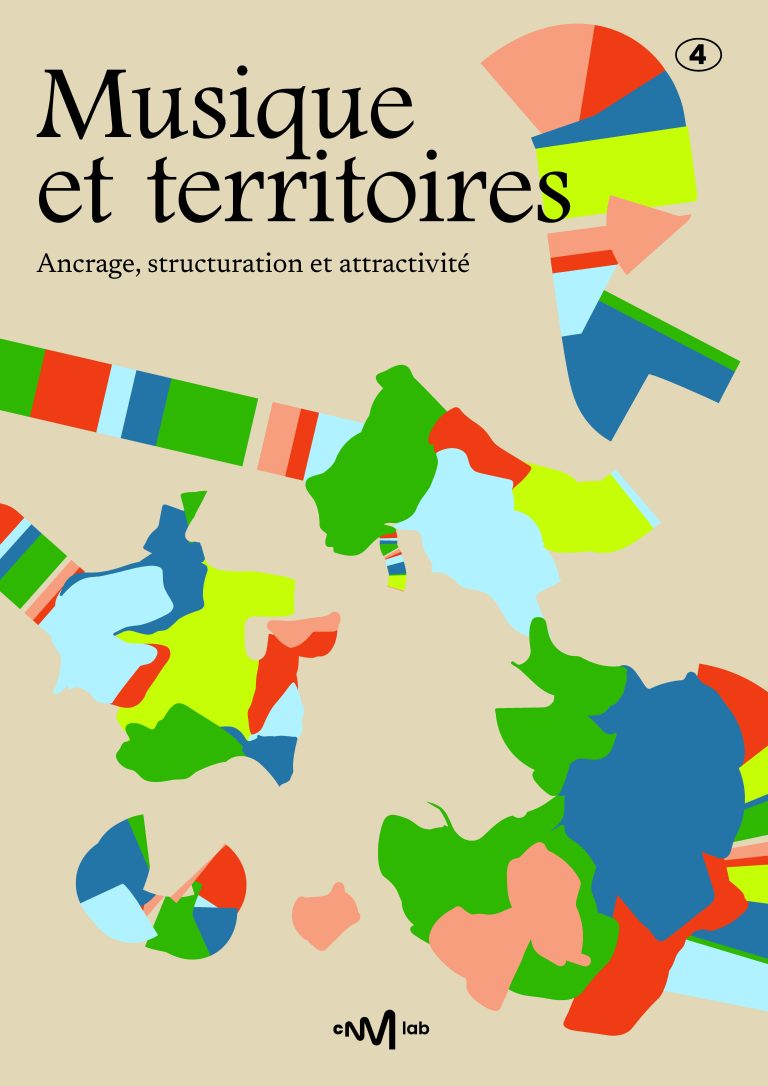Perspectives sur la structuration de la musique en Guadeloupe
De la scène à l'écosystème
Introduction
Et si l’écosystème musical guadeloupéen se racontait en fiction ? C’est le pari réussi du réalisateur guadeloupéen Julien Dalle, qui a fait de cet écosystème le fil conducteur de sa série télévisée WISH, acronyme de West Indies Studios History[1]. En prenant pour cadre le studio d’enregistrement du producteur et musicien Henri Debs[2], lieu mythique de la production musicale antillaise, la série télévisée WISH rend compte des dynamiques et des fragilités qui traversent l’écosystème de la musique en Guadeloupe. Par un jeu de miroirs, la fiction rejoint la réalité et éclaire les enjeux économiques et de structuration d’une filière musicale à la fois vibrante et fragile. Elle évoque les difficultés à maintenir en activité des structures de production, ainsi que la précarité professionnelle à laquelle sont confrontés les artistes. Cette mise en abyme éclaire ainsi un enjeu central : comment assurer la pérennité d’une scène musicale riche de son histoire et de sa créativité tout en surmontant les contraintes qui limitent sa structuration et son développement ?
En dépassant le simple cadre du divertissement, la série WISH se présente comme un manifeste de résilience. Elle montre comment les acteurs et actrices de cet écosystème continuent malgré les obstacles à créer, à collaborer et à diffuser leur musique, parfois au prix de sacrifices considérables. Cette capacité à persévérer face à l’adversité constitue une force indéniable. Mais reconnaître cette force ne doit pas masquer l’appel qui est lancé en faveur de la construction d’un écosystème viable et durable, capable de garantir aux artistes des conditions de création et de diffusion qui dépassent les seules logiques de survie.
En écho au récit de la série WISH et à ce qu’il révèle de la filière musicale, le présent article se propose d’explorer les possibles voies de structuration de l’écosystème musical guadeloupéen, en s’appuyant sur des données quantitatives et des entretiens[3]. Dans cette perspective, la première partie de cet article examinera le dynamisme et les enjeux de la scène musicale guadeloupéenne. La deuxième partie soulignera les singularités de cet écosystème. Enfin, la troisième partie mettra en lumière les pistes évoquées par les acteurs pour structurer cet écosystème musical, renforcer la professionnalisation des artistes et accompagner le développement d’une économie musicale solide et pérenne.
La scène musicale guadeloupéenne : dynamisme et enjeux
Un paysage musical en mutation et en expansion
Selon les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publiées en 2021[4], trois quarts des Guadeloupéennes et Guadeloupéens écoutent de la musique quotidiennement. Cette pratique s’ancre dans une grande diversité de styles, marquée par une forte présence des musiques caribéennes (zouk, soca, musiques haïtiennes). Chez les jeunes, ce sont les genres dits urbains – trap, rap, dancehall – qui dominent, aux côtés des musiques antillaises émergentes comme le shatta martiniquais ou le bouyon[5], originaire de la Dominique.
À cette pratique d’écoute quotidienne importante s’ajoute une créativité musicale foisonnante. La scène musicale guadeloupéenne se distingue en effet par sa vitalité artistique, portée par un public fidèle et des artistes qui créent pour leur territoire. Cette dynamique trouve ses racines dans les années 1980. C’est à cette période que la Guadeloupe s’est affirmée comme un foyer de création musicale. Cette articulation entre musique et territoire s’inscrivait alors dans le contexte de l’émergence du zouk.
Le succès du zouk fut dans un premier temps un succès organique porté par les artistes et un public antillais conquis par cette musique. Le zouk s’est en effet hissé en tête des ventes de disques en France avant de connaître une large diffusion à travers le monde. Cette véritable « zouk mania » a conduit le groupe emblématique Kassav’ à se produire sur les plus grandes scènes internationales, notamment dans la Caraïbe, en France et en Afrique. Le zouk s’est ainsi enraciné dans l’imaginaire musical des diasporas afro-caribéennes et antillaises, tout en séduisant la jeunesse ouest-africaine. Aujourd’hui, des artistes comme Burna Boy intègrent des éléments zouk dans leurs productions, mettant en évidence l’influence durable et toujours actuelle des musiques antillaises sur la sono mondiale.
En Guadeloupe, cette vitalité artistique se manifeste à travers différents exemples. Parmi eux figure le succès du titre « God Bless » de l’artiste guadeloupéen Krys, un titre qui a dépassé le million d’écoutes dans le mois suivant sa sortie en 2024 – chiffre particulièrement notable au regard de la population de l’île, estimée à un peu moins de 400 000 habitantes et habitants. Ce morceau a aussi touché la société dans son ensemble. Son refrain, largement repris sur les réseaux sociaux, a été utilisé en Guadeloupe dans une campagne publicitaire de l’opérateur Orange, ce qui illustre la manière dont les musiques guadeloupéennes participent à la construction des imaginaires collectifs, et contribuent à l’affirmation d’un sentiment d’appartenance territoriale.
De son côté, le compositeur, producteur et chanteur guadeloupéen 1T1, figure émergente de la nouvelle génération du bouyon, connaît une ascension remarquable. Son titre « Bouwey », en collaboration avec le chanteur guadeloupéen Theomaa, cumule aujourd’hui onze millions de vues sur YouTube, ainsi que plusieurs millions d’écoutes sur les plateformes de streaming. Le morceau est apparu comme un véritable phénomène transcaribéen, atteignant les premières places des classements dans la Caraïbe et au Nigeria. Ce succès, en Guadeloupe et au-delà des frontières insulaires, témoigne de la capacité des artistes à affirmer une identité musicale ancrée dans leur territoire tout en s’inscrivant dans des réseaux musicaux globalisés. Il met également en évidence l’existence d’un public international sensible aux esthétiques caribéennes et à l’expressivité de la langue créole.
Ainsi, l’écosystème de la musique en Guadeloupe connaît ces dernières années une dynamique positive. Les artistes guadeloupéens multiplient les projets, explorent de nouveaux styles et bénéficient d’une visibilité sur le territoire grâce aux médias traditionnels, en particulier les radios et télévisions locales, qui restent des relais essentiels pour toucher le public guadeloupéen. Parallèlement, le paysage musical se transforme sous l’effet des nouvelles technologies. Les réseaux sociaux et les plateformes numériques offrent une visibilité inédite permettant aux créations de circuler rapidement à l’échelle mondiale. Dans ce mouvement, cet écosystème commence aussi à se doter de ses propres médias spécialisés dans la mise en valeur des scènes musicales guadeloupéennes.
Parmi eux, le média Loxymore, créé en 2014 par Emmanuel Foucan alias Shorty, a joué un rôle important dans la visibilité et la diffusion des cultures urbaines caribéennes – rap, trap, dancehall, bouyon… Sa ligne éditoriale met en lumière aussi bien la nouvelle génération d’artistes que des figures confirmées. Aujourd’hui, Loxymore rassemble une large communauté, avec 25 000 abonnées et abonnés sur Instagram et 35 000 sur YouTube, où la vidéo la plus populaire dépasse le million de vues. Ce média propose une diversité de formats et des contenus de qualité : interviews d’artistes et d’acteurs culturels, sessions live « One Shot » en partenariat avec le Debs Music Studio, ou encore reportages pour les réseaux sociaux sur les festivals et concerts. En offrant une visibilité précieuse aux artistes et à leurs créations, Loxymore facilite la diffusion de la musique guadeloupéenne et caribéenne tout en rassemblant un public passionné.
Le média Karata, créé par Yannick Maillard en novembre 2022, représente une autre initiative majeure. Entièrement consacré à la musique des groupes de carnaval appelés groupes a po, ce média numérique s’est développé ces dernières années pour devenir une plateforme de référence dans la documentation et la valorisation des sorties carnavalesques. Aujourd’hui, Karata compte 61 000 abonnés sur Instagram, 46 000 sur YouTube et plus de 17 millions de vues pour ses vidéos. L’émergence de médias comme Loxymore et Karata, qui connaissent parfaitement les acteurs et les esthétiques locales, a considérablement enrichi la filière musicale guadeloupéenne. Ces nouveaux outils de visibilité et de promotion des musiques actuelles et traditionnelles guadeloupéennes renforcent non seulement leur reconnaissance artistique, mais aussi la légitimité culturelle de cette scène musicale dynamique.
Vitalité musicale et reconnaissance paradoxale
Cependant, la vitalité de la scène musicale guadeloupéenne et la reconnaissance qu’elle connaît au-delà des frontières insulaires ne suffisent pas encore à installer durablement les musiques guadeloupéennes dans l’espace culturel national. La présence de ces musiques dans les médias hexagonaux demeure rare, et leur participation aux grands festivals est encore limitée. Lorsqu’elles parviennent à se frayer un chemin jusqu’aux ondes, c’est le plus souvent grâce à des médias dits communautaires, destinés à un public ciblé, sans véritable relais au sein des réseaux radiophoniques nationaux. Ainsi, la légitimation culturelle acquise sur le territoire guadeloupéen ne se traduit pas encore pleinement à l’échelle nationale.
Par ailleurs, lorsque les musiques guadeloupéennes parviennent à obtenir une certaine reconnaissance dans l’Hexagone et à l’international, ces musiques tendent paradoxalement à se détacher de leur ancrage territorial. Leur lien explicite avec la Guadeloupe s’efface au point que certaines créations sont perçues comme des objets culturels exotiques « hors-sol », déconnectés de leurs racines historiques et de leur dimension politique. Ce processus de déterritorialisation conduit à une valorisation décontextualisée : ces musiques peuvent alors être réduites à une image festive, légère, voire exotique, et ainsi vidées de leur substance critique. Le paradoxe est d’autant plus frappant que ces musiques circulent et nourrissent les scènes musicales africaines, caribéennes et européennes. De nombreux artistes issus des musiques populaires et/ou urbaines – à l’instar d’Aya Nakamura – puisent dans le répertoire antillais sans que cela s’accompagne d’une reconnaissance équivalente pour les musiques antillaises elles-mêmes.
De nombreux artistes et acteurs culturels antillais dénoncent ces mécanismes qui tendent à valoriser les codes esthétiques issus de leur culture tout en invisibilisant celles et ceux qui les portent et les incarnent. Ce constat est ressorti avec force lors d’une table ronde intitulée « Nos musiques, leur succès : rayonnement, marché… et effacement ? » organisée pour la Fête de la musique 2025 par l’association Français à part entière. Les artistes, professionnelles, professionnels et chercheurs, chercheuses[6] réunis à cette occasion ont débattu de la sous-représentation médiatique des musiques antillaises, dont le succès international contraste avec leur relative invisibilité au sein des radios et grands médias nationaux. Les discussions ont souligné le paradoxe de musiques capables de mobiliser des publics à l’échelle planétaire mais néanmoins cantonnées aux marges des programmations hexagonales. La diffusion sur les réseaux sociaux d’extraits de cette rencontre, largement visionnés et partagés, témoigne de l’écho rencontré par ces réflexions dans l’espace public, et de leur inscription dans un débat plus large sur la place des cultures antillaises dans la société française.
Ainsi, la reconnaissance numérique et internationale des musiques guadeloupéennes ne s’accompagne pas systématiquement d’une même reconnaissance en France hexagonale. Cette situation révèle un décalage entre la visibilité en ligne et la légitimité culturelle, qui suppose une inscription durable au sein des espaces médiatiques et institutionnels. Un discours récurrent tend à passer sous silence ce décalage, en présentant le succès des artistes sur les réseaux sociaux comme preuve de leur légitimité. La forte visibilité en ligne viendrait compenser l’absence de reconnaissance institutionnelle et médiatique. Pourtant, ces deux dimensions relèvent de logiques distinctes : la viralité numérique ne garantit ni une inscription durable dans l’espace culturel national, ni une véritable valorisation de celles et ceux qui portent ces musiques.
La reconnaissance numérique et internationale des musiques guadeloupéennes ne s’accompagne pas systématiquement d’une même reconnaissance en France hexagonale
Ce paradoxe invite à un retour réflexif sur le territoire afin de mieux appréhender les singularités de l’écosystème musical guadeloupéen, où l’effervescence artistique coexiste avec une filière musicale fragile. La mise en lumière de ces spécificités pourrait en effet permettre d’orienter plus efficacement les stratégies de développement et de reconnaissance des musiques guadeloupéennes.
Singularités de l’écosystème musical guadeloupéen
Musique et territoire
Depuis la création du ministère de la Culture, le soutien de l’État au secteur du spectacle vivant représente l’un des piliers historiques de la politique culturelle française. Aujourd’hui, cette politique s’appuie principalement sur des opérateurs nationaux, un réseau de lieux labellisés et des circuits de diffusion bien identifiés. Cependant, en Guadeloupe, l’organisation du spectacle vivant obéit à des logiques distinctes de celles qui prévalent dans la plupart des régions hexagonales. Le territoire ne compte qu’une seule scène labellisée « Scène nationale » par le ministère de la Culture, et aucun dispositif équivalent aux SMAC (Scènes de musiques actuelles) n’y est implanté. Ainsi, les indicateurs habituellement mobilisés pour observer et quantifier le spectacle vivant – centrés sur des critères standardisés tels que la fréquentation des lieux subventionnés, les budgets alloués ou la présence de structures labellisées – ne permettent pas de saisir les spécificités de l’écosystème musical guadeloupéen.
En Guadeloupe, l’histoire du spectacle vivant et de la diffusion musicale s’inscrit avant tout dans une trajectoire postcoloniale marquée par des conditions d’accès inégales aux espaces et aux ressources culturelles. Les pratiques musicales ont longtemps reposé sur des formes d’auto-organisation et sur l’occupation de l’espace public comme principal lieu d’expression. Aujourd’hui encore, cette mémoire structure les pratiques : l’espace public reste un lieu majeur de diffusion musicale, un espace investi par les artistes et les acteurs comme territoire d’expression culturelle, de transmission et de sociabilité.
Héritées de la période coloniale, les musiques traditionnelles occupent une place centrale dans l’écosystème musical guadeloupéen. Ces musiques de transmission orale s’inscrivent dans des pratiques sociales et entretiennent le plus souvent un lien organique avec la danse et/ou la performance (quadrille, gwoka, musiques de carnaval, etc.).
Ainsi, trois temps culturels forts structurent l’année. De janvier au mercredi des Cendres, le carnaval investit les rues par ses formes mobiles et participatives. Organisé par un réseau d’associations en partenariat avec les communes, il repose principalement sur le financement associatif (cotisations, subventions). En son sein, les groupes ou mas a po[7] constituent des mouvements culturels (mouvman kiltirel) à part, qui transforment tous les dimanches l’espace public en une scène à ciel ouvert où se croisent artistes, amateurs et amatrices, musiciennes et musiciens confirmés, spectateurs et spectatrices, passantes et passants. Après le carême vient, ensuite, la saison des swaré léwòz, des soirées nocturnes ouvertes à tous et toutes, dédiées à la danse traditionnelle gwoka et aux tambours ka, qui sont organisées par des associations culturelles sur des places publiques, dans des cours d’école ou des terrains de sport. Enfin, entre la Toussaint et les fêtes de Noël s’ouvre la saison des chanté Nwèl (chants de Noël), des concerts gratuits dédiés à l’interprétation des cantiques de Noël créolisés et des rythmes traditionnels tels que le gwoka, la biguine, la mazurka, les valses créoles ou encore le zouk. À ces rendez-vous réguliers s’ajoutent les kout tanbou (« coup de tambour », en langue créole), des performances informelles fréquentes et nombreuses autour des tambours ka, qui prennent la forme d’un moment de partage spontané. L’un des plus emblématiques a lieu à Pointe-à-Pitre chaque samedi matin à proximité de la place du marché, et est devenu une véritable institution.
Ces événements sont rassembleurs, et les données de l’Insee révèlent l’importance de ces traditions musicales dans la vie quotidienne des habitants : en 2019-2020, 24 % de la population guadeloupéenne ont participé au carnaval, et 46 % aux chanté Nwèl[8]. Les mas a po, qui requièrent un véritable engagement (les répétitions commencent en novembre, ce qui nourrit une vie musicale dense pendant plusieurs mois[9]), se répartissent sur l’ensemble du territoire : toutes les communes en possèdent, même dans des proportions modestes, au moins un. De fait, ces expressions emblématiques ont une dimension sociale forte : les swaré léwòz constituent par exemple, bien plus qu’un moment de performance musicale, un espace de convivialité, de transmission et de revendication culturelle, souvent en marge des logiques marchandes. Plusieurs de ces temps forts se caractérisent d’ailleurs par leur fonction subversive, les groupes a po étant aussi des espaces de contestation, de résistance culturelle et politique – par le choix des chants, la force des paroles et le jeu des tambours[10].
Ces différentes formes de pratiques musicales, bien que centrales dans la vie sociale et culturelle guadeloupéenne, ne donnent lieu que partiellement à des rémunérations artistiques. Elles sont dans leur très grande majorité le fait de musiciens amateurs. Ainsi, les membres des groupes de carnaval – musiciens comme carnavalières et carnavaliers – ne sont généralement pas rémunérés pour leurs performances malgré le temps, l’énergie et les ressources investis dans leur préparation. Lors des swaré léwòz, l’association organisatrice perçoit une rémunération. Celle-ci sert à la fois à couvrir les frais logistiques liés à l’organisation de l’événement et à défrayer les musiciens. En revanche, les danseurs et danseuses qui participent à la ronde le font sur une base volontaire, sans contrepartie financière. Quant aux musiciens du kout tanbou de Pointe-à-Pitre, par exemple, ils sont rémunérés par une quête, perpétuant ainsi une logique d’autogestion et de solidarité, en dehors des cadres institutionnels.
Toutes ces pratiques se retrouvent sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, le lien entre ces musiques traditionnelles et le territoire est profondément politique. Avec ces musiques, les Guadeloupéens ont conquis l’espace public en affirmant leur culture, leur histoire et leur identité. Aujourd’hui, l’espace public porte la mémoire de ces luttes : une mémoire dans laquelle la musique incarne, prolonge et honore les combats du passé.
Porosité entre esthétiques musicales
Dans l’écosystème musical guadeloupéen, les frontières entre les esthétiques ne sont pas étanches et une véritable porosité existe entre musiques traditionnelles et musiques actuelles ou urbaines. En effet, nombreux sont les artistes qui naviguent librement entre ces univers musicaux. Même si les genres diffèrent, les pratiques, les réseaux d’acteurs et les dynamiques sociales restent étroitement liés.
Le compositeur, producteur et chanteur guadeloupéen 1T1 évoqué plus haut en est un exemple. Le clip de son titre phare « Bouwey », qui est devenu viral sur les plateformes de streaming, TikTok et les réseaux sociaux, a été tourné avec son groupe de carnaval dénommé Le Point d’interrogation à l’occasion d’une sortie carnavalesque. Le jour du tournage, le groupe a po avait pour thème « la vie chère », ce qui explique la présence dans le clip de drapeaux nationalistes, de pancartes dénonçant la hausse du coût de la vie et de personnes au visage peint aux couleurs de la Guadeloupe. Ce contexte n’était pas une mise en scène, mais l’expression spontanée et subversive du carnaval. Ainsi, l’œuvre musicale de l’artiste 1T1 reflète plus généralement l’ancrage des jeunes artistes dans les pratiques culturelles traditionnelles, et montre comment ces pratiques nourrissent la création musicale.
Le parcours de l’auteur-compositeur-interprète de reggae-dancehall WeRe-VaNa offre un autre exemple de continuité entre musiques traditionnelles et musiques urbaines. Artiste solidement implanté dans le paysage des musiques caribéennes actuelles, WeRe-VaNa est originaire de la région boisée des Grands Fonds, sur la Grande-Terre en Guadeloupe, et issu de la famille Geoffroy, qui compte parmi les grandes voix du gwoka guadeloupéen. Cette lignée de chanteurs et de joueurs de tambour, mais aussi de lutteurs et de conteurs de veillées traditionnelles, lui a transmis l’héritage musical et les valeurs culturelles qui imprègnent son univers artistique. En 2020, il sort le titre « Casanova », aujourd’hui certifié single de diamant.
Sur scène, WeRe-VaNa aime commencer ses prestations par un chant traditionnel gwoka a cappella, avant de poursuivre avec son répertoire reggae-dancehall. Sa légitimité en tant qu’artiste, de même que celle de nombreux artistes comme 1T1, Lejuh ou encore Rachelle Allison, est ancrée dans cet héritage qui leur permet d’asseoir leur identité artistique.
Ainsi, l’une des singularités de l’écosystème musical guadeloupéen réside dans la porosité non seulement entre esthétiques musicales, mais aussi entre musique enregistrée et spectacle vivant, formant une filière musicale interconnectée où ces deux dimensions se croisent et s’enrichissent mutuellement.
Diffusion musicale : diversité des lieux et des acteurs
Si l’espace public constitue une scène incontournable de la vie musicale en Guadeloupe, cela n’exclut pas l’existence de salles de spectacle dédiées à la diffusion. Celles-ci ont pour les plus anciennes été construites dans les années 1980, tandis que les plus récentes datent de la période 2017-2019. Le développement de ces équipements s’est inscrit dans le contexte des politiques culturelles initiées par Jack Lang dans les années 1980, qui visaient à démocratiser l’accès à la culture et à soutenir la création artistique.
Aujourd’hui, le territoire compte seize salles de spectacle. On ne recense en Guadeloupe qu’une seule salle à gestion privée et commerciale : la salle Royal Riviera, au Gosier. Les quinze autres lieux de diffusion sont majoritairement soutenus par les collectivités publiques, principalement les communes, qui assurent la gestion de trois quarts de ces équipements. D’autres formes de gestion publique sont également présentes : le centre culturel de Sonis est administré par la communauté d’agglomération Cap Excellence, le Mémorial ACTe fonctionne sous le statut d’établissement public de coopération culturelle (EPCC) financé par la Région Guadeloupe, la société d’économie mixte de Beauport-Pays de la Canne adopte une gouvernance mixte, tandis que le centre social La Source à Petit-Canal relève de la Caisse d’allocations familiales. L’Artchipel – Scène nationale de la Guadeloupe – est la seule structure labellisée sur le territoire. Elle bénéficie d’un financement croisé du ministère de la Culture (via la direction des affaires culturelles [DAC] de la Guadeloupe) et du conseil départemental.
Ces structures de diffusion sont pour la plupart membres du Collectif des espaces de diffusion artistique et culturelle. Créé en 2007, le Cedac fonctionne comme un réseau visant à fédérer et développer des coopérations entre structures adhérentes. Il favorise la diffusion culturelle en mutualisant les moyens logistiques et les supports de communication, tout en apportant un soutien financier aux cachets artistiques. Le Cedac bénéficie du soutien de la Région Guadeloupe et de la DAC.
En 2019, le Cedac a mené un état des lieux du spectacle vivant en Guadeloupe. Dans le cadre de cette étude, il a rassemblé des données budgétaires globales sur les structures de diffusion du territoire[11]. Cette étude a également présenté les budgets consacrés à la diffusion artistique, notamment à l’achat de spectacles. Les grandes structures, comme L’Artchipel – Scène nationale de la Guadeloupe ou le centre culturel de Sonis, y consacrent une part significative de leur budget, généralement comprise entre 100 000 et 150 000 euros, tandis que des salles de taille plus modeste investissent des montants compris entre 10 000 et 50 000 euros. Certaines structures, comme La Rotonde à Saint-François ou la salle George-Tarer à Pointe-à-Pitre, n’ont en revanche procédé à aucun achat de spectacle au cours de l’année 2019.
Au-delà des différences budgétaires, l’étude menée par le Cedac met également en évidence des niveaux d’équipement très disparates et souvent inadaptés aux exigences techniques contemporaines. Selon ce collectif, ce constat invite au lancement d’une politique globale d’investissements afin de permettre une mise à niveau technologique des structures. Pour le Cedac, cette amélioration constitue une condition indispensable au développement d’une action artistique de qualité, équilibrée et accessible sur l’ensemble du territoire guadeloupéen.
Cependant, malgré l’existence de ces lieux de diffusion, peu de salles proposent une programmation musicale régulière sur l’ensemble de l’année, et la billetterie demeure une source de financement marginale. La faiblesse des recettes propres s’explique en grande partie par la taille des salles (les jauges des lieux de diffusion varient entre 150 et 500 places), par la rareté des représentations et par une fréquentation souvent limitée. Dans bien des cas, l’activité des lieux de diffusion repose davantage sur la location ou la mise à disposition des espaces à des structures extérieures (associations, écoles…) que sur une véritable politique de diffusion portée en propre.
Malgré l’existence de ces lieux de diffusion, peu de salles proposent une programmation musicale régulière sur l’ensemble de l’année, et la billetterie demeure une source de financement marginale.
Si ces constats révèlent une structuration encore fragile de la diffusion musicale en Guadeloupe – marquée par des écarts budgétaires importants, des équipements inadaptés et une absence de programmation pérenne –, il convient de souligner l’existence, en parallèle de ces salles de spectacle, d’un réseau dynamique d’environ 60 lieux privés qui participent à la diffusion musicale.
Bien que leur activité principale ne relève pas du spectacle vivant – il s’agit principalement de restaurants, bars, hôtels ou casinos –, ces établissements proposent ponctuellement, et parfois régulièrement, des animations musicales ou des concerts. Parmi eux, une vingtaine d’établissements se distinguent par une programmation artistique soutenue, constituant ainsi des relais importants pour la scène musicale locale[12]. Ces établissements offrent aux artistes des opportunités précieuses pour se produire en public. Ils participent ainsi pleinement à l’écosystème musical de la Guadeloupe.
Au-delà des salles de spectacle et des lieux privés, la diffusion musicale s’appuie également sur les collectivités, et notamment sur le conseil départemental de la Guadeloupe. Le conseil départemental joue en effet un rôle actif dans le développement culturel et musical du territoire, via un dispositif de subventions à destination des associations culturelles et à travers l’organisation de concerts, en veillant à proposer une diversité de styles musicaux : des musiques traditionnelles au jazz, jusqu’à l’opéra. L’organisation de ces concerts s’inscrit en partie dans la politique mémorielle du conseil départemental de la Guadeloupe. Celui-ci valorise le patrimoine historique en programmant des spectacles dans des lieux emblématiques tels que le fort Delgrès, le fort Fleur d’Épée ou d’anciennes habitations sucrières. Ces sites accueillent également des résidences d’artistes, à l’image du programme « Créations hybrides » qui adopte une approche pluridisciplinaire en croisant arts visuels, danse, théâtre et musique. Ces manifestations font vivre des monuments chargés d’histoire, créent un dialogue fécond entre mémoire, patrimoine et création artistique, et participent au dynamisme de l’écosystème musical local.
Tous les concerts proposés par le conseil départemental de la Guadeloupe sont gratuits, afin de rendre la culture et la musique accessibles au plus grand nombre. Cette gratuité s’inscrit dans une volonté de favoriser la participation de tous les publics et de soutenir la vitalité artistique locale. De même, les communes participent à l’animation musicale du territoire à travers l’organisation de concerts également gratuits, notamment dans le cadre des fêtes patronales, moments privilégiés de rencontre et de partage pour les habitants.
Des festivals existent dans l’écosystème musical guadeloupéen, portés par les collectivités, les associations ou encore des acteurs privés. La Région et le Département soutiennent notamment le Festival Terre de Blues de Marie-Galante, créé en 2000 et solidement ancré dans le paysage culturel, qui combine une forte dimension artistique et un impact économique local, ainsi que le Festival de Gwoka de Sainte-Anne, gratuit et sans billetterie, qui constitue un rendez-vous majeur pour la valorisation et la transmission du gwoka.
À côté de ces rendez-vous, de nouvelles initiatives associatives émergent, comme celle de l’association Guadeloupe Electronik Groove qui favorise la rencontre entre musiques électroniques et traditionnelles, mais peine encore à s’ancrer durablement. Enfin, des promoteurs privés organisent des festivals tels que le Karukera One Love Festival ou l’All Day In Music Festival, qui séduisent particulièrement un public jeune.
Ainsi, la diffusion musicale en Guadeloupe s’appuie sur une diversité de lieux et d’acteurs : espace public, salles de spectacle, établissements privés, lieux de mémoire et festivals. Par ailleurs, l’ensemble de ces initiatives dessine une offre musicale où la gratuité occupe une place importante, ce qui peut constituer un défi pour les acteurs privés.
Labels et défis numériques
L’une des spécificités du secteur de la musique enregistrée en Guadeloupe est sa concentration autour d’un petit nombre de labels. Step Out Productions, fondé par l’artiste Krys, est l’un des seuls à produire activement plusieurs artistes. D’autres structures participent également à l’émergence de nouveaux talents et à la mise en visibilité de la scène musicale locale. Bien que leur capacité de production et de diffusion demeure encore limitée, elles contribuent depuis quelques années à renouveler le paysage de la musique enregistrée, les plus anciennes ayant vu le jour en 2017.
Parmi les labels indépendants actifs en Guadeloupe, on peut citer Voodoo Studio (2023), AB BOYZ Studio (2022), Hakuna Music Company (2020), Karma Music (2020), Milcop Records (2020), IMANI Records (2017) et GHP Music (2017). La filière musicale locale comprend également des beatmakers reconnus, tels que Magistral Beats ou Mister Francky. Par ailleurs, ThLab Records & Publishing se distingue comme maison d’édition engagée dans la valorisation et la diffusion des créations musicales caribéennes.
Cette nouvelle génération d’artistes maîtrise les nouvelles technologies, qui modifient autant les modes de création et de production musicale que la manière de diffuser et d’avoir accès aux œuvres ainsi produites. Désormais, une fois son morceau abouti, l’artiste le rend disponible à ses auditeurs et auditrices sur les réseaux sociaux et les plateformes de distribution en ligne. Il en résulte un rythme et un format de production et de promotion qui s’adaptent aux nouveaux usages d’Internet. Ainsi, la publication régulière de nouveaux titres tend à se substituer au format traditionnel de l’album.
La transition vers le numérique et la structuration d’une offre d’écoute en ligne se sont cependant heurtées à un contexte particulier : l’arrivée tardive des grandes plateformes de streaming musical sur le territoire. À titre d’exemple, Spotify n’a ouvert officiellement son service en Guadeloupe qu’en 2021. Cette implantation récente explique en partie pourquoi l’écoute en streaming n’est pas encore intégrée dans les habitudes d’écoute du public guadeloupéen. Les artistes présents sur Internet bénéficient donc d’une diffusion supplémentaire, mais celle-ci reste peu rémunératrice, en raison du faible volume d’écoutes locales et du modèle économique propre aux plateformes de streaming.
Dans ce contexte, le marché musical local se structure autour de plusieurs segments :
- Les artistes à forte présence sur les canaux traditionnels (radios commerciales – notamment NRJ Antilles, Trace – ou chaînes de télévision), qui parviennent à monétiser la diffusion de leurs œuvres et à construire un lien direct avec le public guadeloupéen et plus largement antillais.
- Les artistes orientés vers le numérique, qui diffusent leurs œuvres sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Ce groupe recoupe en partie le précédent : certains artistes combinent ainsi forte visibilité dans les médias traditionnels et diffusion en ligne, même si cette dernière génère encore peu de revenus. D’autres artistes ne sont présents que sur le numérique. Ils diffusent leurs œuvres exclusivement en ligne, via des plateformes comme Bandcamp ou SoundCloud. Cette présence numérique rend leurs créations accessibles. Toutefois, elles touchent surtout un public de connaisseurs et connaisseuses, ou les abonnés qui les suivent déjà sur les réseaux sociaux. Dans la majorité des cas, cette diffusion génère peu, voire pas du tout, de revenus.
- Les artistes de niches musicales, souvent orientés vers le live – la musique classique ou lyrique, les musiques électroniques, le jazz, ou certaines musiques de fusion entre différentes esthétiques caribéennes –, qui se produisent principalement en concert ou dans des lieux culturels, mais dont la diffusion sur les canaux traditionnels et les plateformes de streaming est quasi inexistante.
Après avoir examiné les singularités de l’écosystème musical guadeloupéen – rôle central des musiques traditionnelles dans le paysage culturel, diffusion musicale organisée à travers une diversité de lieux publics, privés et de mémoire, secteur de la musique enregistrée qui s’appuie sur un réseau encore fragile de labels indépendants –, il convient à présent de mettre en lumière les leviers capables de soutenir durablement la professionnalisation des artistes et d’accompagner le développement d’une économie musicale pérenne.
Perspectives de structuration de la filière musicale en Guadeloupe
Création et diffusion de spectacles musicaux
Les écoles de gwoka nourrissent activement la création artistique. Elles proposent des spectacles payants qui prennent la forme de véritables fresques historiques mêlant musique, danse et narration. Ces spectacles s’inscrivent dans une dynamique de professionnalisation.
Le témoignage de la danseuse et chorégraphe émérite Raymonde Pater Torin, diffusé en juin 2025 via une vidéo sur Facebook à l’issue d’un spectacle de l’Akadémiduka – école de gwoka fondée en 1985 par le tanbouyé (joueur de tambour) Yves Thôle et la danseuse Jacqueline Cachemire –, illustre les difficultés rencontrées par les associations culturelles et les artistes dans leur travail de création.
Présenté au hall des sports Paul-Chonchon de Pointe-à-Pitre, le spectacle de l’Akadémiduka s’est déroulé dans une infrastructure inadaptée à la création et à la diffusion artistiques : le spectacle a nécessité l’installation temporaire de scène, plancher et matériel technique, mobilisant des moyens humains et logistiques importants. Cet événement, organisé conjointement par deux associations – l’Akadémiduka, réunissant 450 participants, et l’association culturelle Kamodjaka, rassemblant 300 participants –, a ainsi fédéré près de 750 personnes autour d’un même projet. À l’issue de la représentation, ce sont les adhérentes et adhérents des deux associations et les artistes qui ont assuré le démontage, le nettoyage et le transport du matériel. Cette situation met en évidence la charge de travail invisible et les conditions de précarité qui pèsent sur les artistes et leurs équipes.
Selon Raymonde Pater Torin, près de 22 000 euros ont été mobilisés uniquement pour la logistique (location de salle, de chapiteaux, d’un plancher, de matériel de régie son et lumière…). Dans sa vidéo Facebook, elle dénonce l’absence persistante de lieux adaptés à la création et à la diffusion en Guadeloupe, en particulier depuis la fermeture du Centre des arts en 2009. Elle y exprime aussi la fatigue d’une communauté artistique qui, en l’absence d’infrastructures pérennes, doit déployer des efforts considérables pour faire exister ses projets dans un cadre professionnel.
Cet exemple exprime avec force le besoin de lieux dédiés à la création capables de prendre en compte les singularités de l’écosystème local, où les pratiques traditionnelles occupent une place centrale. Au-delà de simples espaces de représentation, la question posée est celle de l’existence de salles équipées et adaptées aux exigences techniques contemporaines. L’hypothèse d’un lieu pluridisciplinaire, à la fois tourné vers la valorisation des musiques et danses traditionnelles et ouvert à l’innovation ainsi qu’aux musiques actuelles, apparaît comme une piste de réflexion pour répondre aux besoins exprimés par les acteurs.
S’appuyer sur les salles de spectacle existantes pourrait constituer un levier pour structurer la création et la diffusion musicales et chorégraphiques. Cela suppose toutefois une mise à niveau de leurs équipements afin de répondre aux exigences contemporaines, ainsi qu’un renforcement de leur visibilité. La réussite de cette démarche dépend également de la collaboration entre les acteurs locaux. Le Cedac, en tant que réseau des salles de spectacle de Guadeloupe, pourrait être un appui pour favoriser cette coordination.
La question de la production de spectacles se révèle également complexe. Aux côtés de créations portées par des associations, d’autres initiatives illustrent les difficultés rencontrées pour faire exister des projets artistiques dans des conditions professionnelles. Ainsi, l’école Urban Dance Center de Guadeloupe avait prévu de produire, en 2025, un spectacle pluridisciplinaire mêlant danse, musique et humour. Celui-ci devait rassembler non seulement les élèves et enseignantes et enseignants de l’école, mais aussi des artistes professionnels reconnus, tels que la chanteuse Shanika, le chanteur Admiral T, des DJ et plusieurs humoristes locaux.
Intitulé « Danse avec les étoiles », ce projet de grande ampleur était prévu au stade René-Serge-Nabajoth de la ville des Abymes, et avait pour objectif d’initier les jeunes danseurs aux réalités du spectacle vivant en conditions professionnelles. Une semaine avant l’événement, l’école Urban Dance Center a toutefois été contrainte d’annuler la représentation en raison d’un nombre insuffisant de billets vendus. Cette décision a été d’autant plus difficile pour les danseurs, leurs familles et les membres du projet qu’ils avaient travaillé pour répondre à des exigences artistiques et organisationnelles élevées.
Ainsi, organiser un événement musical ou produire un spectacle suppose pour les artistes et les structures locales de s’investir au-delà de leur cœur de métier : prendre en charge la logistique, trouver des solutions techniques et assumer des risques financiers. Cet exemple met en lumière un enjeu de l’écosystème musical guadeloupéen : une grande majorité de l’offre musicale étant gratuite, l’implantation d’une économie du billet payant reste difficile, et empêche les artistes et les structures locales de compter sur les recettes de billetterie pour sécuriser leurs projets.
Musique enregistrée
Le secteur de la musique enregistrée connaît une vitalité remarquable. Cette vitalité coexiste toutefois avec un tissu économique fragile. L’absence d’une économie structurée de la musique enregistrée s’explique en partie par l’implantation tardive des plateformes de streaming, près d’une décennie après la France hexagonale. Ce décalage contraste avec la dynamique mondiale de la musique enregistrée, caractérisée depuis 2010 par un développement continu et soutenu du streaming[13]. En conséquence, l’offre d’écoute en ligne légale et payante demeure encore peu développée en Guadeloupe, ce qui limite les perspectives de rémunération des artistes.
Par ailleurs, les acteurs attribuent également la fragilité économique du secteur de la musique enregistrée au manque de rentabilité de la production à l’échelle du territoire. En effet, le marché guadeloupéen ne permet pas à lui seul de couvrir les coûts de production des artistes locaux. Le chanteur et producteur Krys en a fait l’expérience en produisant l’album An silans de l’artiste Misié Sadik, sorti en 2018. À cette époque, Misié Sadik figurait parmi les artistes les plus écoutés et diffusés en Guadeloupe. Bien que significatives, les ventes ne suffirent pas à couvrir l’ensemble des frais de production, soulignant une difficulté majeure : même les projets les plus prometteurs sont souvent produits à perte.
Ce constat est également partagé par Riko Debs, fils du producteur emblématique Henri Debs. Confronté lui aussi à l’absence de rentabilité dans le secteur de la musique enregistrée, Riko Debs a finalement mis un terme à ses activités de producteur. Aujourd’hui, les studios Debs – autrefois cœur de la filière musicale guadeloupéenne – ne sont plus utilisés pour la production, mais exclusivement pour la location.
Ainsi, le modèle économique des labels doit s’adapter aux spécificités du territoire. Au-delà d’un marché local restreint, plusieurs défis doivent être relevés. Le premier concerne l’illusion d’une visibilité artistique accrue grâce au numérique. Si la musique guadeloupéenne est bien présente en ligne, les algorithmes de recommandation tendent à la maintenir dans un périmètre étroit et à favoriser la concentration sur quelques hits mondiaux. De ce fait, ces productions demeurent souvent cantonnées à leurs cercles habituels et peinent à toucher de nouveaux publics. Cette situation restreint leur rayonnement et montre que le numérique ne garantit pas, à lui seul, une expansion de l’audience. Il ne suffit pas d’accéder à un marché mondial : il est également nécessaire d’y être entendu.
D’ores et déjà, la mise en avant d’artistes et le placement de morceaux dans les playlists sur les plateformes de streaming constituent un facteur déterminant de succès. C’est souvent ce positionnement stratégique qui assure la visibilité d’un titre. Dans cette perspective, il pourrait être utile de favoriser des coopérations entre artistes, labels et distributeurs.
Pour les acteurs, un deuxième enjeu réside dans l’ouverture vers l’extérieur : l’exportation ne peut plus être considérée comme une simple opportunité, mais doit être vue comme une nécessité. Élargir les horizons de diffusion permettrait de soutenir les acteurs de la musique enregistrée, de renforcer la visibilité des artistes et de faire rayonner la scène musicale guadeloupéenne à l’échelle nationale.
Dans cette perspective, plusieurs pistes ont été proposées par les acteurs pour renforcer la visibilité des artistes guadeloupéens sur le territoire hexagonal. L’une d’elles consisterait à mettre en place un dispositif de soutien à la promotion nationale pour les artistes atteignant un certain seuil de performance. Ce mécanisme permettrait de transformer un succès organique en appui au développement professionnel des artistes. Des campagnes médiatiques, des actions ciblées sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux ainsi qu’un relais dans la presse spécialisée nationale pourraient contribuer à cet objectif.
Cette stratégie pourrait mobiliser des agences de communication hexagonales expérimentées familières des codes de l’industrie musicale et du marché français, qui resteraient dans le même temps attentives aux spécificités culturelles guadeloupéennes. C’est dans cette dynamique, alliant ancrage local et coopération avec le marché hexagonal, que l’industrie du disque en Guadeloupe pourrait poser les bases d’un avenir plus structuré, plus visible et plus durable. Car, comme le soulignent les acteurs du secteur, la coopération avec une agence de communication hexagonale semble déjà indispensable pour garantir une visibilité nationale efficace. L’enjeu n’est pas de se substituer aux agences locales, mais de bénéficier de l’expertise et du réseau d’agences au rayonnement plus large, pour renforcer l’impact des campagnes de communication et inscrire les artistes guadeloupéens dans une dynamique compétitive à l’échelle nationale.
Dans cette perspective d’exportation, une autre piste évoquée consiste à créer un fonds d’avance spécifiquement destiné à soutenir l’organisation de concerts dans l’Hexagone. Ce fonds aurait pour mission de couvrir en amont les frais liés à la location des salles et à la production des événements (transport, logistique, communication). Un tel apport initial est indispensable pour rendre possible l’organisation d’un concert ou d’une tournée dans l’Hexagone. Sans cette avance, de nombreux projets restent à l’état d’intention. En sécurisant cette phase de lancement, le fonds viendrait lever un frein aux possibilités de développement hors du territoire.
Plusieurs pistes ont été proposées par les acteurs pour renforcer la visibilité des artistes guadeloupéens sur le territoire hexagonal : […] mettre en place un dispositif de soutien à la promotion nationale pour les artistes atteignant un certain seuil de performance […] et créer un fonds d’avance […] pour rendre possible l’organisation d’un concert ou d’une tournée dans l’Hexagone.
La billetterie permettrait de rembourser le prêt consenti par le fonds d’avance, et de générer un bénéfice qui serait réinvesti dans de nouveaux projets. Elle offrirait ainsi aux artistes l’opportunité de se produire sur des scènes hexagonales pour répondre à la demande du public, qu’il s’agisse de la communauté antillaise ou d’un auditoire plus large, tout en réinjectant les retombées économiques dans le tissu musical local. Ce dispositif contribuerait à structurer une économie musicale guadeloupéenne tournée vers l’extérieur tout en consolidant une filière locale plus autonome et durable.
Formation
L’accès à la formation dans le secteur musical constitue un besoin systématiquement exprimé par les acteurs de la filière, tant dans le domaine du spectacle vivant que dans celui de la musique enregistrée.
Un programme de formations spécifique aux métiers du spectacle vivant pourrait contribuer à la professionnalisation globale du secteur. Ce programme viserait à consolider les compétences existantes et à favoriser l’émergence de nouvelles expertises. Conçu de manière mutualisée et en cohérence avec les conventions collectives régissant ces métiers, il permettrait également de renforcer la connaissance des cadres réglementaires et des exigences professionnelles, souvent encore insuffisamment maîtrisés.
Dans le domaine de la musique enregistrée, les artistes autoproducteurs expriment des besoins centrés sur le renforcement de leurs compétences administratives et organisationnelles, nécessitant un accompagnement pratique et directement appliqué à leurs projets. Pour les autres acteurs de la filière – production, édition, management de projet musical, organisation de tournée –, un renforcement des compétences générales est demandé par les acteurs. Il apparaît particulièrement essentiel de soutenir le développement des métiers de la production et de favoriser l’émergence de tourneurs et tourneuses, dont la présence reste encore très limitée sur le territoire.
La mise en place de formations pourrait s’inscrire dans une logique territorialisée et s’appuyer sur les dynamiques et initiatives déjà existantes. Ainsi, l’association Crama (Centre de ressources arteculture pour les musiques actuelles) accompagne artistes, producteurs, productrices et diffuseurs, diffuseuses dans l’organisation de leurs activités, en leur offrant un cadre pour consolider leurs projets et renforcer leur expertise. L’association Carré Culture soutient la structuration, la diffusion et la professionnalisation des artistes. Enfin, les formations de l’association Lakazawtis allient production musicale, organisation d’événements et formations spécialisées – couvrant la gestion de projet ainsi que ses aspects juridiques et financiers[14].
Franck Filiole, dit Mister Francky, beatmaker au Debs Music Studio, est le compositeur de nombreux morceaux et succès de musiques actuelles ou urbaines guadeloupéennes. Il a lancé il y a quelques mois E-TECH Formation, un programme spécialisé dans les métiers du numérique et des technologies créatives. Celui-ci propose notamment des formations en développement web, cybersécurité et beatmaking, toutes certifiées Qualiopi. Cette structure se distingue également par sa démarche de mise en réseau, en connectant les talents locaux à des opportunités régionales et internationales, favorisant ainsi la coopération et le développement professionnel.
Ces initiatives, encore en phase de développement, ouvrent de nouvelles perspectives aux artistes en leur permettant de se former sans avoir à quitter le territoire. Toutefois, elles demeurent pour l’instant insuffisamment connues localement, ce qui rend nécessaire un travail de valorisation et de visibilité. Par ailleurs, la forte demande en formation souligne l’importance de diversifier et d’élargir l’offre, afin de répondre aux besoins exprimés par les acteurs.
Transmission
En Guadeloupe, une vingtaine d’associations culturelles proposent des cours de musique traditionnelle, notamment de gwoka, tandis qu’une quinzaine d’écoles de musique et de maisons des jeunes et de la culture (MJC) dispensent des enseignements couvrant l’ensemble des esthétiques musicales. À cela s’ajoute la filière S2TMD (sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse) du lycée Carnot à Pointe-à-Pitre, qui propose un enseignement spécifique en musique permettant aux élèves de préparer un baccalauréat tout en suivant une formation artistique renforcée.
Une particularité de l’écosystème musical réside toutefois dans le fait qu’aucune des écoles de musique du territoire ne bénéficie d’un agrément national. Autrement dit, aucun établissement n’est adossé à un référentiel pédagogique et ne peut délivrer de diplômes ou certifications reconnus par l’État. Cette absence de reconnaissance institutionnelle limite les perspectives pour les musiciens souhaitant se former et envisager une carrière professionnelle dans le domaine artistique.
Cependant, un projet de conservatoire est actuellement en préfiguration au centre culturel de Sonis aux Abymes. Ce projet est porté par la volonté de rendre l’enseignement musical accessible à tous et toutes, de la pratique amateur jusqu’à la formation professionnelle. Il est pour le moment soutenu par la DAC de la Guadeloupe (ministère de la Culture) ainsi que par la communauté d’agglomération Cap Excellence.
En l’état, le projet de conservatoire suscite des résistances au sein de l’opinion publique. Le terme même de « conservatoire » inspire une certaine méfiance, dans la mesure où il est souvent perçu comme le symbole d’un modèle d’enseignement français jugé éloigné des réalités culturelles et musicales guadeloupéennes. Et ce, malgré la réactualisation en septembre 2023 du Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement public spécialisé de la danse, de la musique et du théâtre, qui invite désormais chaque conservatoire à construire son projet d’établissement en s’appuyant sur les pratiques et esthétiques locales, traditionnelles et patrimoniales[15].
La méfiance vis-à-vis du terme « conservatoire » s’ancre dans l’histoire postcoloniale de la Guadeloupe. Il réactive le souvenir des politiques d’assimilation culturelle mises en œuvre à partir de la départementalisation de 1946. Cette méfiance, nourrie par une histoire où la culture a souvent été un terrain de lutte et d’affirmation politique, peut encore influencer la réception de certaines initiatives, y compris lorsqu’elles visent à soutenir le développement local. Elle souligne ainsi l’importance d’élaborer des politiques culturelles en dialogue étroit avec les acteurs du territoire.
En cela, la mise en place du Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) par le conseil départemental de la Guadeloupe devrait contribuer à structurer l’enseignement artistique en s’appuyant sur des logiques de territoire, en renforçant la coordination entre les acteurs et en améliorant l’accessibilité de l’offre de formation musicale sur l’ensemble de l’archipel guadeloupéen.
Conclusion
Plusieurs pistes émergent pour structurer la filière musicale guadeloupéenne et développer une économie durable autour de la musique. Elles impliquent d’agir simultanément sur plusieurs leviers : renforcer les compétences des acteurs du spectacle vivant et de la musique enregistrée, et encourager l’émergence de nouvelles vocations dans les métiers de la musique grâce à une offre de formation adaptée ; repenser le rôle des salles de spectacle et des lieux de diffusion, afin de rendre possible l’accueil de créations pluridisciplinaires et permettre des programmations plus régulières ; soutenir les labels locaux en améliorant la rentabilité de la production, en permettant par exemple un meilleur accès au streaming et une plus grande visibilité des artistes et des titres sur les plateformes. Il apparaît également essentiel de faciliter la mobilité des artistes vers la France hexagonale, afin de pallier les contraintes liées à l’éloignement et aux coûts importants des déplacements. Enfin, ces dynamiques doivent s’accompagner de stratégies visant à renforcer la visibilité des musiques guadeloupéennes dans les médias hexagonaux.
L’écosystème de la musique guadeloupéen révèle un secteur en construction, traversé par des tensions mais aussi porteur de grandes potentialités. La structuration de cet écosystème passe ainsi par un double mouvement : d’une part, renforcer et amplifier les initiatives existantes à l’échelle locale, tout en intégrant les besoins spécifiques du secteur au-delà de ces initiatives ; d’autre part, favoriser l’ouverture et la coopération à l’échelle nationale, afin de garantir la viabilité de cet écosystème musical. Ainsi, les différentes pistes évoquées pourraient contribuer à soutenir la professionnalisation des artistes et le développement d’une économie musicale solide et pérenne. Des perspectives qui laissent entrevoir un horizon prometteur pour la filière musicale guadeloupéenne.
[1] WISH a été diffusée sur Canal+ en novembre 2024. Production : Eye & Eye Productions. Scénaristes : Julien Dalle, Dimitry Zandronis et Marc Boye. Parmi les comédiennes et comédiens : Méthi’S, Firmine Richard, Luc Saint-Éloy, Laurence Joseph, Ndy Thomas, Jacques Martial. Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=E5y1i-N7-3U.
[2] Fondé en 1984 par Henri Debs (1932-2013) – souvent surnommé l’Eddie Barclay des Antilles –, ce studio a façonné la scène et les talents de la fin du XXe siècle. Henri Debs a en effet produit la majorité des artistes de la scène musicale antillaise : Al Lirvat, Marius Cultier, Henri Guédon, Les Aiglons, Les Vikings, Typical Combo, Malavoi, Francky Vincent ou encore Zouk Machine font partie du catalogue Henri Debs. À son apogée, Henri Debs possédait également un club et un magasin d’instruments de musique.
[3] Une dizaine d’entretiens ont été menés en 2025 auprès d’acteurs du secteur musical, incluant des artistes, des producteurs, des responsables institutionnels en fonction ou ayant exercé par le passé.
[4] CREIGNOU A. et al., « En Guadeloupe, l’écoute de la musique et des informations à la radio sont les pratiques culturelles les plus répandues », Insee Analyses Guadeloupe, no 52, 19 oct. 2021, en ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5544022.
[5] Le bouyon guadeloupéen est un genre musical d’origine dominiquaise qui s’est implanté et développé en Guadeloupe au début des années 2010. Synthèse musicale de sonorités caribéennes, ce style énergique accompagne le carnaval et anime les fêtes et soirées festives de l’île. Pour en savoir plus, voir BRIZARD R., « Bouyon : la transgression à 160BPM », Tracks, produite par Programm33, ARTE, 2024, en ligne : https://www.arte.tv/fr/videos/119473-003-A/tracks.
[6] Parmi les intervenantes et intervenants figuraient Jocelyne Béroard, chanteuse martiniquaise du groupe Kassav’, Julien Dalle, producteur guadeloupéen de la série WISH, Valérie-Ann Edmond Mariette, chercheuse martiniquaise lauréate de la bourse d’études doctorales Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME)-musée du quai Branly, ainsi que le Guadeloupéen Samora Curier, fondateur du podcast LeMwakast, qui explore la culture caribéenne et compte plus de 64 000 abonnées et abonnés sur Instagram.
[7] Parmi les principaux figurent Akiyo, Anbouta-y, Chenn-La, Klé La, Le Point d’interrogation, Mas a Wobè, Mas Ka Klé, Nasyon A Neg Mawon, VIM, Voukoum.
[8] CREIGNOU et al., « En Guadeloupe, l’écoute de la musique et des informations à la radio sont les pratiques culturelles les plus répandues », op. cit.
[9] Les répétitions sont conduites par la cheffe ou le chef du groupe, qui transmet oralement les séquences rythmiques aux différentes sections de tambours. Au fil des répétitions et des sorties hebdomadaires, le jeu musical mûrit et se perfectionne jusqu’à atteindre son meilleur niveau pendant les jours gras (le dimanche, le lundi et le mardi précédant le mercredi des Cendres). Le carnaval nourrit ainsi un rapport ritualisé à la musique en dehors de toute médiation formelle.
[10] Le tambour ka est « l’instrument de musique le plus répandu (25 % des musiciens amateurs en jouent), bien avant le piano (20 %) ou la guitare (14 %) » (CREIGNOU et al., op. cit.).
[11] À cette date, L’Artchipel – Scène nationale de la Guadeloupe disposait du budget le plus élevé, avec 2,2 millions d’euros par an, suivi par le centre culturel de Sonis, doté d’un budget de 1,7 million d’euros. Les autres structures bénéficiaient de budgets plus modestes : la salle Robert-Loyson bénéficiait de 450 000 euros, la salle Félix-Proto de 100 000 euros, le ciné-théâtre du Lamentin de 97 000 euros, la salle Gilles-Floro de 50 000 euros, la salle George-Tarer de 30 000 euros, et la salle Gérard-Lockel de 25 000 euros.
[12] Parmi les principaux lieux qui programment de la musique figurent le Ti Paris au Gosier, le Ja’ri Beach, Eywa, Le Vancliff, et L’Appart à Baie-Mahault, L’Atrium et le Galets Beach à Bouillante, Le New Misty à Petit-Bourg, Kouleur Kreeol et l’Américano à Sainte-Anne, le Plezi à Pointe-Noire ainsi que trois établissements à Marie-Galante : Chez Henri, Kaz A Sik et le Touloulou. S’ajoute à cette liste le Café Philosophie de Baie-Mahault, qui propose une programmation de musique classique et lyrique. Les casinos du Gosier et de Saint-François ainsi que les hôtels Arawak et La Créole Beach au Gosier proposentégalement une programmation musicale. (Source : l’étude sur l’état des lieux du spectacle vivant en Guadeloupe réalisée par le Collectif des espaces de diffusion artistique et culturelle [Cedac]).
[13] Suivant les données collectées par la Fédération internationale de l’industrie phonographique ; voir « Global Music Report 2025 », 2025, en ligne : https://globalmusicreport.ifpi.org.
[14] Entre 2022 et 2024, Lakazawtis a organisé 17 sessions de formation. Elles ont réuni 71 participantes et participants.
[15] « Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement public spécialisé de la danse, de la musique et du théâtre », Bulletin officiel [du ministère de la Culture], hors-série no 5, sept. 2023, en ligne : https://www.culture.gouv.fr/fr/espace-documentation/bulletin-officiel/bulletin-officiel-hors-serie-n-5-septembre-2023.