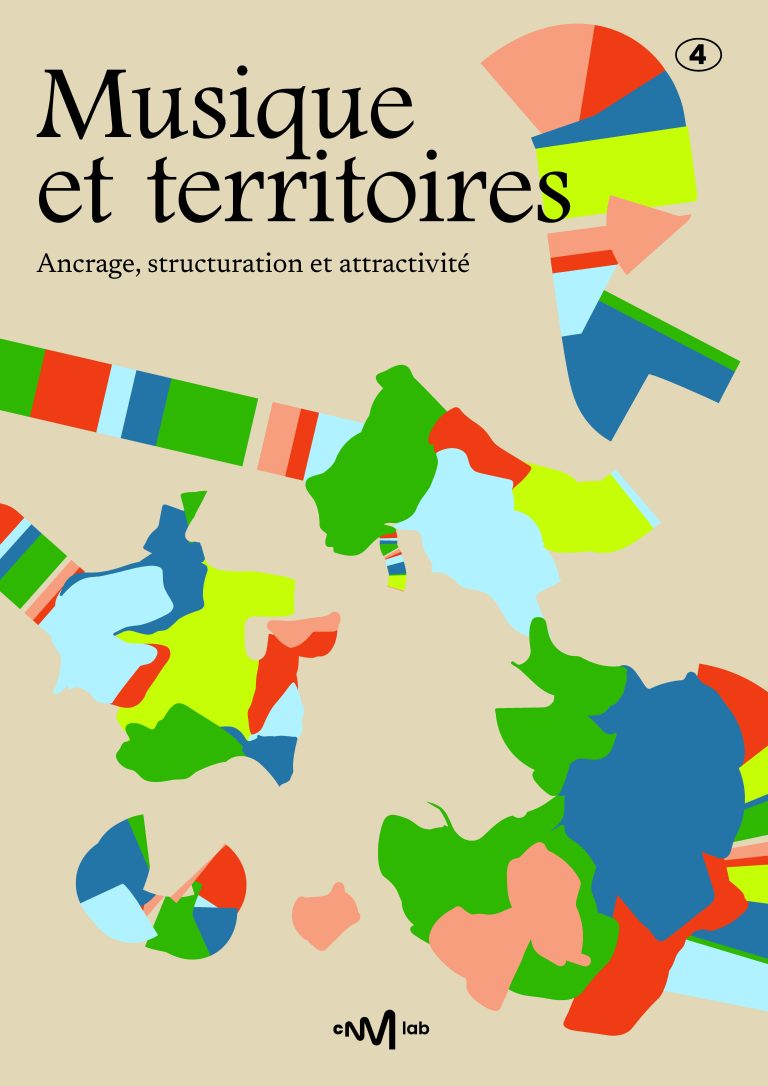Les passions musicales ordinaires comme projet de territoire
Introduction
« En 2018, selon l’enquête sur les pratiques culturelles des Français, 81 % des plus de 15 ans ont écouté de la musique durant les douze derniers mois, cette proportion ayant augmenté de 23 % depuis 1973. 57 % des personnes l’ont fait quotidiennement, alors qu’elles étaient seulement 34 % en 2008[1]. »
Les grandes enquêtes sur les pratiques culturelles des Français et Françaises du ministère de la Culture proposent une analyse chiffrée des pratiques musicales, dont la première est celle de l’omniprésence de l’écoute musicale dans la vie des Français. Approfondir ces données statistiques par l’observation d’une réalité sensible et située sur un territoire offre une immersion dans les passions musicales ordinaires. Le pari actuel du Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA) – Ethnopôle « Musiques, territoires, interculturalités » – est de s’intéresser à la construction sociale, culturelle et géographique de l’écoute musicale. Dans le présent article, je propose d’examiner un projet auquel j’ai participé[2] : « Super Tapages. Exploration des passions musicales à Francheville ». Cette commune résidentielle de la périphérie de Lyon a été choisie pour sa spécificité : ni centre-ville dynamique, ni hameau isolé, ni quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), en somme un territoire qui fait rarement l’objet d’observations sociales ou d’actions culturelles. Dans le même temps, ce projet interroge les occasions ouvertes par l’arrivée d’un tiers-lieu, Les Grandes Voisines, hébergeant des personnes en grande précarité.
Super Tapages, c’est un jeu de critique musicale sensible, des partages de playlists, des biographies musicales, des plateaux radio, des créations sonores, des interventions en milieu scolaire et en centre social, des temps fédérateurs et festifs… le tout co-construit dans un dialogue étroit entre une chargée d’action culturelle qui conçoit, coordonne et anime des partenariats et des interventions, et moi-même, qui enquête et analyse le projet à partir de ma formation en anthropologie. Il s’agit ainsi de créer et d’observer des espaces de parole autour de l’écoute musicale, ce qui permet de reconnaître chaque personne dans ce qu’elle a de singulier et de développer les conditions permettant à tous et toutes de mieux se connaître et de renforcer ses capacités à participer à la vie artistique du territoire – autant de valeurs portées par la déclaration de Fribourg sur les droits culturels. Cette expérimentation propose d’interroger différemment la façon de travailler la présence de musiques sur un territoire donné, et d’ouvrir de nouvelles perspectives sur les modalités d’action pour des médiations. Considérer la consommation musicale comme une activité productive, faite d’histoires personnelles et de liens sociaux, permet de renouveler les imaginaires des pratiques actuelles d’écoute musicale et de les transposer dans l’action. Le projet Super Tapages invite à interroger de nouveaux outils pour dialoguer autour d’une multitude de musiques.
Pourquoi se mettre à l’écoute d’un territoire ?
Super Tapages aspire à opérer des rencontres à travers la musique avec une majorité d’habitants d’un territoire, femmes ou hommes, enfants ou séniors, nouveaux arrivants ou enracinés de longue date, personnes aisées ou en grande précarité. Puisque tout le monde (ou presque) écoute de la musique, l’attention portée aux écoutes musicales des habitants devient l’occasion d’imaginer des situations inattendues pour entrer en relation. Des micros-trottoirs exploratoires permettent de lier des connaissances avec des personnes non inscrites dans les offres sociales et culturelles de la ville. Des installations mobiles d’écoutes musicales proposent des moments privilégiés de partage de playlists disparates. Des interventions en milieu scolaire, en centre social ou en école de musique incitent des jeunes à explorer eux-mêmes la diversité des écoutes de leur environnement. Des temps fédérateurs et festifs pensés avec et pour les habitants incitent les participantes et participants à réfléchir à leurs propres goûts musicaux afin d’imaginer une programmation unificatrice. La création de Moésique, un jeu de critique musicale sensible, invite à dépasser les « j’aime » ou « j’aime pas » cette musique… Cette diversité d’actions est conçue pour leur fonction sociale fédératrice de même que pour produire des données empiriques observables. Elles font écho à de nouvelles manières d’envisager les sciences sociales, assumant pleinement l’« expérimentation créative » comme outil heuristique, autrement dit le « pouvoir subversif » des expériences de terrain qui « forcent à la fois scientifiques et acteurs de terrains à accepter d’être contredits et surpris[3] ». Retracer la genèse de cette expérimentation créative, à la fois dans son ancrage institutionnel associatif et dans ses orientations thématiques portées sur l’écoute, permet dans cette première partie de constater les « conditions de félicité[4] » qui rendent possible l’existence d’un projet tel que Super Tapages. Quels prérequis ont permis de développer un projet entre anthropologie et action sociale autour de l’écoute musicale ? S’intéresser aux pratiques d’écoute sur un territoire implique ici de considérer deux dimensions de l’écoute : l’écoute musicale des habitants invités à participer à Super Tapages, et la démarche même de l’équipe du CMTRA, attentive aux mouvements culturels et musicaux d’un territoire.
À l’écoute des territoires par le collectage sonore
Écouter est une manière de tendre l’oreille vers ce qu’il est possible d’entendre ; en d’autres termes, c’est un verbe d’action qui implique une démarche active. Le projet Super Tapages tend l’oreille, mais tend aussi ses micros, récoltant des histoires d’écoutes musicales et les partageant. Il s’inscrit dans une dynamique associative qui a régulièrement renouvelé sa façon de travailler les liens entre musique et territoire. Développé au sein du CMTRA fondé en 1991, le projet est l’héritier d’une histoire plus ancienne : celle du mouvement associatif dit « folk revivaliste », dans lequel des musiciennes, musiciens, militantes et militants entreprennent des collectes de musiques, de récits, de chants dans certains territoires ruraux de la région à partir des années 1970[5]. La pratique du collectage a perduré dans la structure. Aujourd’hui encore, l’association œuvre à la reconnaissance mutuelle ainsi qu’au soutien, à la compréhension et à la valorisation d’une diversité de musiques et danses traditionnelles du territoire aurhalpin.
Dès les années 2000, son ancrage dans la métropole lyonnaise et sa dimension multiculturelle amènent les équipes du CMTRA à faire évoluer sa conception des musiques traditionnelles, explorant les pratiques, que celles-ci s’inscrivent dans un mouvement « folk » ou « trad » ou soient liées à des trajectoires de migration. Cette approche élargie, inspirée par des collaborations avec des chercheurs et chercheuses en sciences humaines[6], fait la spécificité du CMTRA. Ainsi, en 2016, fort de son expérience à la fois de recherche sur les pratiques musicales des habitants de la région et d’opérateur de rencontres sur le territoire, le centre a été labellisé Ethnopôle par le ministère de la Culture pour son projet scientifique et culturel « Musiques, territoires, interculturalités »[7]. Cette labellisation reconnaît et encourage les démarches du CMTRA pour construire un pôle de ressources, de médiation scientifique, et de recherches collaboratives. Elle favorise également les échanges d’expériences avec la douzaine d’autres Ethnopôles, créant tous des ponts entre les mondes universitaires et ceux de l’action de terrain, dans d’autres domaines que la musique.
La labellisation encourage la présence d’anthropologues dans les équipes des Ethnopôles. Depuis 2022, je mets ainsi en œuvre la dimension recherche du CMTRA-Ethnopôle en dialoguant avec des anthropologues, ethnomusicologues, sociologues, historiennes et historiens, géographes, linguistes, dans un conseil scientifique diversifié. Je conçois alors la musique comme une porte d’entrée pour comprendre une société et explorer « comment on peut agir différemment[8] ». La méthode est inductive : elle ne vise pas à valider des théories ou produire des résultats attendus, mais consiste, à partir de l’observation, des rencontres, des expériences, à assumer une démarche expérimentale avec ses incertitudes. Super Tapages s’inscrit dans cette dynamique en dialoguant avec une chargée d’action culturelle, à la fois musicienne, musicienne-intervenante et spécialisée dans les musiques appliquées aux projets territoriaux[9]. Ce dialogue garantit que le projet ne reste pas cantonné à la recherche, mais bénéficie au plus grand nombre, grâce à des interventions favorisant la participation des habitants d’un territoire à la vie artistique de celui-ci. Nous développons alors notre conception d’une « recherche-action », proche de celle décrite par l’ethnomusicologue Nicolas Prévôt : dès lors qu’une recherche « est accompagnée d’une réflexion sur ses implications sociales et que ses domaines d’application sont pensés comme des moyens d’agir sur “la” société, elle devient une forme de recherche-action pour autant qu’elle fasse participer les populations locales et qu’elle tienne compte de leurs aspirations[10] ».
L’écoute musicale comme projet de recherche-action
Choisir une musique pour exprimer une souffrance, avoir une musique qui marque un tournant de vie, découvrir une musique via des dessins animés, affirmer sa différence par ses goûts, transmettre une musique à ses enfants : les pratiques d’écoute sont multiples, et recueillir ces histoires est le cœur de Super Tapages. Au-delà de ces observations d’un territoire, le pari est d’affirmer que les compétences d’écoute ne sont pas trop discrètes pour être considérées. Cette thématique s’ancre dans une double filiation de la pensée et de l’action.
La pensée nourrit l’action. À partir des recherches en sciences humaines et sociales, nous avons échangé avec l’équipe de Super Tapages autour de la dimension active de la réception d’une œuvre d’art, revenant aux chercheurs des cultural studies et à leur décryptage des façons dont un ou une « récepteur » ou « réceptrice » décode et recode les messages qu’il ou elle perçoit[11]. À l’ère des plateformes d’écoute, réfuter l’« idéologie de consommation-réceptacle[12] » nous paraît encore d’actualité, plus de trois décennies après Michel de Certeau : « [À] une production rationalisée, expansionniste, centralisée, spectaculaire et bruyante, fait face une production d’un type tout différent, qualifiée de “consommation”, qui a pour caractéristiques ses ruses, son effritement au gré des occasions, ses braconnages, sa clandestinité, son murmure inlassable […][13]. » Écouter ce murmure engage à reconnaître l’aspect productif de l’écoute de musiques pour restituer aux gens ordinaires toute leur créativité. Cette démarche s’inscrit également dans la lignée du travail sur les écoutes à Grande-Synthe porté par Émilie Da Lage[14].
L’action nourrit la pensée. Les évolutions récentes du CMTRA ont permis de penser les projets à partir de l’attention portée à de nouvelles pratiques, délaissant progressivement le collectage centré sur les musiciens professionnels ou amateurs, pour explorer la place intime des musiques dans les vies : la compilation de répertoires chansonniers des familles récoltés, arrangés et chantés dans les écoles du quartier de Belleroche de Villefranche-sur-Saône[15] ; une exposition à partir des instruments de musique possédés par les Villeurbannais et Villeurbannaises, révélant les liens intimes aux objets en écho aux recherches sur les instruments de musique et leur circulation[16]. Cette dynamique s’inscrit dans les réflexions culturelles actuelles en France qui s’appuient sur les droits culturels énoncés dans la déclaration de Fribourg de 2007[17]. Ces droits défendent la non-discrimination et la dignité de tous et de toutes, à travers la reconnaissance des identités multiples, de la liberté de se référer à plusieurs communautés culturelles, du droit de participer à la vie culturelle… Ils reconnaissent que toute personne est porteuse d’un héritage à transmettre et conçoit le patrimoine comme un processus ouvert[18]. Les militantes et militants des droits culturels proposent de s’interroger : « Veillons-nous à promouvoir l’expression des personnes plutôt que de présupposer d’emblée ce qui les intéresse ? », « Favorisons-nous les témoignages directs entre les personnes ? Développons-nous leurs capacités à traduire et transmettre par elles-mêmes ce qu’elles perçoivent ? », « Reconnaissons-nous les personnes impliquées dans l’action comme porteuses de savoirs et d’expériences susceptibles d’être transmis à d’autres ? »[19]. Pourquoi alors n’enregistrer que des musiciens, et non pas le rapport de toutes et tous à la musique ? Peut-on ainsi imaginer une « patrimonialisation ordinaire[20] » des mobilisations de musique ?
Cette idée résonne avec les « passions ordinaires » de Christian Bromberger : « partagés massivement, assumés individuellement, acceptés moralement, vécus intensément (mais sans abus dangereux), ces engouements sont perçus comme des aspirations légitimes à la réalisation de soi et au réenchantement du monde[21] ». Ces « passions ordinaires » renvoient également à la complexité des constructions culturelles des émotions, telles que pensées par David Le Breton[22]. Cette dimension culturelle et sociale des émotions, de même que l’intérêt pour les pratiques ordinaires et les questions d’interculturalité portés par le CMTRA, a été déterminante dans l’élaboration de Super Tapages. Alors même que l’écoute musicale laisse rarement indifférent ou indifférente, cette pratique reste encore trop souvent considérée comme individuelle. Comment faire évoluer ces a priori, eux-mêmes historiquement ancrés, sur les liens entre musique et émotion[23] ? Les sciences sociales invitent à observer comment préjugés, socialisation, contexte, références et paroles échangées modifient les ressorts émotionnels de la musique[24]. Questionner l’écoute musicale sur un territoire peut-il inciter celui-ci à mieux s’écouter ?
Territoire d’actions, miroirs d’écoutes
Pour explorer l’écoute musicale, nous avons fait le choix de passer par la rencontre ethnographique sur un territoire ciblé. Observant que les recherches et actions interculturelles s’ancrent souvent dans les QPV, l’équipe du CMTRA a cherché un autre regard sur les enjeux de rencontre et de diversité sociale et culturelle. Refusant ces analyses fondées sur des catégorisations simplistes telles que « immigrés », « banlieues » d’un côté et « populations blanches », « périurbain » de l’autre[25], il s’agit d’observer l’interculturel là où personne ne le cherche. Détailler le choix du territoire de Super Tapages permet alors de comprendre son ancrage local et ses modalités d’action.
À partir d’août 2022, les deux chevilles ouvrières du projet explorent des villes autour de Lyon, choisies pour leur faible attractivité sociale, culturelle ou touristique. Certaines rencontres révèlent un fort engagement local voire une forme de saturation culturelle. La rencontre avec Francheville a lieu à travers les Grandes Voisines, un tiers-lieu créé en 2021 hébergeant 500 personnes en grande précarité et de nombreuses nationalités, un centre de santé, une salle de spectacle et des porteurs et porteuses de projet. Sur le site de l’ancien hôpital Antoine-Charial en cours de réaménagement, tout est à construire et les volontaires sont les bienvenus. Olivia Duffoux, la programmatrice du lieu, souhaite recueillir les témoignages musicaux des occupantes et occupants et a déjà organisé des temps de partage de playlists. Cette démarche naissante fait écho aux objectifs de Super Tapages et entraîne notre équipe à explorer plus largement Francheville afin d’imaginer un projet de territoire. Le territoire devient alors un cas à explorer, tant pour sa géographie que pour ses dynamiques sociales et partenariales.
Co-construction d’une recherche-action à Francheville
Francheville, ville du département du Rhône en bordure ouest de la métropole de Lyon, retient d’abord notre attention par ses spécificités géographiques et sociales. Elle est promue comme le « poumon vert de l’Ouest lyonnais[26] ». Entre l’urbain et le rural, elle côtoie d’un côté le cinquième arrondissement de Lyon, de l’autre les parcelles de champs du département. Sa communication valorise un cadre champêtre : « La vallée de l’Yzeron, avec ses vieux moulins et ses sentiers balisés, est un écrin de verdure accueillant pour les citadins-promeneurs[27]. » En 50 ans, la population est passée de 5 000 à 15 000 habitants, avec une densité triplée, ce qui est au-dessus des moyennes métropolitaines et nationales[28]. Le revenu annuel médian en 2009 est de 26 850 euros, contre 21 930 euros à l’échelle nationale. Sans QPV, Francheville est considérée comme une commune aisée. Malgré plusieurs chorales, une école de musique associative, un pôle culturel avec une salle de 400 places, un magasin de musique et des espaces de répétition, la ville n’est pas particulièrement reconnue pour son offre culturelle. Depuis l’élection d’un maire Les Républicains en 2014, elle a perdu un festival de renom : Fort en Jazz au fort du Bruissin[29]. En 2023, l’offre municipale se limite à un petit festival et une vingtaine d’événements culturels annuels. Ainsi, localisation, vie sociale et culturelle de Francheville correspondent à l’objectif de Super Tapages : interroger l’interculturalité hors des territoires où la dimension culturelle est visibilisée.
Le projet commence par des micros-trottoirs dans les trois espaces géographiques de la ville, séparés par la vallée de l’Yzeron et sans transport public les reliant facilement. Bel Air, autour des Grandes Voisines, est un quartier moderne en mutation, avec des constructions neuves et un projet d’urbanisme transitoire sur le site d’une ancienne taurellerie[30]. Une pizzeria, une supérette, une boulangerie, un opticien, un coiffeur et une pharmacie ne compensent pas l’absence d’un centre accueillant, puisqu’ils sont situés de chaque côté de la départementale. Le Bourg (Francheville le Haut) constitue le centre historique, avec église du XIIIe siècle, mairie, école de musique, rue piétonne et commerces. Tout autour, des propriétés arborées évoquent un espace résidentiel confortable. Le Châter (Francheville le Bas) est le quartier le plus urbanisé et populaire, avec le plus grand marché de la ville. Il accueille quelques habitations à loyer modéré (HLM), le centre social, le service info jeunesse et deux centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
La recherche-action avec Super Tapages repose sur la rencontre, en premier lieu avec les acteurs du territoire. Nous contactons d’abord le service culturel et les élues et élus de Francheville. Les techniciennes et techniciens, enthousiastes, voient dans Super Tapages un moyen de compléter leurs actions. Les élus à la culture et à la jeunesse, d’abord déconcertés par ce projet expérimental inhabituel, retiennent l’intérêt pour le patrimoine, la perspective d’une publication et l’absence de demande financière. Dans un contexte de disette budgétaire, je soulignerai ici l’importance des subventions Ethnopôle[31] permettant les démarches pluriannuelles et l’expérimentation sans soutien financier local, même si nous ne pouvons exclure d’autres recherches de financements sur projet. Si les échanges avec les élus restent cordiaux mais distants, sans suite concrète au-delà d’une présence du CMTRA à la fête des associations, la rencontre avec les acteurs et actrices de terrain s’avère plus fructueuse.
Les collaborations se resserrent autour de trois partenaires, un dans chaque espace de la ville : les Grandes Voisines à Bel Air, l’école de musique au Bourg, le centre social au Châter. Aux Grandes Voisines, le CMTRA développe des partages de playlists, s’associe à la radio participative et propose des temps de programmation participative avec les résidentes et résidents. À l’école de musique, avec les enseignantes et enseignants, nous travaillons les émotions musicales des élèves à travers le jeu Moésique. Au centre social, des médiations invitent des adolescentes et adolescents à enquêter sur les écoutes musicales de leur environnement. Moésique est aussi utilisé avec les enfants et leurs familles à travers des écoutes croisées et des plateaux radio. Dans les interstices, le CMTRA intervient également dans les écoles, le collège, la résidence autonomie. Ce maillage partenarial traduit la démarche de co-construction et d’écoute des besoins et possibilités des différents partenaires et de leurs usagères et usagers. Ces actions ont permis de rencontrer une diversité d’habitants et d’habitantes, que nous ambitionnons de rassembler à la fin du projet en février 2026.
Un jeu pour s’écouter
Dès les premiers micros-trottoirs de Super Tapages, il est apparu que parler des écoutes musicales n’allait pas de soi : les uns considèrent que leurs musiques ne sont pas intéressantes à partager, les autres écoutent sans trouver les mots pour en parler. Des phrases comme « Je ne suis pas spécialiste » reviennent régulièrement. Ensuite, les temps collectifs d’écoute invitent à la rencontre, à la danse, à la convivialité. Ainsi, dans les foyers des Grandes Voisines, le groupe PLL de La Réunion, avec son titre festif « Maya », côtoie Papa Wemba, Michael Jackson, Cheb Mami… Toutes les personnes présentes écoutent les musiques des uns et des autres, mais les discussions nourrissent surtout l’interconnaissance plutôt que les ressentis des écoutes. À la suite de cette expérience, avec la chargée d’action culturelle, nous avons inventé Moésique : jeu d’exploration musicale sensible. Outil pédagogique et jeu d’échange, il utilise des cartes-mots illustrées afin de créer un espace d’écoute, de parole et de partage inattendu[32].
Moésique est un jeu de médiation qui offre un temps privilégié d’écoute musicale et de discussion. Grâce à lui, les participants explorent leurs goûts musicaux en proposant une musique à écouter collectivement, tout en développant une écoute attentive. Les cartes-mots illustrées invitent à questionner les ressentis. Chaque participant choisit cinq mots en répondant à cinq questions : Qu’est-ce qui attire mon attention ? Quelle histoire cette musique me raconte-t-elle ? Où la situer dans le temps ou l’espace par rapport à moi ? Que me donne-t-elle envie de faire ? Qu’est-ce que je ressens à son écoute ? Le choix peut être individuel ou collectif, mais chacune, chacun est incité à s’exprimer à partir de ses perceptions propres, sans jugement ni interprétation de l’intention artistique. L’objectif est d’entrer en discussion à partir de ressentis personnels, tout en développant une écoute des autres.
Conçu comme un outil d’intervention et de recherche, Moésique devient un support de rencontre sur le territoire, mobilisé et mobilisable dans les temps proposés par le CMTRA à Francheville. Au fil des sessions, les langues se délient : les participants accueillent les histoires musicales des autres, mais surtout apprennent à s’écouter. Lors d’une partie, une personne propose « The Heart Asks Pleasure First » de Michael Nyman, un morceau de piano que l’on retrouve dans La leçon de piano de Jane Campion. Après l’écoute, une participante indique s’être plongée dans le récit du film en choisissant les cartes Délicat / Souvenir / Toujours / S’isoler / Mélancolie. Une autre, quant à elle, sélectionne Gras / Politique / Nulle part / Se révolter / Angoissée, évoquant son lien douloureux avec le piano, instrument imposé dans son enfance à Conakry. Symbole de raffinement, cet apprentissage l’amène à se questionner : quelle place tient aujourd’hui cet instrument pour elle ?
Au centre social de Francheville, les enfants sont invités à faire jouer leurs parents et inversement ; les adolescents à faire parler les résidents d’un centre pour séniors. Cette démarche, qui ne vise pas à transmettre des informations mais à «favoriser l’expression des participants, leur écoute et leur mise en dialogue[33] », renvoie à la médiation culturelle au sens de Serge Chaumier et François Mairesse. Dans Super Tapages, il s’agit bien « de permettre aux individus de se réapproprier des éléments du langage qui leur donnent la possibilité de se construire un début de récit, c’est-à-dire de se situer dans le monde[34] ». L’écoute musicale devient ainsi un levier pour que chacun prenne sa place, à la fois dans le territoire géographique de Francheville et dans les territoires imaginaires façonnés par l’attachement musical ou le refus de celui-ci.
Vers une diversité d’écoutes musicales
Qu’il s’agisse de jouer à Moésique, de partager des playlists, de choisir collectivement un artiste pour un concert ou d’interroger les passantes et passants sur les musiques évoquant leurs grands-parents, Super Tapages valorise sans critères ni sélection une diversité de morceaux de musiques. Dans ces espaces dialoguent alors : la chanson « J’ai mal » de Dana et Yanns, jeunes artistes révélés sur TikTok ; Fally Ipupa, auteur-compositeur-interprète, danseur et producteur congolais, premier à populariser le lingala à ce niveau de célébrité ; Butrint Imeri, chanteur d’origine kosovare d’Albanie né en Allemagne en 1996, devenu célèbre en Albanie vers 2017 ; Naïma, une chanteuse de zouk nouvelle génération originaire des Comores ; Sandra Mbuyi, une chanteuse de gospel née en 1984 à Kinshasa ; Ska-P, le groupe de punk espagnol des années 1990 ; Majzoub Onsa, grande voix soudanaise des années 1960 ; ou encore Mike Brant, chanteur israélien à succès en France dans les années 1970. La liste des morceaux partagés est longue et rencontre également Georges Brassens, Madonna, Bill Evans ou Aya Nakamura.
Ici encore, la posture réflexive des sciences sociales a permis d’interroger l’ethnocentrisme ou sociocentrisme des équipes de Super Tapages. Depuis l’ouvrage canonique de Bourdieu à la fin des années 1970[35] et les nombreuses études qui ont suivi, il est désormais admis que les goûts (notamment musicaux) participent à une classification sociale des individus. L’écoute et la pratique musicales sont soumises à des jugements de valeur qui légitiment le goût des classes dominanteset relèguent les goûts des autres groupes sociaux au rang d’« impurs », « légers », « faciles ». Pour éviter cette vision restrictive et entrer en relation avec les habitants, notre équipe apprend à abandonner toute posture de « savant » vis-à-vis des musiques partagées, autrement dit tout ce qui pourrait l’amener à observer les pratiques culturelles « ordinaires », pour ne pas dire « populaires », sous les critères propres à son champ culturel ou social. L’enjeu est d’utiliser les catégories musicales pour leur caractère descriptif opérant pour les personnes rencontrées, et non comme normes imposées pour légitimer une autorité institutionnelle.
Cette démarche d’ouverture a permis de rencontrer un large éventail d’habitants de Francheville : enfants, personnes âgées, résidents de longue date ou nouvelles et nouveaux venus aux Grandes Voisines, et d’accueillir leurs expressions singulières. Les premières rencontres, plus collectives, ont ouvert la voie à d’autres rencontres plus approfondies, autour d’un café et d’un micro et surtout d’une grande disponibilité. Avec une trentaine d’habitants volontaires, nous avons engagé la co-construction de leur biographie musicale. L’attention aux « passions ordinaires » invite à suspendre tout jugement et à laisser émerger la multiplicité des liens, révélés par les extraits de biographies musicales qui suivent.
Les objets de l’écoute
La musique, pour moi c’est la vie. Donc la musique c’est tout le temps, autant que je peux, du réveil au coucher. Bon, forcément au boulot c’est plus compliqué, parce qu’on a des entretiens et tout, on n’a pas forcément le temps, mais la musique pour moi c’est tout le temps.
C’est avec ces mots que Théo[36], travailleur social aux Grandes Voisines, décrit son rapport à la musique. Né à La Réunion dans les années 1980, il est arrivé en région lyonnaise à 18 ans. Frustré de ne pouvoir évoquer l’immense diversité de musiques qui l’a accompagné dans sa vie, il prend plaisir à faire découvrir les musiques malgaches et réunionnaises qui lui rappellent son enfance et qu’il sait moins connues ici.
J’aurais pu te parler aussi de Mike Brant et tout ça […]. Mais c’est l’occasion de parler un peu de mes origines malgaches.
Il décrit les cassettes de Jean Fredy ramenées de Madagascar par les amis des parents :
C’est un peu les premiers souvenirs musicaux que j’ai pu avoir. Non seulement ils écoutaient les cassettes en boucle, mais mon père est musicien donc il chantait aussi. Il y avait des repas, des fêtes comme ça, en famille ou entre amis. Il y avait toujours les instruments qui traînaient, ils installaient tout ça et puis ils faisaient le petit bœuf.
Les souvenirs s’enchaînent : le premier grand concert, Johnny Clegg ; le premier CD acheté avec son père, Mily Clément ; les écoutes au Walkman d’artistes réunionnais et réunionnaises diffusés et repiqués à la radio, dont Ousanousava ; les premières diffusions de maloya à la radio avec Granmoun Lélé ; les échanges de CD avec les copains, dont Danyèl Waro ; les vidéos VHS de son cousin pour voir les concerts de Michael Jackson ; l’époque de l’école buissonnière en écoutant les Fugees derrière la MJC (maison des jeunes et de la culture) sur un lecteur radiocassette… Tout au long de la discussion, la dimension sociale des écoutes – familiales, festives ou entre amis – émaille les références trop nombreuses pour être citées. Les descriptions précises des situations d’écoute révèlent une manière de se relier à la musique par les relations aux autres, mais aussi par les objets, à travers ces supports d’écoute qui s’offrent, s’échangent, se partagent et qui n’ont cessé d’évoluer.
L’écoute qui distingue
Françoise vit à Francheville depuis 25 ans. À 77 ans, très investie dans la vie associative, elle est bénévole aux Grandes Voisines, notamment auprès des familles, et met à profit ses compétences d’ancienne psychologue pour enfants. Issue d’une famille modeste, elle a grandi en HLM dans une cité ouvrière à Villefranche. Sa mère est née en France juste après la traversée de la frontière italienne, et dans la famille il était interdit de parler italien, pour mieux « s’intégrer ». Chaque dimanche, la famille allait à la messe, Françoise prenait plaisir à y chanter. C’est ainsi qu’elle découvre la musique :
Un jour, je rentrais de la messe avec cette grand-mère que je devais accompagner, je pense, en lui donnant le bras, quelque chose du genre. Ma grand-mère n’avait pas le droit d’aller à la messe puisqu’elle ne parlait pas le français… Et donc cette grand-mère, on l’appelait la mamie. Et la mamie me dit « Viens, je vais te faire écouter une musique, parce que tu as l’air de beaucoup aimer la musique », et elle me fait écouter Jean-Sébastien Bach. Et là je suis tombée, mais éperdument amoureuse de cette musique, ça devait être la Toccata et fugue en ré mineur.
Qu’il s’agisse du moment privilégié de la découverte des capacités d’un support d’écoute ou de la pièce en elle-même, cette écoute déclenche la passion d’une vie pour les musiques classique et baroque. Dès qu’elle le peut à l’adolescence, elle s’achète des disques de Bach, des valses de Chopin, en décalage avec sa famille et sa génération :
Mes amis m’appelaient la comtesse, parce que j’aimais la musique classique et eux ils étaient rock.
Cette écoute sérieuse, presque religieuse, se démarque d’autres écoutes plus collectives, festives et conviviales, qui, sans être absentes de la vie de Françoise, ne lui viennent pas dans la construction de son identité musicale.
L’écoute résiliente
Nicolas a 30 ans. Né dans le Sud, il s’est longtemps cherché entre différentes voies d’étude avant de devenir assistant social en 2020, puis d’entrer à l’Armée du Salut et rapidement aux Grandes Voisines. Les morceaux qui ont marqué sa vie oscillent entre R’n’B et rap français (Corneille, Tragédie ou Sniper), rock (Rolling Stones, AC/DC) et électro (Bob Sinclar, David Guetta). Il accorde une attention particulière aux paroles engagées, portant notamment sur le racisme, l’exclusion, l’égalité. Durant ses études, il écoutait beaucoup Ska-P, pour son engagement « quasiment anarchiste » et pour apprendre l’espagnol, en particulier le morceau « La Colmena », qui dénonce l’usage par Nicolas Sarkozy des mots « racaille » et « karcher » en 2005. Puis il y a eu un accident.
J’étais dans un coma artificiel, parce que j’avais perdu la rate, il fallait qu’ils me l’enlèvent. J’avais perdu beaucoup de poids. En même temps, mes parents avaient peur que je ne parle plus, parce qu’il y avait des risques avec le trauma crânien. Ils ont mis la chanson comme ça, dans le dortoir et puis voilà, je chantais comme ça, en me réveillant. J’avais vraiment des gestes un peu… pas primaires, mais je n’étais pas encore totalement conscient. Je me suis arraché le tuyau d’intubation […], c’était assez violent. Mais, c’était presque… je revenais à la vie.
L’espagnol devient alors une langue de reconstruction.
Ma mère, quand même, elle me parlait en espagnol, dans mon lit d’hôpital, et je répondais en espagnol, encore endormi dans le coma, et moi, cette langue-là m’a vraiment marqué beaucoup.
Ska-P devient un groupe structurant dans sa vie. Même s’il l’écoute moins aujourd’hui, la chanson reste associée à sa renaissance, jusqu’à être utilisée comme sonnerie de téléphone par son père. Une chanson devient ainsi le centre d’un vécu familial partagé autour d’un événement traumatique. La musique ici guérit, pas seulement par ses qualités sonores, mais par les habitudes d’écoute antérieures et par un sentiment de résilience tissé en commun.
L’engagement dans l’écoute
Chantal et Michel habitent Francheville depuis 35 ans. À plus de 70 ans, tous deux à la retraite, ils partagent une longue histoire commune :
Nos parents étaient amis. On n’a pas eu le choix. On a fait les mêmes musiques en même temps. On a fait les mêmes concerts, on a fait les mêmes choses.
Chez eux, la musique est omniprésente :
La musique ? Eh bien, c’est toute la journée. Vous m’avez fait éteindre parce que… voilà. Parce que c’est vous. Si on reçoit du monde, on a forcément un fond musical. Tout le temps.
Leur univers musical s’est tout d’abord constitué autour de la chanson française (Les Compagnons de la chanson, Gilbert Bécaud, Georges Brassens, Léo Ferré, Hugues Aufray…), puis des artistes aux « cheveux longs » (Maxime Le Forestier, Cat Stevens…), des groupes de rock (Pink Floyd, Deep Purple, les Who…), en passant par une obsession pour Francis Lalanne ou Patrick Bruel. Leurs goûts se sont diversifiés avec le temps, influencés également par leurs enfants et petits-enfants. Les musiques qu’ils n’écoutent pas seraient plutôt le « metal » ou l’« opéra », « quand c’est trop guttural » ou « quand ça piaille ». Par ailleurs, Chantal avait beaucoup d’a priori contre « le jazz intello, le truc où on s’ennuie terriblement ». Pourtant, tout près de chez eux, le fort du Bruissin accueillait depuis les années 1990 un festival de jazz d’importance régionale : Fort en Jazz. Michel, impliqué dans la vie locale, y emmenait régulièrement Chantal, notamment via leur activité municipale. Quand un nouveau maire supprime la subvention du festival en 2015, Michel, élu d’opposition, réagit :
S’ils suppriment le festival, on crée une association.
Ce sera Ça Jazze Fort à Francheville. Chantal s’y engage elle aussi et commence à apprécier le jazz :
J’étais obligée de m’y mettre. Et finalement, c’est sympa. Comme quoi, l’éducation musicale, ce n’est pas rien.
Michel ajoute :
On organise quatre ou cinq concerts de jazz par an.
Tout en conservant leurs goûts initiaux, ils découvrent ensemble d’autres émotions musicales : Tony Paeleman, Louis Winsberg avec Sabrina Romero, Sophie Alour, Anne Paceo, Pierre Perchaud… L’écoute formée par un contexte politique particulier et par un engagement associatif rappelle combien les pratiques répétées et une part de volonté sont déterminantes dans la fabrication des émotions musicales.
L’écoute pour survivre
Le 12 juillet 2024, les Grandes Voisines et le CMTRA organisent un karaoké en amont d’un concert. Endrit, résident d’origine kosovare, prend rapidement le micro pour chanter « Tourner la tête » de Slimane, révélé en 2016 par The Voice : « J’veux me foutre dans le noir / Pour cacher mes défaites / Mais ce monde qui danse / Me fait tourner la tête. » Sa voix sensible et forte, ces paroles dépressives répétées avec accent ne laissent pas indifférent. Quelques jours plus tard, il se confie en entretien :
Pour dire la vérité, moi, je suis trop fragile de musique. Parce que la musique, j’aime trop. Mais après, moi, je pleure avec la musique quelquefois, même comme elle chante.
Cet homme s’impose à lui-même d’être fort pour sa femme, leur enfant polyhandicapé et ses deux enfants nés en France. Il travaille beaucoup pour faire vivre sa famille, et malgré le fait qu’il présente des lettres de recommandation de toutes parts (employeurs, travailleurs sociaux…), l’administration s’obstine à lui refuser un titre de séjour. En écoutant de la musique, il s’autorise à vivre certaines émotions. Sa biographie musicale raconte comment la musique a toujours été pour lui une échappatoire dans une histoire de vie difficile. Très jeune, après la mort de son père, il est recueilli par son oncle, qui le fait travailler. Il économise pour s’acheter un poste radio et dès qu’il peut, il part de la maison pour l’écouter et chanter les chansons qu’il entend. Au début de l’âge adulte, il chante dans des bars. Découverte en explorant les « top hits » de la musique français, la chanson de Slimane est liée à sa présence en France. Aujourd’hui, il la chante en boucle :
Je pensais que cette musique me correspondait, avec la situation que j’ai, [parce que] la mélodie c’est un peu piquant quoi. Et ça me touche, cette mélodie. Quand je l’écoute un peu, ça me sort des larmes aussi.
Par le passé, Endrit avait déjà une attirance pour l’écoute puis le chant, mais son environnement familial a attisé cette prédisposition, et son environnement social et culturel a accompagné les musiques qu’il a choisies. Quand il change d’environnement, ses habitudes évoluent.
Il serait facile de voir les émotions musicales révélées par les biographies d’écoute comme des traits de caractère individuel. Pourtant, celles de Théo, Françoise, Nicolas, Michel et Chantal ou Endrit montrent qu’elles sont des habitudes, des techniques du corps, développées dans des « savoir-faire appris dans un environnement culturel déterminé[37] ». Un autre fil relie ces récits musicaux, racontés avec un plaisir teinté de nostalgie : ils nouent les écoutes à un ailleurs géographique ou historique qui s’invite dans le quotidien. En parallèle, le territoire apparaît dans les espaces d’écoute et le désir de s’inscrire dans un environnement proche ou de s’en démarquer. Se mettre à l’écoute du vécu intime ouvre une autre compréhension des liens sociaux et culturels qui façonnent les émotions, lesquelles leur donnent forme en retour. Comme le révèle l’exploration des biographies musicales, la diversité des attachements se construit à travers des histoires, des contextes, des actions précises, des réflexions, révélant la part active qu’accomplit l’auditeur ou l’auditrice pour se laisser émouvoir : « On n’aime pas la musique, on se la fait aimer ; la musique n’est pas belle, elle se fait belle pour qui la courtise[38] ». Échappatoire, exutoire, désir politique, reconstruction d’un souvenir ou élan de vie, l’écoute, dépouillée des catégories musicales, peut être comprise comme une performance : elle se joue dans des situations chargées d’attentions spécifiques. Elle permet de redéfinir ce que sont ces musiques pour les personnes : « [L]’écoute [est une] compétence collective, historique, instrumentée, aboutissant à une disposition nouvelle, celle de l’amateur de musique, disposition qui en retour a redéfini dans ses moindres détails ce qu’est la musique[39]. »
Conclusion et perspectives
Super Tapages est encore un projet en cours. Les biographies musicales sont en train d’être traitées pour devenir des capsules sonores partageables et partagées en ligne et dans un ouvrage en cours d’écriture[40]. Un événement participatif est prévu en février 2026 pour clore le projet dans une rencontre avec celles et ceux qui ont participé : restitutions festives, concerts en lien avec les témoignages, karaoké créatif des résidents, écoute des montages sonores mettant en résonnance les récits et playlists d’une diversité de Franchevillois et Franchevilloises. Élèves, professeures et professeurs de l’école de musique, collégiennes et collégiens, usagères et usagers du centre social, élèves de l’école primaire, résidentes et résidents des Grandes Voisines seront conviés à découvrir la diversité des émotions d’écoute musicale de Francheville. Les fruits de ces rencontres seront encore à observer, mais il est déjà possible d’identifier ce qui a permis au projet d’éclore et les questions qu’il soulève encore.
Le premier constat est la difficulté de proposer des actions qui ne reposent pas sur la transmission des savoirs des mondes de l’art vers des publics éloignés, mais qui valorisent les connaissances et expériences des participants, dans l’esprit de la déclaration de Fribourg sur les droits culturels. Longtemps, les politiques culturelles ont valorisé l’immédiateté des œuvres : il suffirait de mettre une personne face à une œuvre pour provoquer une émotion. Cette approche a fondé le ministère des Affaires culturelles en 1959, dans une logique de démocratisation culturelle, rompant avec un paradigme éducatif. Une pensée de démocratie culturelle a ensuite tenté de remettre en cause les hiérarchies artistiques, réintroduisant notamment l’éducation artistique. Celle-ci reste pourtant souvent envisagée comme une éducation à la sensibilité artistique. Aujourd’hui encore, les appels à projet imposent aux acteurs culturels la transmission de savoirs via des artistes reconnus, dans des temporalités courtes. Face au recul des subventions de fonctionnement, les structures culturelles et scientifiques sont prises dans une quête incessante de financements et dans les urgences de réalisations par projet. Or Jean-Pierre Boutinet, dans son Anthropologie du projet[41], montre que cette logique induit une « conduite d’anticipation » fondée sur un temps linéaire dominé par le futur. « Le futur est devenu la préoccupation quotidienne destinée à préparer les moindres adaptations des individus à leur environnement[42]. » Comment alors maintenir une démarche expérimentale et incertaine face à ces injonctions à l’anticipation ? Le cas de Super Tapages rappelle que la co-construction partenariale créative, les tâtonnements et la réflexivité inhérente aux démarches expérimentales nécessitent du temps, des financements dédiés.
Une deuxième question découle de la première. Dans les temporalités contraintes des mondes de la culture, l’inconnu émerge dans les marges de l’efficacité. La difficulté rencontrée à construire des collaborations avec certains services de la ville, comme la médiathèque – pourtant lieu potentiel d’exploration de l’écoute[43] –, peut être comparée à la richesse des partenariats aboutis, notamment avec le centre social et les Grandes Voisines. Ces lieux, ouverts aux expérimentations, fonctionnent sur un mode associatif, accueillent une diversité d’usagers et de bénévoles, et permettent une co-construction dépassant le schéma classique d’intervention sur des « publics captifs ». « Lieux hybrides », « protéiformes », « revendiquant l’invention et le renouvellement perpétuel »[44], les tiers-lieux apparaissent comme des espaces propices à des projets comme Super Tapages. Ils séduisent par « leur dimension politique, leur fonctionnement collectif, la porosité entre les disciplines, ou encore la créativité et l’expérimentation qui sont à l’œuvre[45] ». Pourtant, la diversité de leurs modèles économiques et leur caractère souvent provisoire interrogent leur capacité à s’inscrire dans le temps long des dynamiques locales. En regard des tiers-lieux, les centres sociaux, ces « lieux de proximité » toujours fragiles même si installés plus durablement, aspirent toujours à « permett[re] aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets[46] ». Comment penser aujourd’hui la pérennisation de ces espaces de création sociale et culturelle, et surtout politique, pour leur permettre de perpétuer une ouverture aux constructions communes, à l’écoute des mouvements de la société contemporaine ?
La troisième question concerne la place accordée aux écoutes, et donc aux savoirs des habitants dans les projets musicaux. En musique, il est courant d’attribuer aux œuvres des qualités intrinsèques fondées sur des analogies entre modalités et émotions (accord majeur donc gai, mineur donc triste) et qu’il faudrait transmettre. Cette vision est renforcée par les études récentes en neuroscience qui analysent les effets des sons sans prendre en compte le contexte[47]. D’autres chercheurs critiquent une « culture capitaliste [qui] s’est accompagnée d’une intensification sans précédent de la vie émotionnelle[48] », transformant les musiques en marchandises émotionnelles[49]. Les plateformes musicales l’ont compris, avec leurs playlists « Motivation », « Soirée », « Tristesse », etc. Or l’expérience de Super Tapages montre la complexité de la construction sociale et culturelle des émotions musicales. En créant un espace de parole autour de cette hétérogénéité, cette façon d’approcher la musique invite à remettre au centre de la discussion les relations activant l’attachement aux musiques. Cette expérimentation révèle la façon dont la mobilisation de musiques construit des liens inattendus aux territoires. Écouter, voire même s’écouter écouter délie les langues sur les attachements aux lieux, ceux qui sont habités, qui ont été quittés, qui sont imaginés, qui soignent. Dit autrement, la diversité des musiques dépouillées des préjugés peut devenir un outil d’action sociale permettant à chacun de se situer sur différents terrains. Cette démarche interroge les liens existants et ceux à construire pour lutter contre une forme de « mésécoute » « comme il existe une mésentente entre deux personnes en désaccord », et invite à lutter contre les « surdités flagrantes », comme dirait Peter Szendy[50]. Partager cette manière d’envisager la présence musicale sur un territoire ouvre de nouvelles perspectives pour les médiations en collaboration avec l’anthropologie. Super Tapages propose d’inventer de nouveaux outils pour dialoguer autour d’une diversité de musiques à partir de ces différences, et de renforcer les ponts entre mondes de la recherche et mondes de l’action sociale et culturelle.
[1] Département des Études, de la Prospective, des Statistiques et de la Documentation (DEPS), « Musique enregistrée », dans DEPS, Chiffres clés. Statistiques de la culture et de la communication : 2023, ministère de la Culture, 2023, p. 272-277, en ligne : https://www.culture.gouv.fr/fr/content/download/342848/pdf_file/Chiffres-cles-statistiques-de-la-culture-2023-DEPS.pdf?inLanguage=fre-FR&version=41.
[2] Je rédige cet article en mon nom propre dans le cadre de mes missions au Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA), où après une thèse de doctorat, j’explore les possibilités qu’offre l’anthropologie pour mener directement des projets au sein d’une structure culturelle.
[3] DUFLO E., Expérience, science et lutte contre la pauvreté, Paris, Collège de France, paragr. 78, en ligne : https://doi.org/10.4000/books.cdf.2693.
[4] GOFFMAN E., Façons de parler, Paris, Minuit, 1987 [1981], p. 205-271.
[5] GASNAULT F., « Les rapports entre la direction de la musique et les associations de musiques et danses traditionnelles : un processus de légitimation inabouti (années 1970 – années 1990) », Politiques de la culture. Carnet de recherches du Comité d’histoire du ministère de la Culture sur les politiques, les institutions et les pratiques culturelles, 19 mai 2014, en ligne : http://chmcc.hypotheses.org/428.
[6] Faisant écho aux nombreux ouvrages d’anthropologues et d’ethnomusicologues déconstruisant les termes « tradition » (HOBSBAWM E. et RANGER T. [dir.], L’invention de la tradition, Paris, Amsterdam, 2006 [1983]) et « musiques du monde » (OLEKSIAK J., « Des musiques du monde à Royaumont. Fabrication de la diversité et programmation de rencontres dans une institution culturelle », thèse en musique, histoire et société,Paris, EHESS, 2020). Malgré l’insatisfaction récurrente des acteurs et actrices professionnels quant à ces catégories, celles-ci restent néanmoins utilisées par nécessité et fonctionnent en « régime d’implicite » (LABORDE D., « Les sirènes de la world music », Les Cahiers de médiologie, no 3, 1997, p. 243‑252, en ligne : https://doi.org/10.3917/cdm.003.0243).
[7] Voir le projet scientifique et culturel (PSC) de l’Ethnopôle : https://www.cmtra.org/Nous_connaitre/Le_CA/5_LethnopyleMusiquesterritoiresinterculturalitys.html.
[8] BAZIN J., Des clous dans la Joconde. L’anthropologie autrement, Toulouse, Anacharsis, 2008, p. 378.
[9] Maëllis Daubercies puis Julia Kallmann ont occupé ce poste. Elles ont toutes les deux une pratique instrumentale et ont été formées à la fois au Centre de formation des musiciens intervenants et dans le master Musiques appliquées aux projets territoriaux de l’université Lumière-Lyon 2.
[10] PRÉVÔT N., « Ethnomusicologie et recherche-action : le patrimoine musical des Nanterriens », Cahiers d’ethnomusicologie, no 29, 2016, p. 140, en ligne : https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/2592.
[11] HALL S., « Codage/décodage », Réseaux. Communication – Technologie – Société, vol. 12, no 68, 1994, p. 27‑39, en ligne : https://doi.org/10.3406/reso.1994.2618.
[12] CERTEAU M. de, L’invention du quotidien, Paris, Gallimard, 1990 [1980], p. 242.
[13] Ibid., p. 53.
[14] DA LAGE É., « La musique, le temps, le camp. Faire du terrain en fermant les yeux », thèse en sciences de l’information et de la communication, Paris, Sorbonne Université, 2021, en ligne : https://hal.science/tel-03504168v1.
[15] LEFRONT M. (dir.), Chorale intergalactique de Belleroche, Villeurbanne, CMTRA, coll. « Atlas sonore », no 26, 2021.
[16] Science des instruments de musique, l’organologie s’est vue transformée depuis les années 2000 aux États-Unis par des recherches portant sur les liens entre humains et instruments de musiques : ROSSI ROGNONI G., « Organology and the others: a political perspective », Journal of the American Musical Instrument Society, vol. 44, 2018, p. 7‑17, en ligne : https://doi.org/10.24379/RCM.00000922. L’ouvrage du CMTRA : JOUVE-VILLARD L. et VESCHAMBRE V. (dir.), Instruments voyageurs : le monde sonne à nos portes, Lyon, Libel, 2023.
[17] Déclaration à consulter : https://reseauculture21.fr/blog/2012/10/10/la-declaration-de-fribourg-2007.
[18] AUBRY A. et al., Typologies. Les droits culturels en action, Réseau culture 21, 2022, p. 14, en ligne : https://reseauculture21.fr/blog/2023/01/26/typologies-les-droits-culturels-en-action.
[19] AUBRY A. et al., Typologies, op. cit.,respectivement p. 45, 45 et 57.
[20] ISNART C., « Les patrimonialisations ordinaires. Essai d’images ethnographiées », Ethnographiques.org, no 24, juill. 2012, en ligne : https://www.ethnographiques.org/2012/Isnart.
[21] BROMBERGER C., Passions ordinaires. Football, jardinage, généalogie, concours de dictée…, Paris, Hachette littératures, 2002, p. 26.
[22] LE BRETON D., Les passions ordinaires. Anthropologie des émotions, Paris, Payot, 2004 [1998].
[23] LABORDE D., « Des passions de l’âme au discours de la musique », Terrain. Anthropologie & sciences humaines, no 22, 1994, p. 79‑92, en ligne : https://doi.org/10.4000/terrain.3087.
[24] Voir ROUEFF O., « Musiques et émotions », Terrain. Anthropologie & sciences humaines, no 37, 2001, en ligne : https://doi.org/10.4000/terrain.1280, ainsi que l’ensemble de ce numéro consacré à la thématique « Musique et émotion ».
[25] GINTRAC C. et MEKDJIAN S., « Le peuple et la “France périphérique” : la géographie au service d’une version culturaliste et essentialisée des classes populaires », Espaces et sociétés, no 156‑157, 2014, p. 233‑239, en ligne : https://doi.org/10.3917/esp.156.0233.
[26] Mairie de Francheville, « Découvrez Francheville en images ! », 16 fév. 2023, en ligne : https://www.mairie-francheville69.fr/actualites/decouvrez-francheville-en-images.
[27] Ibid.
[28] Source des données : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), « Dossier complet. Commune de Francheville (69089) », 10 juill. 2025, en ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-69089.
[29] MEREU J., « Disparition du festival Fort en Jazz », Citizen Jazz, s. d. [2015], en ligne : https://www.citizenjazz.com/Disparition-du-festival-Fort-en-Jazz.html.
[30] Mairie de Francheville, « La terrasse Bel Air », 30 juin 2022, en ligne : https://www.mairie-francheville69.fr/actualites/la-terrasse-bel-air.
[31] Du ministère de la Culture, du service ethnologie de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes, du service culture et patrimoine de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la métropole de Lyon, de la ville de Villeurbanne.
[32] Pour en savoir plus sur cet outil : https://www.cmtra.org/Nosactions/Actionculturelle/1525_Moysique.html.
[33] CHAUMIER S. et MAIRESSE F., La médiation culturelle, Paris, Armand Colin, 2013, p. 12.
[34] Ibid., p. 155.
[35] BOURDIEU P., La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979.
[36] Tous les prénoms ont été changés pour l’anonymisation des personnes.
[37] QUÉRÉ L., Il n’y a pas de « cerveau des émotions », Paris, Presses universitaires de France (PUF), 2023, p. 251.
[38] HENNION A., « La musique s’écoute-t-elle ? », dans P. Le Quéau (dir.), 20 ans de sociologie de l’art : bilan et perspectives. Tome I, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 291‑301, en ligne : https://shs.hal.science/halshs-00193418v1.
[39] Ibid.
[40] OLEKSIAK J. (coord.), Des passions musicales ordinaires. Super Tapages, une recherche-action à Francheville, Lyon, La rumeur libre, à paraître en 2026.
[41] BOUTINET J.-P., Anthropologie du projet, Paris, PUF, 2015 [1990].
[42] Ibid., p. 58.
[43] Ce constat est d’autant plus criant que les médiathèques font aujourd’hui partie des principaux acquéreurs de Moésique.
[44] PIGNOT L., présentation du dossier « Tiers-lieux : un modèle à suivre ? » codirigé par L. Pignot et J.-P. Saez, L’Observatoire. La revue des politiques culturelles, no 52, 2018, p. 7-8, en ligne : https://doi.org/10.3917/lobs.052.0007.
[45] Ibid., p. 7.
[46] Caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne, « Les centres sociaux », s. d., en ligne : https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-tarn-et-garonne/offre-de-service/vie-personnelle/l-animation-de-la-vie-sociale/les-centres-sociaux.
[47] QUÉRÉ L., Il n’y a pas de « cerveau des émotions », op. cit.
[48] ILLOUZ E. (dir.), Les marchandises émotionnelles. L’authenticité au temps du capitalisme, Paris, Premier Parallèle, 2019, p. 21.
[49] SCHWARZ O., « Des gouttes émotionnelles dans les oreilles : l’industrie de la musique et la gestion des émotions », dans E. Illouz (dir.), Les marchandises émotionnelles, op. cit, p. 99.
[50] PONCET E., « “Nous avons toujours plus de deux oreilles” », entretien avec Peter Szendy, Revue XXI, no 63, nov. 2023, p. 162-173.