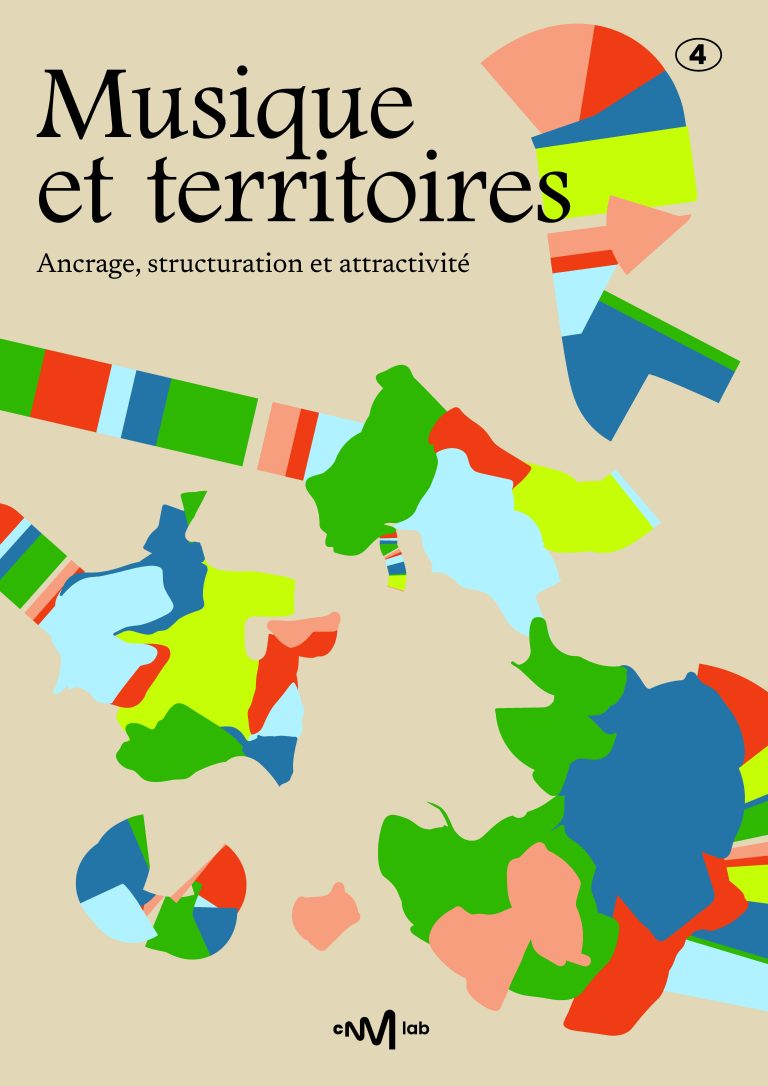Gisèle Magnan – Entretien
Les concerts de poche
Les Concerts de Poche, reconnus d’Utilité Publique, œuvrent dans toute la France en emmenant les meilleurs artistes de la musique classique, lyrique et jazz dans les campagnes, montagnes et quartiers. Ils organisent chaque année de façon itinérante 2500 ateliers et 120 concerts indissociables, dans 360 communes et quartiers, pour plus de 45 000 participants. Ceux-ci constituent de « nouveaux » publics, qu’il s’agisse des jeunes de tous les âges, ou de personnes isolées. Les projets sont construits sur-mesure avec les municipalités qui les accueillent. La mission est à la fois artistique, sociale et territoriale.
Pour vous, qu’est-ce qu’un territoire ?
Le territoire, c’est à la fois une notion géographique, et aussi une notion humaine d’habitants. Qui vit ici ? Où ? Pourquoi ? Comment ? Avec quoi ? Et de quelle façon vit-on quelque part ?
Quelle est la genèse du projet des Concerts de Poche ?
J’étais pianiste concertiste et je me déplaçais beaucoup, tout en habitant un petit village à la campagne. À mes débuts, je donnais des concerts dans des lieux modestes, où je connaissais le public. Puis, on m’a demandé de jouer dans des salles de plus en plus grandes et intimidantes, où les spectateurs étaient déjà amateurs de musique classique. Je constatais que ces publics se ressemblaient beaucoup d’un endroit à l’autre, et surtout, je ne rencontrais pas vraiment les habitants des territoires que je visitais. On me remettait un bouquet de fleurs à la fin, et je retournais à ma loge avant de repartir pour l’hôtel.
Avec le temps, je me suis demandé pourquoi je quittais mon village pour jouer devant des publics déjà acquis. J’avais envie de nouvelles expériences, de rencontrer la population réelle du XXIe siècle. Dans les territoires ruraux, je savais ce que la musique pouvait apporter en matière de lien social, non seulement à travers l’écoute, mais surtout par la pratique et la création collective. C’est cette idée qui a façonné le dispositif que j’ai créé il y a maintenant vingt ans.
Quelles ont été les premières étapes de structuration du projet, et comment avez-vous élaboré le modèle d’ateliers et de concerts qui existe aujourd’hui ?
J’ai beaucoup tâtonné avant d’arriver au modèle actuel. Au début, je me mettais encore en scène, imaginant un camion-scène qui irait de village en village. Mais cela nécessitait un piano, un conducteur, et ne pouvait fonctionner qu’en été : ce n’était ni viable ni satisfaisant.
Des propositions pour jouer dans des usines m’ont été faites, mais ce qui me passionnait, c’était l’espace public plutôt que les entreprises privées. Je me suis rendu compte que de nombreuses infrastructures locales — petites salles, granges — pouvaient rassembler les habitants. C’est ainsi que le projet Concerts de Poche est né, dans des territoires ruraux, grâce à la confiance de plusieurs maires.
J’ai imaginé des ateliers où les jeunes créent eux-mêmes, suivis d’un concert, indissociable. Il y a souvent un atelier tout public où n’importe qui peut s’inscrire. Mais pour qu’ils aient envie de s’inscrire, il faut aussi qu’il y ait des ateliers intra structures, soit dans les structures scolaires, soit dans les maisons de retraite ou les foyers ruraux. Sincèrement, ce ne serait pas possible d’avoir beaucoup de mobilisation sur ces groupes tous publics si on n’allait pas à l’intérieur des établissements déjà existants.
Au départ, je travaillais bénévolement, sur tous les fronts : conception, sensibilisation des élus, imagination des ateliers, rencontres… Ce que je voulais, c’était remplir les salles de jeunes, d’enseignants, de familles, partager de grandes émotions collectives, comme dans Les Enfants du Paradis de Marcel Carné. En musique classique, je savais que cela ne pouvait passer que par l’appropriation et la pratique, pas seulement par l’apprentissage du chant ou d’un instrument, mais par la création collective. Les participants aux ateliers en viennent à se glisser dans la peau d’un compositeur, d’un interprète et d’un spectateur. L’histoire, la dramaturgie des sons et l’harmonie qui en résultent sont inventées par des gens qui, avant, n’y connaissaient rien.
Sans les artistes, le projet n’aurait jamais pu prendre vie.
Comment sélectionnez-vous les territoires où vous intervenez, et qu’attendent généralement les collectivités lorsqu’elles vous sollicitent ?
Au début, il a fallu frapper aux portes pour tester l’intérêt des habitants. Puis, le projet s’est développé par capillarité et par la demande des territoires eux-mêmes. Quelqu’un qui avait envie de recevoir la même chose dans sa communauté de communes, il venait voir, ce n’était pas loin, pas cher non plus. C’est vraiment en répondant à la demande qu’on s’est développé.
Nous choisissons nos lieux en fonction de l’engagement réel des acteurs locaux. Nous privilégions les communes où la musique peut fédérer et transformer, plutôt que celles qui veulent simplement accueillir de grands noms comme Natalie Dessay. Nous cherchons des territoires dans une démarche citoyenne et inclusive, où des personnes qui n’auraient pas facilement accès à la musique puissent en être transformées.
Souvent, c’est l’élu qui valide le projet. Il y a plusieurs types d’élus : certains ne s’occupent que d’un certain public, d’autres ont envie de toucher toutes les structures de leur territoire (médicales, sociales, scolaires…). Même si chaque commune n’a pas toutes ces structures, il peut y avoir une dizaine, voire une vingtaine d’établissements sur l’ensemble d’une communauté de communes. Ce que les élus trouvent dans les Concerts de Poche, c’est notre capacité d’itinérance. On peut aller d’un endroit à l’autre, amener ateliers, artistes et musique, puis rassembler tout le monde une fois par an pour un grand concert. Il s’agit d’aller chercher des habitants qui ne viendraient jamais d’eux-mêmes. Ils arrivent un peu hésitants, avec leurs téléphones, mais ils voient leurs proches sur scène dialoguer avec les artistes, et ils s’impliquent à leur tour. On a les familles qui viennent quand les enfants se sont prêtés au jeu, quand un atelier a eu lieu dans la maison de retraite et qu’on fait monter une bonne dizaine de personnes sur la scène, toute la maison de retraite vient applaudir. C’est d’ailleurs assez étonnant de voir à quel point nous devenons un outil pour que ces publics se sentent reconnus par leur municipalité.
Au fil du temps, les institutions nous sollicitent pour atteindre des personnes que leur fonctionnement habituel ne touche pas. Notre approche est très personnalisée, les médiateurs et médiatrices ont une vraie liberté pour proposer des idées sur mesure aux territoires. Cela crée une relation de confiance.
Comment les artistes réagissent-ils lorsqu’ils découvrent les publics et les contextes atypiques des Concerts de poche ? Diriez-vous que vous les embarquez dans une forme d’engagement politique ?
Il y a 20 ans, tout le monde me disait que j’allais dans le mur, avec l’idée que cette musique, si on ne la connaît pas déjà, s’il n’y a pas une éducation, c’est peine perdue. Des musiciens me demandaient ce que je voulais qu’ils fassent devant une classe de collège. Et, ils y ont pris goût, par l’expérience de la rencontre avec l’autre, quel que soit son âge, sa condition, son habitat.
Je pense à Michel Dalberto, habitué des grandes salles, qui a donné un concert dans un hôpital psychiatrique. La salle était pleine, mais pas forcément silencieuse. Une patiente a réagi intensément à la musique, chantant, gémissant… Il s’est produit un dialogue inouï entre ce qu’il jouait et la salle. À partir de là, Michel Dalberto ne s’y est pas trompé, il revient chaque année aux Concerts de Poche, de son fait, pour favoriser ce type de lien.
Ces expériences que nous construisons ont montré que la musique classique pouvait bouleverser autant les publics que les artistes, les élus et les habitudes culturelles.
Quels sont les différents formats ou durées possibles pour vos ateliers, et comment s’adaptent-ils aux besoins des territoires ?
La durée et la forme des ateliers dépendent des moyens du territoire. Le format le plus léger consiste en huit ateliers d’une heure dans huit structures différentes, sur les quinze jours précédant le concert. Les participants créent ensemble une œuvre musicale et apprennent à écouter comme des compositeurs.
Très vite, d’une année sur l’autre, on nous demande des formats plus longs. On organise alors des ateliers de trois à quatre semaines consécutives pour les mêmes participants, et parfois des ateliers de six mois, toutes les semaines, pour les mêmes personnes. De plus en plus de participants souhaiteraient que nos ateliers durent toute l’année. Ce désir est une mesure d’impact concrète, complétée par des enquêtes et études que nous réalisons.
Quel équilibre cherchez-vous entre soutiens publics, privés et engagement des communes ?
Pour qu’un projet se réalise, c’est la municipalité ou la commune qui en fait la demande. En général, elle finance environ 25 % du coût, et il nous revient de trouver les 75 % restants auprès de financeurs publics et privés. La municipalité agit comme déclencheur, puis à nous de mobiliser tous les moyens nécessaires pour que le projet existe et que les artistes soient rémunérés. Finalement, cela crée une mission à la fois artistique, sociale et territoriale. Tout le monde y trouve son compte. C’est crucial que ces trois dimensions restent liées, sinon nous perdrions notre approche inclusive.
Grâce à des partenaires publics, nous pouvons intervenir dans des structures qui accueillent des personnes isolées, en difficulté, et proposer des ateliers gratuits. Par la suite, nous pouvons aussi vendre certaines prestations, mais ce n’est pas l’objectif principal : ces structures ont besoin de leur budget pour d’autres dispositifs quotidiens ou pour l’emploi.
Nous sommes ravis de pouvoir trouver les financements qui permettent de travailler à un très haut niveau musical avec ces publics, puis de les inviter au concert : elles paient entre 3 et 5 €, et si elles montent sur scène, c’est gratuit.
Comment développez-vous l’emploi, et comment aidez-vous les territoires à développer leurs propres ressources et savoir-faire ?
Nous employons des gens du territoire. Pour nous, c’est essentiel de faire travailler des artistes locaux. Nous avons aussi des implantations dans toute la France, avec des équipes permanentes à Reims, Lille, Toulouse, en Ardèche et naturellement en Seine-et-Marne. Les personnes qui mènent les projets viennent donc directement de ces territoires. D’une certaine manière, nous créons ces emplois-là.
Les artistes qui travaillent sur les ateliers sont formés pour rencontrer des publics différents de ceux auxquels ils ont l’habitude de s’adresser. Ce sont souvent des musiciens des orchestres locaux ou des diplômés du CNSM de Lyon et d’autres grandes écoles. Les chefs de chœur dans ces lieux-là veulent un niveau professionnel élevé, mais ils ont aussi besoin que le travail reste stimulant, et non purement alimentaire. Nous les formons donc pour que la création de nouvelles chorales avec des participants très hétérogènes nourrisse leur imagination, leur art, et leur envie. Ce travail influence leur façon de diriger des chorales pour les rendre communicatives, inclusives et accessibles. Grâce à nos chefs de chœur, nous influençons le renouvellement des publics et des pratiques, même pour des répertoires très spécialisés comme la musique baroque, classique, ancienne ou contemporaine. Nous sommes très attentifs au développement du travail des artistes sur le terrain et à la fidélisation de leur public. Pour moi, c’est essentiel de penser dès maintenant à la pérennité des publics dans 5, 10, 15 ans. C’est maintenant qu’il faut anticiper leur existence et leur engagement futur.
Notre intention n’est pas de rester éternellement au même endroit. Après quelques années, nous cherchons à outiller les habitants pour qu’ils puissent continuer le projet sans nous et même explorer d’autres formes que la musique classique. Par la suite, nous pouvons envoyer des artistes ponctuellement ou permettre aux structures locales de travailler directement avec eux. Ce qui nous tient à cœur, c’est d’être un acteur structurant.
Comment les Concerts de Poche peuvent-ils lever des tensions possibles entre différentes structures locales, et recréer du lien entre acteurs ?
Cela demande un vrai doigté. Une de nos valeurs fondamentales, c’est l’écoute mutuelle, que ce soit en externe, ou au sein de notre équipe. Il s’agit de comprendre ce dont chaque partenaire a besoin et en quoi il pourrait être satisfait de collaborer avec un autre acteur local, même si ce dernier l’agace parce qu’il a monopolisé certaines subventions, par exemple.
On se rend compte que certains acteurs devraient être fédérés par leurs directeurs ou élus, mais se retrouvent isolés, chacun dans leur « chapelle », avec leurs propres affinités politiques ou administratives. La municipalité doit nous donner un petit coup de pouce pour mettre ces acteurs autour de la table, et nous jouons alors le rôle de médiateurs. On leur explique que toutes les personnes dont ils s’occupent vont apprendre la même musique, peut-être avec des créations différentes et des ateliers séparés au début, et qu’au moment des répétitions générales, tout le monde se retrouvera. Et la magie de la musique opère toujours. Ce n’est pas nous, c’est vraiment l’art, les artistes et les médiateurs qui s’impliquent pendant les ateliers.
Aujourd’hui, on nous demande même de former des acteurs locaux — pas forcément culturels — pour mener des projets collectifs. Notre objectif est d’écouter et de répondre aux besoins du plus grand nombre, tout en restant exigeants. Il ne s’agit pas de faire un consensus tiède : nous faisons comprendre que ce dépassement de soi est ce qui fait le succès du projet. Les acteurs locaux ont leurs idées, qui ne correspondent pas toujours à celles de leurs voisins ; notre rôle est de réconcilier tout cela.
Il existe aussi cette tension entre le fait de vouloir créer du lien social et, en même temps de rendre un territoire attractif. Par exemple, lors d’un concert avec 200 spectateurs, un élu assez bougon voulait parler au début et dire au public sa déception : « Il y a ici des gens des villages d’à côté, mais combien sont de notre village ? ». Vingt personnes lèvent la main… Puis, Adam Laloum et le quatuor Modigliani jouent, un concert incroyable. À la fin, l’élu reprend la parole : « La prochaine fois, revenez tous ensemble, c’est incroyable d’avoir pu écouter ça avec les villages voisins. Maintenant, vous savez que mon village est attractif. ».
Nous ne travaillons pas volontairement sur l’attractivité, mais cela fonctionne quand même. Les motivations des uns rencontrent celles des autres. Elles ne sont pas toujours idéales, mais la musique peut faire son œuvre à partir de là. Et puis, ce n’est pas forcément mal de vouloir rendre son territoire attractif, tant qu’on ne pense pas qu’à ça.
Vous parliez de l’impact des Concerts de Poche sur les individus. Avez-vous aussi des moyens de mesurer l’impact sur les territoires eux-mêmes ?
Oui, par exemple, dans la petite ville de Saint-Pierre-en-Faucigny, il y a eu 20 % d’inscriptions supplémentaires à l’école de musique. On essaie également de pousser les publics, dès qu’ils sont mordus, à aller voir un artiste sur une scène conventionnée pas très loin, à 3040 km par exemple. On envoie des emails à nos publics pour les inciter à se déplacer et à redécouvrir ces artistes.
Pour ne rien vous cacher, dans les grandes salles parisiennes, l’impact est énorme, car nous avons une base de données très solide en région parisienne et grande couronne. Je pense par exemple à Jonathan Fournel, qu’on connaît depuis qu’il a 15 ans. Au début, il n’était pas évident pour lui de remplir une très grande salle. On a fait une newsletter présentant son concert à Paris, et on a vu un afflux de public jusqu’à 200 personnes supplémentaires ! On utilise ces dispositifs comme un soutien aux artistes. On ne le fait pas systématiquement pour tout le monde, mais, dès qu’un artiste est un peu jeune ou en développement, on peut agir de cette manière. L’année prochaine, beaucoup de spectateurs des Concerts de Poche se retrouveront dans des salles comme la Philharmonie grâce à ce travail.
C’est important pour nous : contribuer à ce lien durable entre les publics et les lieux de musique, et ne pas laisser ça au hasard. Il y a aussi une dimension de duplicabilité : ce qu’on sait faire sous notre égide peut être transmis à d’autres. Nous intervenons dans 370 communes par an, alors que la France en compte 36 000 ! Il y a largement de quoi faire pour tout le monde.
Vers quels nouveaux territoires souhaiteriez-vous développer les Concerts de Poche, et quels types de projets aimeriez-vous renforcer ?
L’expansion à tout prix n’est pas notre objectif. En revanche, il y a un travail de notoriété à mener : certains territoires pourraient bénéficier d’ateliers longs, même si nous n’y sommes jamais intervenus. Nous aimerions pouvoir répondre à ces demandes. Par exemple, nous allons très peu en Bretagne, alors qu’il y a beaucoup de sollicitations. Même chose en Franche-Comté ou dans le Limousin : il y a de la demande, nous aimerions y être.
Pour l’instant, nous intervenons principalement en France métropolitaine. Mais nous commençons à recevoir des demandes transfrontalières. Nous avons déjà réalisé un projet en Belgique, juste à la frontière. L’Éducation nationale souhaiterait beaucoup que nous développions des projets à Mayotte. Les discussions sont en cours. Pour le moment, tout est une question de moyens et de disponibilité des équipes. Nos équipes se donnent énormément sur le terrain et sont souvent débordées. Nous n’avons pas encore la capacité d’aller au-delà de ce que nous réalisons actuellement.
Nous aimerions surtout développer davantage d’ateliers de longue durée. Actuellement, environ 50 % de nos projets incluent des ateliers longs, et notre objectif serait de porter cette part à 80 %.
Nous soutenons aussi de petits festivals qui s’inspirent de notre modèle. Par exemple, Lucie Mercat, violoncelliste du Quatuor Akilone, a créé son festival en Occitanie en s’inspirant de sa première expérience avec les Concerts de Poche à l’âge de 20 ans.
Les Concerts de Poche deviennent comme une marque de fabrique pour d’autres initiatives ?
Ce qu’il faudrait, c’est avoir un label ou quelque chose qui permette aux artistes de dire « j’ai appris au Concert de Poche » et qui, en même temps, contribue à notre communication et à la reconnaissance de notre démarche.
Par exemple, nous avons un modèle d’atelier intitulé Musique en chantier, où l’on crée des petites sonates avec n’importe quel participant. Ce modèle pourrait être labellisé Concert de Poche : il n’est pas difficile à reproduire par les artistes, il faut juste de la formation, de l’aisance à improviser et à inventer, et un médiateur. Si cet atelier portait notre label, ce serait une reconnaissance de notre paternité sur ce modèle. Nous aimerions que les musiciens puissent s’en saisir librement, se former chez nous, puis véhiculer le label eux-mêmes, avec confiance et autonomie.
Nous aimerions que le ministère de la Culture crée un label pour les scènes itinérantes dédiées à la musique. Ce serait vraiment nécessaire, car aujourd’hui, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les gouvernements ou les dispositifs publics. Les grandes structures nationales comme les scènes nationales sont solidement établies, mais des dispositifs comme le nôtre n’ont pas la même pérennité garantie.
Quel pan de votre vision artistique et sociale rêveriez-vous encore de réaliser ?
C’est exactement ma question aujourd’hui. J’aimerais être encore en bonne santé et m’assurer que nous avons bien passé la main pour que tout cela perdure. Depuis un an, j’assure la passation de la direction générale, et je pourrai bientôt me reconcentrer pleinement sur l’artistique. Ensuite, il faudra trouver une nouvelle direction artistique, qui partage les mêmes envies et aspirations. Parmi nos artistes, certains ont bien compris notre vision : il pourrait être utile de créer un comité artistique pour qu’ils continuent de donner le ton.
Par ailleurs, je pense qu’il est important de mettre en place des comités de pilotage pérennes avec les institutions qui nous soutiennent. Le risque, c’est que le projet devienne de la simple vulgarisation, alors qu’il repose sur un engagement profondément humaniste.
Enfin, il reste quelques difficultés logistiques à lever, qui sont liées à l’itinérance dans les zones très rurales. Les populations sont très éloignées les unes des autres et il nous faut des véhicules fiables pour rassembler les participants, ce qui nous manque parfois. Ces obstacles techniques ou matériels nous empêchent d’aller encore plus loin, alors que nous avons les capacités pour le faire.
Propos recueillis par Anna Cuomo et Céline Lugué.