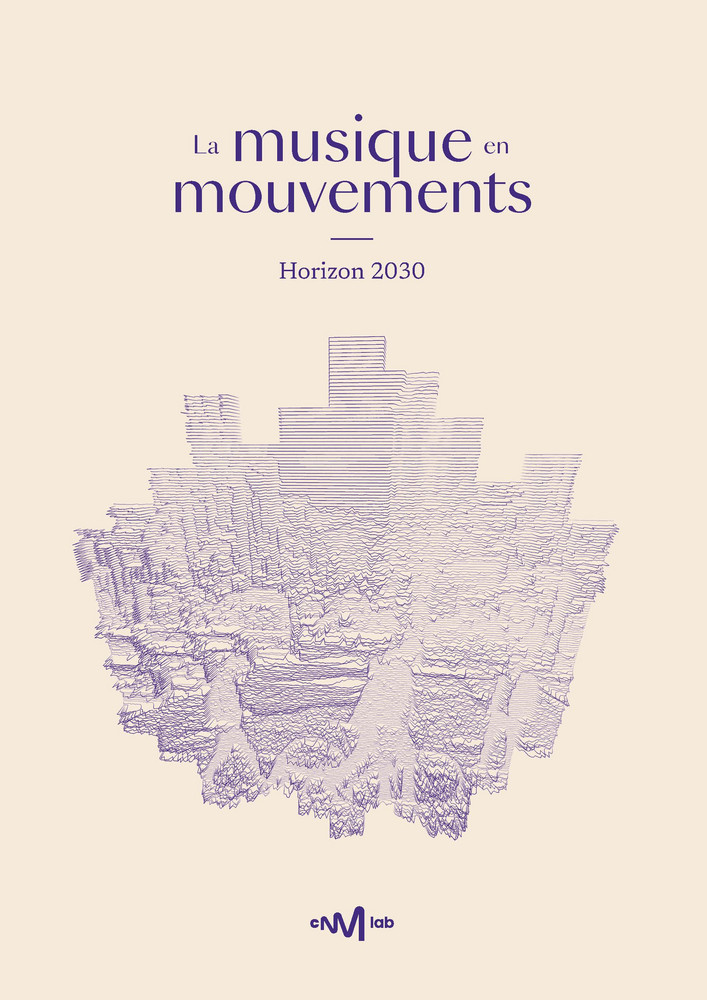Le droit exclusif et l’exploitation numérique de la musique
À l’écoute des voix discordantes
Introduction
Le droit exclusif est au cœur du modèle du droit d’auteur : le droit d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de l’objet protégé – sa reproduction, sa communication au public, sa distribution, etc. – a été notamment développé dans le but d’allouer un pouvoir de marché aux titulaires désignés par la loi qui n’auraient, sinon, pas ou peu de moyens de valoriser leurs créations (dont la reprise est possible à des coûts marginaux presque nuls). En droit de la propriété intellectuelle, le droit exclusif constitue donc un élément fondamental de la négociation contractuelle qui permet au titulaire de décider de l’identité de son cocontractant, mais également de jouir de sa position d’interlocuteur incontournable afin de discuter des termes et conditions de l’exploitation sous un jour qui lui soit favorable.
Dès lors, comment se fait‑il que ce modèle, qui a fait ses preuves, soit contesté par certains depuis quelques années, et que d’autres solutions soient avancées comme des options souhaitables pour l’exploitation de la musique en ligne ? Il convient de comprendre pourquoi, en la matière, les différents titulaires ne parlent pas d’une seule voix.
Un rappel historique s’impose. On assiste depuis les années 1980 à une multiplication du nombre de titulaires de droits de propriété intellectuelle sur un même morceau de musique. Le droit d’auteur fut d’abord reconnu par la loi aux seuls auteurs même si son exercice était essentiellement dévolu aux éditeurs par voie de cession. Au tandem auteur‑éditeur se sont ensuite ajoutés les artistes‑interprètes et les producteurs de « phonogrammes » (soit la fixation de l’enregistrement sonore), dotés depuis la loi du 11 juillet 1985 de droits voisins du droit d’auteur. Par conséquent, l’exploitant doit non seulement négocier avec l’auteur et son cessionnaire en la personne de l’éditeur et/ou auprès des organismes de gestion collective qui les représentent (en France, il s’agit de la Sacem), mais aussi acquérir l’autorisation des différents artistes‑interprètes, souvent nombreux, qui ont participé à la fixation du morceau de musique et du producteur. En pratique, cette négociation n’intervient qu’avec le producteur qui aura préalablement acquis les droits des artistes‑interprètes lors de l’enregistrement du morceau de musique.
La plupart du temps, les artistes‑interprètes ne sont pas associés à la négociation des redevances d’exploitation, ni ne bénéficient (ou de manière très marginale) des profits issus de l’utilisation de leurs prestations dans la musique enregistrée, au‑delà de la rémunération forfaitaire perçue lors de la fixation du phonogramme. L’essentiel des revenus collectés et distribués par les organismes de gestion collective auxquels les artistes‑interprètes apportent leurs droits (en France, l’Adami et la Spedidam) provient des redevances issues de droits à rémunération (la rémunération équitable, la redevance pour copie privée) et non des royalties liées à l’exploitation de leurs droits exclusifs1Selon l’Adami, les sommes distribuées au titre des droits exclusifs représentent environ 11 % de l’ensemble des sommes distribuées (89 % proviennent du droit à rémunération équitable et de la rémunération pour copie privée), en ligne.. Aussi les artistes‑interprètes sont‑ils souvent moins enclins à défendre le modèle du droit exclusif que les autres catégories de titulaires, car ils en tirent moins de bénéfices que des mécanismes alternatifs de droit à rémunération.
Ce constat s’est vérifié à plusieurs reprises ces dernières années ; que ce soit lors de la proposition – non suivie – d’adopter un mécanisme de licence globale pour les échanges de fichiers réalisés par des protocoles P2P (peer‑to‑peer), à l’occasion de l’extension chahutée du champ de la licence légale au webcasting, ou encore à propos de l’établissement d’une rémunération minimale pour le streaming musical. Elle interroge la pertinence du maintien du modèle du droit exclusif dans l’univers numérique pour, d’une part, peser dans les rapports avec les exploitants dominants et, d’autre part, assurer une juste répartition entre les différents ayants droit.
La solution avortée de la licence globale pour le « peer‑to‑peer »
Lorsque les diffusions numériques de la musique se sont développées sur Internet, souvent en violation des droits de propriété intellectuelle, les artistes‑interprètes ont fait entendre une voix dissonante dans le chœur des ayants droit pour rejoindre une alliance avec le public défendant le principe d’une licence globale, en lieu et place de la promotion d’un droit exclusif, accompagné de la sanction de la contrefaçon2L’Alliance public.artistes, en ligne..
Au début des années 2000, actant la diffusion massive de la musique via les échanges peer‑to‑peer de fichiers, les associations de consommateurs comme les organismes de gestion collective représentant les artistes‑interprètes ont imaginé la généralisation des mécanismes de copie privée, c’est‑à‑dire un mécanisme légal de rémunération dont se seraient acquittés les internautes auprès de leurs fournisseurs d’accès en même temps que leur abonnement. Ce paiement, en quelque sorte libératoire pour tous les droits relatifs aux contenus partagés dans un cadre non marchand, aurait permis aux utilisateurs de s’échanger de la musique sans craindre les poursuites en contrefaçon. Comme dans le modèle de la copie privée, les clés de répartition de la rémunération entre les collèges d’ayants droit auraient été fixées autoritairement par la loi, de sorte que les artistes‑interprètes auraient été effectivement assis à la table de la distribution des redevances et non court‑circuités par les producteurs. À la suite de nombreuses discussions, la proposition initiale s’est orientée vers une licence globale « optionnelle »3Thoumyre L., « La licence globale optionnelle : un pare-feu contre les bugs de la répression », RLDI, no 15, 2006, p. 80..
Le projet déplut. Aux fournisseurs d’accès, en premier lieu, qui virent d’un mauvais œil l’imposition d’une charge financière supplémentaire à leurs abonnés au moment où leurs services se développaient, mais également aux autres catégories d’ayants droit qui firent valoir que le système plafonnerait les rémunérations dues aux recettes fournies par la licence globale (le nombre d’abonnés multiplié par le prix de la licence), alors que les modèles fondés sur les droits exclusifs permettaient des modes d’exploitation variés qui accompagnent le succès des œuvres (recettes publicitaires, nombre de téléchargements, etc.), a priori sans limites4Interview de J. Farchy, « La licence globale, c’est une belle idée, mais on risque de créer une usine à gaz », L’Express, le 3 juillet 2013, propos recueillis par Raphaële Karayan : « Cela dit, qu’il faille d’autres modèles, oui. Il y a deux grands choix. Le modèle public, dans lequel ce sont les pouvoirs publics qui fixent le niveau de rémunération global, et les ayants droit ne peuvent alors rien faire pour augmenter la taille du gâteau, ils peuvent seulement se répartir le gâteau. C’est le modèle de toutes les formes de licence globale. Et le modèle marchand, qui consiste à offrir une consommation illimitée contre un forfait, comme sur Spotify. Pour les internautes, c’est a priori presque identique à une licence globale. La différence, c’est que les acteurs du marché ont la main sur le niveau de la rémunération. ». On fit également valoir que la répartition serait complexe et que le dispositif risquait de porter atteinte aux données personnelles des internautes. À la suite d’une procédure rocambolesque – des parlementaires cachés derrière les rideaux surgissant par surprise –, la proposition fut adoptée par l’Assemblée nationale en 2006 au cours du vote de la loi dite DADVSI, puis, par un tour de passe‑passe procédural, fut immédiatement retirée par un nouveau vote écrasant la disposition5Benabou V.-L., « Patatras ! À propos de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 », Propriétés intellectuelles, no 20, 2006, p. 240 ; Coulaud M., « Droit d’auteur et téléchargement de fichiers ou le désaccord parfait ? », RLDI, no 12, janv. 2006, p. 47.. Exit donc la licence globale, même si l’idée fut agitée à nouveau de temps à autre6Caron C., « Questions autour d’un serpent de mer », Communication commerce électronique, no 11, nov. 2009., et notamment par la Hadopi en 2013 lors du lancement d’une étude sur la « rémunération proportionnelle du partage7Étude de la Hadopi du 4 septembre 2014, en ligne. Voir également la bibliographie internationale qui accompagne l’étude. ».
L’extension chahutée de la licence légale au webcasting
La proposition d’un droit à rémunération équitable en lieu et place d’un droit exclusif pour certaines exploitations numériques n’était pas totalement abandonnée. Elle ressurgit lors de la discussion de la loi LCAP en 20168Loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine., quand fut adoptée une disposition visant à élargir le champ d’application de la licence légale, initialement prévue par la loi du 11 juillet 1985 pour la radiodiffusion hertzienne des phonogrammes du commerce, au webcasting9On entend par webcasting la diffusion sur Internet (ici de programmes de radio) selon un principe one-to-many par streaming, à la différence du podcast qui permet à l’utilisateur de prendre connaissance du contenu au moment où il le souhaite, individuellement via un acte de téléchargement..
Le dispositif de la licence légale ne prévoit pas qu’un droit exclusif soit conféré aux producteurs dans le cadre de cette radiodiffusion, mais que ceux‑ci jouissent d’un simple droit à rémunération équitable. Il organise en outre une répartition égalitaire des rémunérations versées à la Société pour la perception de la rémunération équitable (Spré) par les diffuseurs entre les producteurs et les artistes‑interprètes. Le législateur a modifié l’alinéa 3 de l’article L. 214‑1 du Code de la propriété intellectuelle de telle sorte que la licence légale s’appliquerait désormais à tous les services de radio, y compris ceux diffusés sur Internet, à l’exclusion de ceux dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste‑interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d’un même phonogramme. En revanche, dans tous les autres cas, la loi a précisé qu’il incombait aux services de communication au public en ligne de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins et qu’il en allait ainsi « des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d’influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication ».
Là encore, l’adoption du régime ne fut pas un long fleuve tranquille puisque quelques mois après son entrée en vigueur, la disposition fit l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) adressée au Conseil constitutionnel par les organismes de gestion collective des droits des producteurs, à l’occasion d’un recours en annulation d’un arrêté du ministre de la Culture qui en précisait la mise en œuvre10Azzi T., « L’extension aux “webradios” de la licence légale relative aux phonogrammes du commerce est conforme à la Constitution », D. IP/IT, no 11, 2017, p. 591 ; Caron C., « Constitutionnalité de l’extension de la licence légale aux radios sur Internet », Communication commerce électronique, no 11, 2017, p. 30 ; Revial P., « L’extension de la licence légale de l’article L. 214-1 », Juris art etc., no 43, 2017, p. 37.. La question visait principalement à contester l’extension de la licence légale aux services de radio sur Internet, au motif qu’une telle extension constituerait une privation du droit de propriété des producteurs, lequel est constitutionnellement protégé. Il était également soutenu que ces dispositions portaient atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, empêchant potentiellement les titulaires de négocier le montant de leur rémunération.
Le Conseil constitutionnel n’a pas suivi l’argument et a refusé de censurer la disposition litigieuse. Constatant le maintien de l’exigence d’une rémunération équitable pour les ayants droit, il a jugé, dans sa décision du 4 août 201711Décision no 2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et autre (extension de la licence légale aux services de radio par Internet), en ligne.,que « le législateur a entendu faciliter l’accès des services de radio par Internet aux catalogues des producteurs de phonogrammes et ainsi favoriser la diversification de l’offre culturelle proposée au public. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général ». Il a néanmoins jugé utile de préciser que l’extension prévue dans la loi était limitée aux seuls services de radio sur Internet non interactifs, très comparables à ceux de radiodiffusion hertzienne, et que le droit exclusif demeurait, en revanche, de rigueur pour les webradios dites interactives ou semi‑interactives. Selon le Conseil constitutionnel, l’objectif de la diversité culturelle justifiait l’abandon partiel du modèle du droit exclusif, dès lors qu’une rémunération équitable était assurée aux titulaires et que l’utilisation visée n’était pas directement concurrente des formes d’exploitation couvertes par le droit d’autoriser ou d’interdire.
Le délicat partage des revenus du streaming et le respect de la rémunération minimale garantie
La question du caractère équitable des rémunérations issues de l’exploitation de la musique par les services numériques a enfin ressurgi récemment à propos du streaming. En effet, les audiences et abonnements de ces services ont augmenté de manière spectaculaire ces dernières années, si bien que les exploitations numériques représentaient déjà 59 % des ventes de musique en 2019 et 72 % en 202012Onana S., « Le streaming : le bide deal pour les artistes ? », Libération, 22 mai 2020, p. 22. Le PDG de Deezer, Louis-Alexis de Gemini, y faisait le constat suivant : « Deezer a reversé 148 millions d’euros aux producteurs en 2019, soit 15 % à 20 % du financement de la création musicale en France. Mais cet argent ne redescend pas équitablement. Gros comme petits m’interpellent pour me dire : “On n’en voit pas la couleur.” » ; SNEP, « La production musicale française en 2020. Décryptage d’une année pas comme les autres », bilan 2020 publié en mars 2021.. La part croissante des redevances qu’elles ont générées s’est bien entendu confirmée pendant la pandémie, où les sources de recettes liées à l’utilisation de la musique en concert ont chuté dramatiquement. Pour certains artistes, les revenus issus du streaming représentent plus de 90 % des revenus liés à l’exploitation de leurs œuvres, c’est notamment le cas, semble‑t‑il, pour les musiques urbaines13Belgacem I. et Varon C., « Streaming, disque d’or et contrats : enquête sur l’argent du rap », StreetPress, 17 janvier 2021.
Ce véritable bouleversement de la distribution de la musique, désormais opéré par de très grandes plateformes de taille mondiale, a conduit à s’interroger sur le « value gap » entre les différents protagonistes, les ayants droit réclamant une augmentation de la part des bénéfices engrangés par ces plateformes grâce à la diffusion des contenus culturels. Selon l’Adami, la moyenne de la rémunération allouée à l’ensemble des artistes‑interprètes sur un abonnement standard auprès d’une plateforme de musique en ligne à 9,99 euros est de 0,46 euro, ce qui représente donc à peine 4,6 % du prix payé par l’utilisateur14Onana S., « Le streaming : le bide deal pour les artistes ? », art. cité..
Ainsi, en 2015, si pour toucher 100 euros, un artiste devait vendre en moyenne 100 albums physiques, ou générer 250 000 écoutes d’abonnés payants ou encore un million pour les free riders, qui sont les personnes bénéficiant gratuitement etsans abonnement d’un service d’écoute de musique en ligne, en contrepartie de la présence de publicité, ces chiffres n’ont pas évolué substantiellement en 2020, abstraction faite de la disparition progressive de la distribution des exemplaires physiques qui ne permet plus de compter sur l’économie du tangible.
Des voix se sont élevées ces deux dernières années pour dénoncer la faiblesse des montants des rémunérations liées au streaming, en particulier pour les artistes‑interprètes. D’après une étude réalisée par Aepo Artis, l’association européenne des sociétés de gestion des artistes‑interprètes, seul 1 % des artistes perçoit un SMIC grâce aux streams et 90 % reçoivent moins de 1 000 euros par an, même si leurs titres sont streamés jusqu’à 100 000 fois. Des protestations – de la pétition Justice at Spotify aux États‑Unis à celle Broken Records au Royaume‑Uni – et des déclarations spectaculaires d’artistes reconnus tels Ed O’Brien, le guitariste de Radiohead, se multiplient, mettant en cause l’opacité du système et l’aggravation des déséquilibres. L’Adami indiquait que des artistes tels qu’Étienne Daho, Véronique Sanson, Jean‑Louis Aubert ou Benjamin Biolay ne gagnaient que « 300 euros par mois grâce à l’écoute de leur musique en ligne15Adami, « D’amour et d’eau fraîche, saison 14 : à quand une juste rémunération des artistes ? », septembre 2020. ».
Le débat sur le « partage de la valeur » ne concerne pas la simple asymétrie entre, d’une part, les plateformes et, d’autre part, les titulaires de droits de propriété intellectuelle : il traduit des réalités très différentes selon les catégories d’ayants droit et occasionne des disparités entre celles‑ci. La distribution numérique de musique par les plateformes semble aggraver le phénomène de concentration des écoutes sur un très petit nombre d’artistes. Ainsi, le journal Le Monde16Vulser N., « Les précaires du streaming musical passent à la contre-attaque », Le Monde, 9 décembre 2020. Selon le site The Trichordist, Spotify, principale plateforme mondiale avec 144 millions d’abonnés payants, rémunérait les ayants droit à raison de 0,0034 dollar par écoute en 2019. Là où Apple Music se montrait un peu plus généreux avec 0,0067 dollar, suivi par Deezer (0,0056) et Amazon Music (0,0042). Pour YouTube, cette rémunération était de 0,0015 dollar. rapporte que, selon la société d’analyse américaine Alpha Data Music, sur 1,6 million d’artistes dont la musique a été mise à disposition sur les plateformes en 2019, 1 % a capté 90 % des écoutes globales et, parmi ce 1 % d’élus, 10 % ont concentré 99,4 % des écoutes. En d’autres termes 1,44 million de la communauté d’artistes dont la musique est présente sur Spotify, Apple Music ou Deezer ne représente que 0,6 % des écoutes globales.
En ce qui concerne les causes, chacun se renvoie la responsabilité. Les mécanismes de survisibilité de certains artistes seraient imputables aux méthodes de classement et de recommandation existant sur les plateformes tout autant qu’aux stratégies de positionnement des labels sur des genres musicaux plus « vendeurs » que d’autres. Si l’on attribue, en général, la faiblesse de ces rémunérations aux plateformes, ces dernières font valoir qu’elles reversent 70 % de leurs revenus aux labels et aux éditeurs, soit, par exemple, pour Spotify, 4 milliards de dollars par an. Le directeur général Spotify France assure, quant à lui, que son entreprise est dix fois plus rémunératrice que la radio pour les ayants droit17Ibid.. Pour ces plateformes, le problème de la redistribution équitable se situerait donc en aval, au sein des modalités de répartition des revenus perçus par les labels aux autres acteurs de la chaîne.
Alors que plusieurs solutions sont à l’étude pour tenter de minorer les phénomènes de concentration de la valeur, particulièrement pour passer à un système « user centric »18À ce sujet, voir l’étude du CNM publiée en janvier 2021, en ligne. permettant de rémunérer les artistes selon les écoutes effectives de leurs titres effectuées par chaque utilisateur et non au regard de leurs parts respectives dans les écoutes globales, la question de l’intermédiation des labels et de l’association des artistes‑interprètes à la valeur créée reste centrale et les tensions entre différentes catégories d’ayants droit, à ce sujet, palpables.
Sur le plan du droit, la loi LCAP avait, dès 2016, dans son article 10, envisagé un dispositif visant à garantir une rémunération minimale aux artistes‑interprètes, s’agissant de la mise à disposition d’un phonogramme, afin que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux, soit une manière juridique de décrire le streaming. Les modalités de cette garantie de rémunération minimale et son niveau devaient être établis par un accord collectif de travail conclu entre les organisations représentatives des artistes‑interprètes et les organisations représentatives des producteurs de phonogrammes dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi. Elle devait être versée par le producteur aux artistes‑interprètes. À défaut d’accord conclu dans ce délai, la rémunération minimale devait être fixée de manière à associer justement les artistes‑interprètes à l’exploitation des phonogrammes, par une commission présidée par un représentant de l’État, et composée pour moitié de personnes désignées par les organisations représentant les artistes‑interprètes et, pour l’autre moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les producteurs de phonogrammes.
L’accord collectif n’ayant pas été signé dans les délais prévus et la convocation de la commission administrative qui devait prendre le relais pour fixer la juste rémunération des artistes n’ayant toujours pas été réalisée, plus de trois ans après le délai légal, l’Adami a mis en demeure le ministère de la Culture de procéder à cette convocation, menaçant de lui reprocher sa carence devant les juridictions administratives. La procédure n’a finalement pas été conduite à son terme, dans la mesure où les protagonistes ont profité de la transposition de la directive droit d’auteur dans le marché unique du numérique pour fixer un nouveau dispositif de négociation.
L’ordonnance du 12 mai 202119Code de la propriété intellectuelle, ordonnance no 2021-580 du 12 mai 2021., dans son article 12, a ainsi modifié l’article L. 212‑14 du Code de la propriété intellectuelle : désormais, la négociation porte sur des accords spécifiques (et non plus sur des accords collectifs de travail), conclus avec non seulement les organisations professionnelles représentatives, mais aussi les organismes de gestion collective. Un nouveau calendrier a été arrêté, et, dans le cas où aucun accord n’aurait été trouvé dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de l’ordonnance du 12 mai 2021, la commission administrative devra arrêter la rémunération minimale de manière à associer justement les artistes‑ interprètes à l’exploitation des phonogrammes. La nouvelle loi ajoute que la garantie de rémunération minimale prévue doit être proportionnelle à la valeur économique des droits, ce qui n’empêche pas qu’elle soit fixée forfaitairement dans certains cas prévus par la loi.
En revanche, elle ne précise plus que le paiement de la rémunération doive être effectué par les producteurs, ce qui ouvre la possibilité d’un règlement direct de cette rémunération minimale garantie aux artistes‑interprètes par les plateformes, sans l’intermédiaire de ces derniers. Cette revendication de paiement direct est portée par les organismes de gestion collective représentant les artistes‑ interprètes qui souhaitent ainsi assurer un mécanisme effectif et transparent pour que la rémunération minimale garantie, consacrée par la loi dès 2016, soit enfin mise en œuvre.
Conclusion
Tant par les faits préalablement rappelés, qu’au vu des retards accumulés dans la mise en œuvre de la loi, il apparaît que les relations houleuses entre artistes‑interprètes, producteurs et plateformes, quant au partage de la valeur issue de l’exploitation de la musique en ligne, n’ont pas encore trouvé d’issue concluante. Or, les crispations existantes entre les différents acteurs de la chaîne de valeur n’améliorent pas la situation générale des ayants droit dans leur lutte pour conquérir une part raisonnable des bénéfices générés par les plateformes lors de cette exploitation. Dans cette perspective, et pour certaines catégories de titulaires, le droit exclusif apparaît de moins en moins comme une garantie efficace pour atteindre cet objectif.
Une première possibilité d’éviter les effets d’exclusion, appliquée récemment dans le cadre de la transposition de la directive DAMUN (et tout particulièrement des articles 18 à 22), consiste à accroître le rôle que joue l’ordre public au sein des contrats organisant le transfert ou l’exploitation des droits exclusifs. La transplantation de certaines dispositions relatives au droit contractuel du droit d’auteur dans le domaine des droits voisins réduit déjà quelques déséquilibres existants en associant l’artiste‑interprète aux bénéfices d’exploitation par la garantie d’une rémunération « proportionnée » à ces derniers. Limitée de la sorte, la liberté contractuelle ne pourrait plus jouer au détriment de la protection de la partie faible. Il s’agirait alors de ne pas rejeter le droit exclusif, mais plutôt d’entourer son transfert par des dispositions qui préservent les intérêts du titulaire au‑delà de l’acte de cession. Reste que l’expérience de la faiblesse des rémunérations des auteurs au terme de cessions à vil prix n’incite pas nécessairement à l’optimisme.
Un autre système visant à limiter les effets délétères de la liberté contractuelle sur la valeur du droit exclusif pour certaines catégories d’ayants droit consiste à prévoir un droit auquel il ne peut être renoncé. La figure existe à propos du droit de location prévu par la directive 92/100/CEE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur, codifiée en 2006. En son article 4, la directive prévoit en effet que « lorsqu’un auteur ou un artiste‑interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l’original ou une copie d’un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location ». Elle ajoute que ce « droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location ne peut pas faire l’objet d’une renonciation de la part des auteurs ou artistes‑interprètes ou exécutants ». De ce fait, le droit exclusif transféré se transforme en un droit à rémunération équitable dont le titulaire initial ne peut être privé par des dispositions contractuelles contraires. Toutefois, le fait même que le dispositif n’ait jamais été mis en œuvre en droit français, au mépris des obligations de conformité avec le droit de l’Union européenne, révèle que le dispositif présente des fragilités. Il pourrait cependant être activé pour réduire la précarité de la situation du titulaire qui a cédé son droit en dissociant le pouvoir de négociation des mécanismes de rémunération.
Pour tenter d’améliorer ce « partage de la valeur », on peut encore songer à la mise en œuvre de mécanismes administrés dans lesquels la puissance publique joue un rôle de régulation, afin d’éviter que les systèmes de domination ne se reproduisent dans les schémas contractuels en cascade. La fixation de tarifs et/ou de clés de répartition, tels que ceux relatifs au droit à rémunération équitable ou à la compensation pour copie privée, permet effectivement de remédier aux déséquilibres de puissance économique existant entre les différents acteurs de la chaîne, en assurant des flux de rémunération substantiels et équitablement répartis. Toutefois, la longueur des processus administrés de détermination des tarifs, liée à la mise en œuvre difficile de la procédure, au caractère conflictuel des relations entre les protagonistes et, in fine, à l’éventuelle contestation du tarif devant les juridictions, constitue fréquemment un frein à la généralisation de tels mécanismes, malhabiles pour suivre l’évolution des usages et de la technologie.
Entre l’impérieuse nécessité d’harmoniser les positions des différents acteurs de la chaîne de valeur pour améliorer la juste répartition de la richesse produite et la non moins nécessaire obligation de s’adapter à la cadence dictée par la technologie, trouver le bon rythme passe sans doute par le panachage des solutions, ou le passage de l’une à l’autre, sans tabou, lorsqu’il s’avère que le mécanisme éprouvé n’a pas démontré son efficacité au regard de ce double objectif.
- 1Selon l’Adami, les sommes distribuées au titre des droits exclusifs représentent environ 11 % de l’ensemble des sommes distribuées (89 % proviennent du droit à rémunération équitable et de la rémunération pour copie privée), en ligne.
- 2L’Alliance public.artistes, en ligne.
- 3Thoumyre L., « La licence globale optionnelle : un pare-feu contre les bugs de la répression », RLDI, no 15, 2006, p. 80.
- 4Interview de J. Farchy, « La licence globale, c’est une belle idée, mais on risque de créer une usine à gaz », L’Express, le 3 juillet 2013, propos recueillis par Raphaële Karayan : « Cela dit, qu’il faille d’autres modèles, oui. Il y a deux grands choix. Le modèle public, dans lequel ce sont les pouvoirs publics qui fixent le niveau de rémunération global, et les ayants droit ne peuvent alors rien faire pour augmenter la taille du gâteau, ils peuvent seulement se répartir le gâteau. C’est le modèle de toutes les formes de licence globale. Et le modèle marchand, qui consiste à offrir une consommation illimitée contre un forfait, comme sur Spotify. Pour les internautes, c’est a priori presque identique à une licence globale. La différence, c’est que les acteurs du marché ont la main sur le niveau de la rémunération. »
- 5Benabou V.-L., « Patatras ! À propos de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 », Propriétés intellectuelles, no 20, 2006, p. 240 ; Coulaud M., « Droit d’auteur et téléchargement de fichiers ou le désaccord parfait ? », RLDI, no 12, janv. 2006, p. 47.
- 6Caron C., « Questions autour d’un serpent de mer », Communication commerce électronique, no 11, nov. 2009.
- 7Étude de la Hadopi du 4 septembre 2014, en ligne. Voir également la bibliographie internationale qui accompagne l’étude.
- 8Loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
- 9On entend par webcasting la diffusion sur Internet (ici de programmes de radio) selon un principe one-to-many par streaming, à la différence du podcast qui permet à l’utilisateur de prendre connaissance du contenu au moment où il le souhaite, individuellement via un acte de téléchargement.
- 10Azzi T., « L’extension aux “webradios” de la licence légale relative aux phonogrammes du commerce est conforme à la Constitution », D. IP/IT, no 11, 2017, p. 591 ; Caron C., « Constitutionnalité de l’extension de la licence légale aux radios sur Internet », Communication commerce électronique, no 11, 2017, p. 30 ; Revial P., « L’extension de la licence légale de l’article L. 214-1 », Juris art etc., no 43, 2017, p. 37.
- 11Décision no 2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et autre (extension de la licence légale aux services de radio par Internet), en ligne.
- 12Onana S., « Le streaming : le bide deal pour les artistes ? », Libération, 22 mai 2020, p. 22. Le PDG de Deezer, Louis-Alexis de Gemini, y faisait le constat suivant : « Deezer a reversé 148 millions d’euros aux producteurs en 2019, soit 15 % à 20 % du financement de la création musicale en France. Mais cet argent ne redescend pas équitablement. Gros comme petits m’interpellent pour me dire : “On n’en voit pas la couleur.” » ; SNEP, « La production musicale française en 2020. Décryptage d’une année pas comme les autres », bilan 2020 publié en mars 2021.
- 13Belgacem I. et Varon C., « Streaming, disque d’or et contrats : enquête sur l’argent du rap », StreetPress, 17 janvier 2021
- 14Onana S., « Le streaming : le bide deal pour les artistes ? », art. cité.
- 15Adami, « D’amour et d’eau fraîche, saison 14 : à quand une juste rémunération des artistes ? », septembre 2020.
- 16Vulser N., « Les précaires du streaming musical passent à la contre-attaque », Le Monde, 9 décembre 2020. Selon le site The Trichordist, Spotify, principale plateforme mondiale avec 144 millions d’abonnés payants, rémunérait les ayants droit à raison de 0,0034 dollar par écoute en 2019. Là où Apple Music se montrait un peu plus généreux avec 0,0067 dollar, suivi par Deezer (0,0056) et Amazon Music (0,0042). Pour YouTube, cette rémunération était de 0,0015 dollar.
- 17Ibid.
- 18À ce sujet, voir l’étude du CNM publiée en janvier 2021, en ligne.
- 19Code de la propriété intellectuelle, ordonnance no 2021-580 du 12 mai 2021.