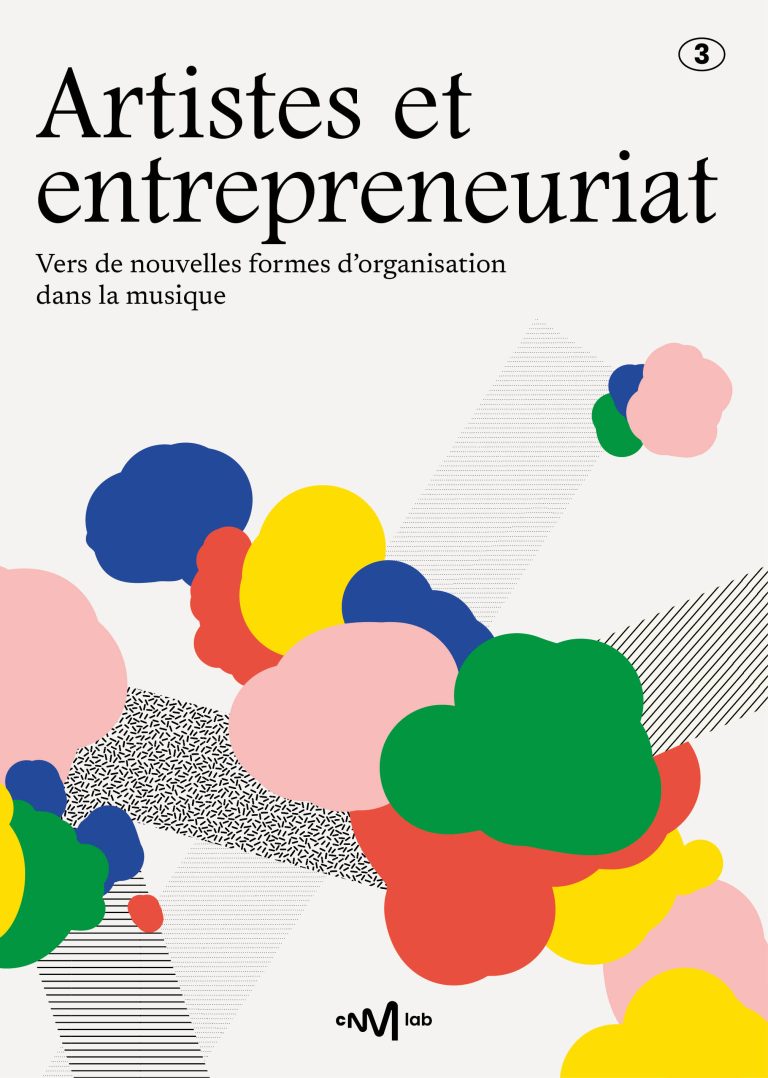La scène punk DIY
Un entrepreneuriat communautaire sur plateforme ?
Introduction
Considérer les punks DIY comme des artistes entrepreneurs et entrepreneuses n’a rien d’évident au regard d’une scène déclarant se tenir à distance des notions de travail musical et de valorisation économique. Pourtant, toute une littérature désigne ces mêmes pratiques DIY comme relevant d’un entrepreneuriat punk[1]. L’idéal de résistance et d’indépendance qu’ils portent est en partie le résultat historique de relations complexes entretenues avec les médias et l’industrie musicale. Le terme « punk » (issu de l’argot anglais signifiant en français « voyou », « pédé », « vaurien », etc.) est d’abord une construction médiatique[2] pour désigner et participer progressivement à faire émerger ce mouvement à l’été 1976. Il est le fruit d’un contexte de crise économique (premier choc pétrolier, chômage de masse, etc.) et des désillusions des hippies. Les punks fustigent un rock de l’époque considéré comme trop mou ou trop savant et revendiquent un retour à des racines idéalisées du rock. Les premiers punks lui préfèrent la simplicité, stipulant qu’il ne suffirait que de trois accords pour sonner authentiquement rock. Leur tendance à refuser la patrimonialisation de leurs œuvres[3] et leur distance vis-à-vis du rôle de musicien témoignent ainsi des rapports ambigus qu’entretiennent les punks dès le départ avec le champ culturel.
Loin de n’être seulement qu’une opération à perte, cette stratégie de rupture a paradoxalement permis à une seconde génération issue de la France des années 1980 de se poser en tant que punk, en s’opposant aux majors. Armés de l’idéologie DIY, les punks français se réinventent autour d’un nouveau « régime de radicalité[4]», en assumant un projet politique par la musique, cherchant à construire les conditions d’une autonomie relative au sein du champ culturel, et impulsent ainsi l’émergence d’une scène rock alternative. Mais au tournant des années 1990, lorsque des groupes comme les Négresses vertes se rapprochent de Warner, que la Mano Negra signe chez Virgin, et que la question de la professionnalisation se pose pour les membres de Bérurier noir[5], une nouvelle brèche se forme. Une génération suivante se radicalise dans ses velléités d’indépendance et donne une conception anti-carriériste du DIY. L’une de ces scènes contemporaines, qui fait l’objet de ce chapitre, se confronte aujourd’hui à la nécessité de diffuser ses œuvres par le biais des grandes plateformes de streaming, remettant ainsi en question leurs valeurs d’autonomie. En France, cette scène peut être identifiée nationalement par la centralité qu’a joué le label Guerilla asso à partir des années 2000, et autour de groupes reconnus tels que Guerilla Poubelle, Nine Eleven et Birds in Row[6].
Le punk s’est structuré dès le début dans ce mouvement perpétuel à la fois de rupture et d’intégration à l’industrie culturelle[7]. Il s’agit donc de replacer la scène DIY dans sa modernité pour comprendre la manière dont elle continue de négocier ses marges de manœuvre artistiques. Ce chapitre suggère d’abord l’intérêt de considérer le punk DIY comme du travail artistique pour replacer les activités de la scène dans le contexte actuel d’une hégémonie des grandes plateformes de streaming payantes. Les punks que nous avons observés ne font pas l’impasse sur les plateformes de streaming, non seulement sur certaines plateformes « alternatives », comme Bandcamp, qui emportent leur adhésion, mais aussi sur des plateformes comme Spotify. Cette étude se concentre sur leur rapport aux plateformes hégémoniques, aux antipodes de l’indépendance radicale qu’ils revendiquent.
La sociologie du travail à l’épreuve du punk, les punks à l’épreuve du travail sociologique
L’état de la recherche en sociologie du travail montre une tendance à voir dans le travail artistique les modes d’organisation du travail de demain[8]. Un ensemble d’éléments concourt à cette hypothèse : « Rapport à l’emploi fractionné, organisation du travail par projet, inégalités de revenu et de réputation à la fois très importantes et considérées comme légitimes, engagement dans l’activité total mais éphémère, appariements sélectifs, incertitude et individualisation du “talent” singulier sont quelques caractéristiques habituelles du travail artistique […] en régime romantico-entrepreneurial[9]. » Le sociologue Pierre-Michel Menger dépeint dans ce contexte l’artiste comme « une figure exemplaire du nouveau travailleur » par son « fort degré d’engagement dans l’activité, autonomie élevée dans le travail, flexibilité acceptée, voire revendiquée, arbitrages risqués entre gains matériels et gratifications souvent non monétaire[10] ». Certains sociologues et économistes ont développé la notion de « gig economy[11] » en s’inspirant directement du fonctionnement de l’économie de la musique. La notion permet de désigner les effets de la numérisation de l’industrie de service incarnée parfaitement par le travail sur plateforme. Celui-ci s’illustre par un mode d’organisation du travail à la tâche, flexible et temporaire puisqu’entièrement calibré selon la fluctuation d’une demande personnalisée. Le contrôle des travailleurs et travailleuses est partiellement délégué aux consommateurs et consommatrices par un système de notation évaluant les compétences sur la base d’une métrique réputationnelle. Du point de vue des punks, ce constat est mis en exergue. Ces derniers produisent et diffusent leurs propres œuvres sans se considérer eux-mêmes comme des artistes producteurs ou productrices, voire même parfois refusent de conférer le statut d’œuvres à leurs productions musicales puisque le travail musical ne doit pas en être un (« punk is not a job[12] »).
Les plus intégrés dans la scène DIY partent pourtant en tournée pour 100 à 150 dates par an, créent en continu des œuvres musicales, et commencent leur carrière tôt avec parfois une longévité de plusieurs dizaines d’années. À ce stade, seul le groupe Birds in Row issu de cette scène a réussi à se professionnaliser malgré la désapprobation de certains, provoquant une ligne de fracture au sein de cette communauté. Une telle posture contradictoire est justifiée par la recherche d’une indépendance à l’égard du « système », principe cardinal du DIY, allant parfois jusqu’à dénigrer la qualité de leur propre musique :
Comme tout le monde est capable de jouer la musique que l’on fait, que ce soit en France ou ailleurs, même les groupes qui sont le plus reconnus musicalement, c’est de la musique de seconde zone, on va pas se mentir[13].
Si Marc Perrenoud et Géraldine Bois montrent que le paradoxe de l’« instabilité permanente » est plus généralement le propre de la condition des « artistes ordinaires[14]», les punks semblent radicaliser le phénomène en allant plus loin dans la mystification de leur propre condition. En d’autres termes, ils poussent plus loin encore les paradoxes intrinsèques au travail artistique[15] en faisant le choix apparent de la pauvreté par vocation DIY[16]. Mais comment de telles carrières peuvent-elles se maintenir tout en faisant l’épreuve de la précarité ?
Cette question redouble de complexité dans le cadre du travail sur les plateformes. Cette nouvelle configuration numérique implique un nombre croissant de mises en ligne d’œuvres phonographiques, et donc une abondance presque gratuite de l’offre musicale : n’importe qui possédant un ordinateur, un instrument de musique et une carte son est dorénavant en capacité de payer pour mettre en ligne ses œuvres et ainsi diffuser ses productions pour trouver potentiellement des consommateurs et des consommatrices[17]. Loin de n’être que de simples intermédiaires, des économistes qualifient les plateformes d’ « employeurs fantômes[18] », révélant la relation de subordination qui lie un employeur ou une employeuse (détenant un capital sous la forme du moyen de diffusion) à un employé ou une employée (mettant ce capital en valeur par son travail artistique). Leur hégémonie s’illustre alors par le poids qu’ils font peser sur le rapport de force entre capital et travail. Ils ont le pouvoir de transformer une part importante des artistes producteurs ou productrices de leurs œuvres en utilisateurs et utilisatrices de plateformes, jouant par conséquent un rôle prépondérant sur l’établissement de critères permettant de faire la distinction entre artiste professionnel (rémunéré) et utilisateur ou utilisatrice (client ou cliente). Les plateformes de streaming, et en particulier Spotify, sont d’ailleurs souvent critiquées pour la tendance de l’algorithme à aggraver la répartition inégale des gains engendrés[19]. En conditionnant l’essentiel de la valeur d’une œuvre musicale à des chiffres d’audience, une petite part des artistes faisant un grand nombre d’écoutes serait en réalité gagnante dans ce fonctionnement[20]. Ce phénomène de massification du nombre de petits producteurs et productrices désormais soumis à une forte concurrence[21] doit être corrélé aux faibles chances de dégager des revenus de leurs productions. Ainsi, percevoir des rétributions économiques de son travail artistique serait un critère de moins en moins pertinent pour définir la catégorie de musicien ou musicienne. La nouvelle configuration du marché culturel en régime numérique n’aurait fait qu’accentuer la tendance déjà observée au début des années 2000 : le nombre de nouvelles entrantes et de nouveaux entrants dans la carrière artistique augmente plus vite que les offres d’emploi permettant de garantir les conditions de travail des artistes[22]. Les promesses de la révolution numérique ne changent finalement pas la situation (précaire) des artistes[23], voire aggraveraient les inégalités.
Cette situation nouvelle nous invite à décrire tout le travail artistique nécessaire que la scène punk institue en amont pour que ses œuvres soient produites et ensuite valorisées dans ce capitalisme de plateforme. Décrire les effets de la plateformisation sur le fonctionnement de ces scènes musicales permet de contribuer à documenter la logique globale d’exploitation commerciale et de prolétarisation des économies informelles. Se concentrer sur les conditions sociales de l’entrepreneuriat culturel le plus précarisé au sein du champ culturel est un prisme de recherche fondamental puisqu’il invite à questionner la capacité de notre système juridique à reconnaître et encadrer ces formes de travail qui se plient mal aux cadres de l’emploi. Rappelons que le statut même de musicienne ou musicien renvoie à des pratiques professionnelles diverses, témoignant de la difficulté à tracer une frontière nette entre un ou une artiste amateur et un professionnel ou une professionnelle[24]. C’est d’ailleurs bien au fondement de l’art de sans cesse reconduire les critères de jugement pour définir la qualité d’une œuvre, et par extension les compétences prétendument nécessaires à sa production. Dans ce contexte de marchandisation des œuvres sur plateforme, le cas du punk DIY constitue ainsi un objet privilégié permettant de mettre en exergue des problématiques causées par cette nouvelle organisation du travail artistique.
Le DIY, entre logique entrepreneuriale et ressources communautaires
Le bricolage d’une économie précaire
Les activités des punks – loin d’être coupées du social dont ceux-ci disent pourtant chercher à s’extraire –, dépendent d’abord de lieux, qu’ils soient associatifs, privés ou subventionnés, pour se produire en concert et travailler leur musique. Les punks ne peuvent pas compter uniquement sur les squats pour jouer. L’état du marché de l’immobilier, les relations de plus en plus complexes avec un voisinage moins tolérant au bruit, et l’imposition de normes d’installation parfois incompatibles avec le fonctionnement des lieux de concert, rendent particulièrement fragiles et éphémères ces lieux qui ne peuvent constituer des solutions viables. Le fait de se situer à la marge de l’emploi reste bien souvent dicté par les contraintes internes au champ culturel. Par exemple, pour qu’un organisateur ou une organisatrice de concerts puisse déclarer l’activité d’un ou d’une artiste et permettre la rémunération de chacun, il ou elle doit obtenir une licence d’entrepreneur de spectacle, s’assurer d’avoir une salle à disposition respectant les normes d’installation et d’accueil du public, payer des cotisations sociales et ainsi ajouter des frais le plus souvent incompatibles avec le modèle économique de la scène DIY :
On ne voulait pas parce que, même si on était une vraie asso loi 1901, on n’avait pas de licence pour organiser des concerts. Et on avait droit à un maximum de six concerts, sachant qu’un concert ce n’est pas un plateau, mais un concert d’un groupe. Donc c’était mort. Et pour avoir la licence, il fallait qu’une des personnes de l’asso ait un bac + 2, sachant qu’à l’époque personne de nous n’avait de diplôme[25].
Les normes juridiques devant encadrer l’emploi du spectacle ne sont pas adéquates aux conditions réelles du travail punk. Lorsque les lieux du punk entrent en conflit avec les intérêts fonciers, ces normes peuvent même servir d’appui pour les préfectures afin de pousser à leur fermeture[26]. Ces musiciennes et musiciens n’ont par conséquent d’autre choix que de redoubler d’inventivité pour répondre à cette double contrainte, notamment en transformant n’importe quel espace pouvant accueillir du public (kebab, skatepark, église, cuisine, etc.) en lieu de concert. Ils sont forcés de chercher des lieux qui se situent hors du cadre juridique du spectacle vivant, et ne peuvent par conséquent faire valoir leurs droits de diffusion.
Les sociétés ayant pour vocation de récolter et répartir les droits d’auteur sont d’ailleurs perçues, non pas comme des organismes protecteurs, mais comme des agents ponctionnant de l’argent sur un travail bénévole : Tous ces trucs de taxes… nous, on ne paye pas la Sacem[27] parce que l’on ne fait que des trucs indépendants, il y a des circuits aussi. Nous, notre circuit est assez protégé des connards [sic], parce que les gens dans ce circuit ont quand même une conscience, une certaine idéologie qui fait que tu ne dépasses pas trop les bornes[28]. Il est à noter que les droits d’auteur, qui par principe individualisent la propriété d’une œuvre[29], rentrent en contradiction avec les valeurs communautaires de la scène – d’autant que les punks ne sont pas bénéficiaires de ce modèle redistributif. Celles-ci tendent à valoriser le caractère « social » du travail musical, qui doit reposer avant tout sur l’effort de chacun à faire exister la scène en participant aux activités DIY.
Pour faire face à ces contraintes, les « carrières DIY » reposent sur le bricolage d’un ensemble de ressources aussi bien privées que collectives. Beaucoup négocient le début de leur parcours avec le soutien culturel et matériel de leur famille. Nombre de musiciens comme Mathis ont troqué, en accord avec leurs parents, des diplômes contre un logement à durée indéterminée pour partir en tournée et l’assurance d’un épanouissement personnel dans la passion musicale :
Nos parents nous ont toujours supportés, ils nous ont toujours dit : « Vous faites ce que vous voulez tant que vous avez vos diplômes.» Nous, on a passé nos diplômes et, une fois qu’on était prêts, on est partis sur la route. On vivait tous chez nos parents, ils ont avancé la thune du premier camion que l’on a cassé dès la première tournée. On a tous des parents qui pensent que l’on a de la chance d’avoir une passion, qu’il faut qu’on se réalise là-dedans[30].
Certains vivent ensuite de petits boulots, à mi-temps, comme celui d’assistant d’éducation, ou bien s’engagent dans la poursuite d’études universitaires généreuses en temps « libre » dédié à leur carrière punk. Cette existence « à la marge » est aussi financée par du travail occasionnel ou par les aides publiques comme le RSA, voire par l’aide du conjoint (le plus souvent d’une conjointe) bénéficiant d’un emploi stable. Ils peuvent ainsi bricoler un mode de vie suffisamment stabilisé pour continuer à travailler en dehors du cadre plus classique de l’emploi salarié, et faire le « choix », largement dépendant de contraintes économiques, d’une précarité plus ou moins contrôlée.
Mais les ressources pour faire face à ces contraintes sont également collectives, puisque le recours à une certaine forme d’« intelligence punk[31] » leur permet de développer des réseaux alternatifs de distribution et de diffusion à l’international. Des circuits de distribution DIY (qui vont de petites et moyennes entreprises jusqu’à des microstructures sans reconnaissance juridique) structurent la scène. Guidés par une même éthique de l’entraide, les punks se coordonnent autour de formes d’auto-organisations. Elles consistent à pratiquer simultanément les activités musicales et de soutien[32] aux pratiques artistiques (création de label et de fanzine, organisation de concerts, booking, etc.), permettant ainsi d’éviter les coûts engendrés par le recours à des intermédiaires devenus inutiles. Par exemple, dans le cas de la production de vinyles, ce marché très restreint fonctionne sur la base de relations de cooptation par socialisation des coûts en faisant appel à l’entraide d’un nombre important de microlabels. Par ce système de cofinancement, ils rendent ainsi compatibles avec leur budget les frais de production et de distribution, tout en assurant un réseau de distribution optimal. Le système de « distro » (distribution) favorise la circulation des œuvres et la structuration d’une économie basée sur l’échange de vinyles. Ces formes organisées de la vie contre-culturelle sont dirigées par des passionnées et des passionnés – souvent des musiciennes et des musiciens – désireux de contrôler l’ensemble des activités de production, de diffusion et de promotion de leurs œuvres. Elles sont en majorité autofinancées et déficitaires, ce qui les rend fragiles et éphémères. La scène punk est par conséquent structurée autour d’un ensemble d’activités coordonnées autour d’une organisation par projet. Elle agrège une multiplicité de tâches et de collaborations temporaires autour de la diffusion et de la distribution d’une œuvre et demande donc une adaptation et une flexibilité constantes.
La dimension «morale» de l’économie punk
Cette forme d’organisation n’est pas le propre des punks, mais relève plus largement du régime « normal » de l’activité des artistes[33]. Cependant, ils en font un levier idéologique suffisamment puissant pour susciter le travail bénévole des membres de la scène, sans qu’aucun contrat n’ait besoin d’être signé. En effet, puisque l’engagement dans ce régime d’activité ne peut être motivé par la recherche de gains financiers, il doit faire appel à des ressources culturelles et communautaires. C’est sur la base d’un consentement commun aux valeurs DIY qu’ils entretiennent collectivement une confiance mutuelle dans le jeu social punk. Le champ artistique repose sur une économie inversée dans laquelle la réussite ne se mesure pas, du moins pas directement, au succès financier attaché aux œuvres. La part symbolique de cette économie se veut justement être antiéconomique puisqu’elle repose sur la croyance en un jeu social émancipé des lois de l’argent (l’art pour l’art[34]). Sauf qu’une fois encore, les punks repoussent plus loin ce principe de désintéressement propre au champ culturel, en faisant du DIY l’expression d’un désintérêt pour la pratique musicale elle-même. Ils entretiennent collectivement une croyance selon laquelle l’activité de soutien aux pratiques artistiques détermine avant tout l’engagement dans la scène.
Le DIY est donc un principe idéologique structurant l’identité et les actes punk, permettant de convertir le travail artistique et les rapports sociaux qui l’organisent sous forme d’entraide.
En guise d’exemple, songeons à l’organisation de concert, qui met en place un système d’échange entre un organisateur ou une organisatrice locale (souvent musicien ou musicienne) et un autre musicien ou une autre musicienne désireux de jouer dans une ville. Les deux sont liés par un contrat moral et implicite stipulant que les rôles devront dans le futur être inversés (celui ou celle qui organise le concert devra à son tour être accueilli en tant que musicien ou musicienne dans la ville de l’autre). Cette chaîne de générosité permettant de dépasser (en partie) les contraintes financières est structurée par une logique de don et de contre-don, elle-même soutenue par la confiance commune sur le bien-fondé d’un tel fonctionnement. En principe, plus les punks sont reconnus pour leur respect des principes DIY, plus ils sauront capter l’adhésion généreuse d’autres membres de la scène. Ce qui s’échange, ce sont des dettes économiques (l’organisation d’un concert est souvent déficitaire), contrebalancées par le respect acquis au regard des valeurs partagées du DIY et qui pourra potentiellement dans le futur être converti en gain économique (plus on est reconnu, plus le public sera présent aux concerts). En cela, ils ont développé une « économie bigarrée[35] » puisqu’ils maintiennent et reconduisent sans cesse une tension entre nécessités financières objectives et valeurs communautaires contradictoires. Car les valeurs du DIY contiennent en elles-mêmes leurs propres contradictions : la première consiste à « ne pas attendre des autres ce que l’on peut faire soi-même[36] », autrement dit à croire en la possibilité de gagner son indépendance grâce au mérite de la volonté. La seconde revêt une dimension collective et horizontale, soulignant la volonté de réduire la frontière entre les musiciennes, les musiciens et le public, et donc valorise la capacité de chacun à « faire vivre la scène[37] ». La logique veut que la recherche affichée de succès soulève toujours la suspicion de profiter de la générosité des autres par opportunisme. Ce discours et ce mode d’organisation rappellent fortement celui des plateformes de streaming décriées pourtant par ces punks, à ceci près que ces derniers réalisent un travail idéologique qui se distingue en incorporant une critique de la valeur marchande attachée à la musique.
Les punks face aux plateformes
L’inscription visible des punks dans le capitalisme mondialisé
Un ensemble d’éléments a participé à changer la donne au tournant des années 2000. L’arrivée d’Internet dans les foyers occidentaux et le développement des TIC (technologies de l’information et de la communication), ainsi que la démocratisation de l’accès aux supports d’écoute avec la possibilité de télécharger les nouveaux MP3, ont eu un double effet. D’abord celui de favoriser le développement de publics de niche dans le monde entier et ensuite la possibilité pour un plus grand nombre de musiciens punk de tourner à l’international :
Ça a énormément changé. Internet a permis de fluidifier et d’accélérer. Avant tu envoyais tes démos par voie postale, [c’était une organisation très lourde.] Quelque part, pour le DIY, Internet c’est génial. Tu peux contacter un label américain en ligne directement[38].
Cette logique d’expansion a également été favorisée par une politique globale d’ouverture des frontières européennes permettant aux artistes de se produire dans l’ensemble de l’espace Schengen sans avoir recours aux lourdeurs administratives et autres inconvénients rencontrés auparavant sur la route. Cette nouvelle configuration sociotechnique a également vu de nouvelles fractures intergénérationnelles émerger. Certains des nouveaux aspirants à la carrière punk et désireux de se faire connaître ont trouvé dans Internet la possibilité de mettre leurs morceaux gratuitement à disposition du plus grand nombre. D’autres aux positionnements plus établis voyaient dans cette accessibilité grandissante le risque d’une dévaluation de leur musique. Cette situation a été favorable à l’émergence d’une nouvelle génération de groupes (tels que Guerilla Poubelle) ayant reconduit cette croyance en une reconnaissance punk qui ne peut également s’acquérir que « par accident », puisqu’elle ne doit pas être recherchée.
Mais, rapidement, un nouveau marché culturel s’ouvre à l’international, mettant localement en concurrence des musiciens DIY pour trouver des lieux alternatifs où se produire. Ce phénomène se déporte également sur la scène virtuelle, poussant les musiciennes et musiciens à chercher une audience en multipliant leur présence sur diverses plateformes numériques :
Aujourd’hui tu ne peux pas avoir de groupe sans avoir de page Instagram, mais ça ne t’apporte rien de concret. Peut-être que ça va te permettre d’avoir un ou deux concerts, mais globalement ça ne sert à rien et les SMAC te diront que c’est obligatoire, et ce discours institutionnel va aussi guider les pratiques et tes choix créatifs[39].
Les fermetures de plus en plus récurrentes des espaces alternatifs au sein des grandes villes et la saturation des canaux de diffusion déportent numériquement et sur un plan individuel les enjeux de visibilité. Exister en tant qu’artiste, issu du DIY ou des circuits plus institutionnalisés, passe nécessairement par un travail d’entretien d’une identité numérique. Produire et diffuser ses œuvres sans faire un travail d’autopromotion en ligne leur semble aujourd’hui inenvisageable, quand bien même certaines plateformes imposent leurs propres contraintes avec lesquelles ils disent être en désaccord. Le pouvoir de ces intermédiaires est également symbolique, puisqu’ils déterminent aussi les standards du musicien ou de la musicienne professionnelle :
On se retrouve à la frontière anglaise pour aller jouer à l’ArcTanGent festival, et là le douanier ne veut pas nous laisser rentrer parce qu’il faut prouver qu’on est un groupe professionnel. Et comment tu veux le faire si tu n’es pas sur Spotify ? Bah non, tu n’es pas pro[40].
Rares sont les groupes issus des musiques actuelles comme celui de Théo à avoir refusé de diffuser leur musique sur les plateformes de streaming payantes. Comme il le dit lui-même dans le cadre de sa carrière musicale dans le groupe BRUIT≤[41], cette démarche équivaut « à se tirer une balle dans le pied ». Pour les autres, ils n’ont d’autres choix que d’avoir recours à l’euphémisme pour expliquer les effets contradictoires que viennent mettre à jour leur inscription sur ces réseaux, un mal nécessaire avec lequel négocier sa crédibilité :
Oui ça me fait bien chier [sic]. Sauf que tu ne peux pas faire sans car tu es en communication avec tout le monde et puis tu as d’autres trucs cool, car c’est par les réseaux sociaux que tu apprends que machin va sortir en avant-première tel morceau et que le disque est sorti. Aussi bien quand c’est moi qui l’utilise que lorsque c’est les autres autour de moi. Même Instagram, je l’avais supprimé et je l’ai réinstallé car je l’utilise pour le label et pour l’orga[42].
Je m’engage avec des groupes au niveau du label, je le fais aussi pour apporter quelque chose au groupe, je ne veux pas être un frein. Je suis un peu obligé de le faire[43].
Ces bouleversements structuraux affaiblissent les ressources culturelles et subjectives que construisent les punks pour faire communauté. Ils n’ont d’autres choix que d’opérer un déplacement idéologique pour résoudre cette dissonance, donnant une définition plus individualisée et entrepreneuriale aux valeurs DIY : Quand tu viens du DIY, tu as la niaque ! Si tu viens du DIY, c’est que tu t’es construit tout seul et que tu as réussi[44].
Ce n’est plus tant à la recherche de l’égalité et de l’entraide en opposition à un monde jugé inique qu’ils disent s’employer, puisqu’ils en sont désormais partie prenante aux yeux de tous. Ils disent plutôt entreprendre coûte que coûte la quête d’une passion personnelle. Cet argument se marie mieux avec les nouveaux compromis qu’ils doivent faire. Pour prouver leur désintérêt de toute poursuite carriériste, il leur faut paradoxalement être prêts à poursuivre une carrière à perte et ainsi valoriser une sorte de mérite DIY. Des années passées dans la précarité deviennent le prix à payer pour pouvoir évacuer toute critique d’opportunisme et justifier l’insertion dans des contraintes sociales et économiques avec les acteurs et actrices du milieu professionnel : Dans notre scène, si tu mets beaucoup d’effort dedans, les gens se disent : « Ils essayent, ils mettent du cœur, ils sont passionnés.» Tu vois un groupe comme Hexis, qui ne sont pas forcément plus reconnus que ça en soit, mais les gens sont là : « Putain ils font cent dix dates d’affilé [45] ! ». Déjà tu as ce premier niveau de reconnaissance-là, je ne sais pas si on peut dire que c’est de la méritocratie, il y a quand même ce délire « en même temps si tu ne fais rien, on ne va pas s’occuper de toi ». Il faut que tu te bouges le cul [sic] pour avoir cette forme de reconnaissance. Après t’auras toujours le truc du « Tu peux jouer n’importe où » quand tu es dans notre milieu, même si tu es un petit groupe et que tu commences. Mais l’attention des gens va se porter plus facilement sur toi s’ils voient que tu es là très régulièrement et que tu envoies du pâté au niveau des dates. Je pense que c’est le premier point qui nous a fait connaître et donné accès à Deathwish après[46].
Dans ce contexte, l’authenticité punk relève moins de la volonté désintéressée pour faire valoir un projet politique porté vers l’entraide, qu’à l’effort de volonté nécessaire pour construire et développer soi-même son projet artistique en proposant ses propres créations, et espérer paradoxalement arriver à les imposer au sein du marché culturel :
Le côté politique que certains groupes peuvent avoir dans des discours qui sont contre une société capitaliste, je peux le comprendre. Après je pense que si tu décides que [avec] ta façon de travailler tu ne vas pas en vivre et que tu fais ça pour le plaisir ou pour prêcher ta parole et rencontrer des gens et échanger, c’est tout à ton honneur. J’ai plein de potes qui sont comme ça et qui font ça pour le sport. Je pense que c’est un état d’esprit de la scène punk rock, mais je pense que les deux ne sont pas éloignés, mais [c’est] juste un discours différent. Le fait que cette scène soit hyper politisée c’est ça qui fait la différence entre mon état d’esprit et le leur. Le DIY, c’est : « Fais-le toi-même, n’attends pas de la société qu’elle t’aide à faire ce que tu aimes.» Lorsque j’ai commencé à organiser des concerts, le DIY c’était avant tout faire avec les autres et construire quelque chose ensemble sur une base qui soit politique ou passionnelle dans la musique [47].
La plateformisation des réseaux DIY : Le cas de Deathwish
Le cas du label américain Deathwish[48] est particulièrement intéressant en ce qu’il permet d’analyser la manière dont tout un réseau de distribution s’est structuré dans cette nouvelle configuration numérique. Le label est avant tout un nom. Il représente un gage de crédibilité pour les amateurs de hardcore. C’est donc une entreprise de services qui repose sur une relation de confiance mutuelle avec les artistes, mais aussi avec les consommateurs et consommatrices désireux d’acheter une œuvre à la hauteur de leurs attentes musicales. Le label donne une légitimité aux groupes de son catalogue, il constitue également une interface avec le reste des acteurs et actrices du monde punk. En 2012, Deathwish contacte le label français Throatruiner (alors label principal de Birds in Row[49]) afin que ce dernier fasse partie de son roster, c’est-à-dire de son catalogue de groupes à promouvoir. C’est ainsi que le groupe français Birds in Row signe[50]sur le label et franchise Throatruiner aux alentours de 2019. La France devient ainsi l’endroit où implanter sa plateforme principale de distribution européenne. Il faut également noter que seuls deux groupes européens font actuellement partie du roster, les autres étant pour la plupart américains. Le label fait aussi office de banque en avançant les fonds nécessaires au financement de la production de vinyles, au merchandising et à la promotion des groupes de son roster. Plus précisément, Deathwish a la charge de l’édition des œuvres sur un plan numérique, puisque les royalties sont réinjectées directement par le label dans la promotion et la production du merchandising des groupes.
Mais la rémunération dégagée des plateformes de streaming n’est pas suffisante, les groupes doivent s’engager à rembourser le label en devenant le revendeur principal du merchandising. Dans la mesure où la partie la plus importante des ventes de vinyles se fait pendant les concerts, les labels se tournent vers des groupes qui ont démontré leur capacité à endurer régulièrement de longues tournées en mobilisant un public suffisamment présent pour s’assurer le plus rapidement d’écouler leurs stocks et ainsi de garantir la viabilité de leur modèle économique :
Ça fait dix ans que l’on tourne partout dans le monde […]. La chance que l’on a eu quelque part d’évoluer dans ce milieu-là, c’est que l’on a quand même une base ultrasolide de gens qui nous connaissent. Ils nous suivent depuis longtemps, ils nous ont vus littéralement jouer dans des salles aussi petites que ça. Du coup, ils ont un rapport réel avec nous qui n’est pas juste basé sur une hype [un effet de mode] ou un truc comme ça […]. C’est beaucoup plus intéressant de travailler avec des artistes qui ont une progression constante. C’est solide, ils ont un cap, ils y vont et ils ramènent toujours un petit peu plus de monde. Et nous, on est plus dans ce schéma-là[51].
Or, la tendance actuelle des labels à signer des artistes qui ont déjà une certaine audience[52] touche également les labels indépendants. Il y a donc une nécessité pour les artistes d’étendre eux-mêmes leurs réseaux de distribution et de diffusion afin de toucher de potentiels amateurs et amatrices de musique. Deathwish participe ainsi activement à la reconnaissance des artistes en s’appuyant sur des collaborateurs et collaboratrices de confiance, choisis selon leur réputation. Faire entrer un groupe dans le catalogue revient à pérenniser un lien de collaboration et relève d’un investissement à long terme. Le choix doit donc s’orienter vers des groupes peu susceptibles de rompre ce lien avant que les coûts engendrés par cette collaboration ne soient rentabilisés.
Le label a également acquis au fil du temps un rôle central au sein d’une constellation d’autres structures de différentes tailles. Au moment de la signature chez Deathwish, Birds in Row collaborait déjà avec le label Throatruiner, qui était bien implanté dans le réseau de microlabels et groupes de musique de cette scène, mais aussi avec diverses usines de merchandising, parmi lesquelles Useless Pride, usine toulousaine de sérigraphie tenue par des membres de la scène. Le responsable de Throatruiner loue à Useless Pride une partie de l’entrepôt afin de stocker les vinyles destinés à l’envoi, il est donc un acteur fiable sur lequel Deathwish peut compter pour étendre ses réseaux de distribution en Europe. Deathwish délègue en 2016 la distribution de ses propres vinyles à Throatruiner, et franchise cette activité pour devenir l’antenne européenne de Deathwish, tout en gardant l’exclusivité pour une partie de ses activités ainsi que le nom du label. Useless Pride devient alors par l’intermédiaire de Throatruiner une antenne de stockage de distribution et de production de merchandising pour Deathwish. L’intérêt, pour le label américain, est également de privilégier les circuits courts, c’est-à-dire de diminuer ses coûts de production en faisant appel à des usines européennes, ce qui revient à limiter les importations coûteuses en frais de port. De son côté, le label américain Deathwish a su profiter du réseau de Throatruiner pour se transformer en l’une des plateformes incontournables de distribution de hardcore à la fois aux États-Unis et en Europe. Par l’intermédiaire de Throatruiner, il propose également un service en matière de dépôt, de revente et d’achat, auprès de n’importe quel microlabel. Ce faisant, Deathwish devient un opérateur incontournable dans la circulation de la musique hardcore DIY, en contrôlant les flux tout en laissant les acteurs négocier directement leurs échanges commerciaux.
Par conséquent, la scène DIY repose sur un réseau de microlabels indépendants qui collaborent de façon sporadique avec de plus grosses structures, lesquelles ont su agencer des formes de synergies, tout en donnant le sentiment de respecter une forme d’éthique propre à la scène DIY.
Notons que le label Deathwish, n’ayant pas encore la capacité de gérer entièrement son réseau de distribution, a signé en 2016 un partenariat avec ADA, le distributeur qui se présente comme alternatif et indépendant, mais qui appartient en réalité à la major Warner[53]. Si, depuis, le label a autonomisé sa distribution, cette ancienne interdépendance avec les majors montre que des enjeux économiques extérieurs conditionnent l’organisation de la scène punk, notamment en générant une logique de maximisation des échanges de biens culturels. D’une certaine manière, « l’écran », constitué par le jeu des appartenances, permet aux acteurs et aux actrices de conserver l’illusion d’un fonctionnement obéissant à des règles qui fondent l’indépendance de la scène DIY. La description des liens entretenus entre la major Warner et les labels de la scène DIY par le biais de l’usine Useless Pride et du label américain Deathwish permet de voir comment la scène DIY s’ancre dans la réalité des échanges, sinon de la mondialisation, loin du mythe de l’indépendance. Cette « récupération indirecte » par les industries culturelles fait peser des contraintes économiques sur tout un réseau alternatif, y compris sur les structures les plus déficitaires qui le composent. Ces contraintes matérielles obligent les groupes à prendre en main la gestion de leur visibilité numérique et à rediriger une partie de leurs activités vers l’organisation de leurs propres concerts pour espérer accroître leur présence sur scène et ainsi rembourser les frais engendrés. Le DIY prend un tout autre sens puisqu’il vient justifier idéologiquement un productivisme culturel à perte, mais faisant l’objet d’une valorisation marchande dans une situation de précarisation du travail culturel.
Conclusion
Quels sont les effets de la plateformisation du travail musical sur les petites économies culturelles telle que la scène punk DIY ? Nous en constatons deux : premièrement, les punks DIY ne sont pas bénéficiaires de l’exploitation de leurs propres œuvres par ce nouvel intermédiaire et sont le plus souvent déficitaires pour continuer leurs activités. Deuxièmement, le fonctionnement de notation des plateformes fixe la valeur d’une œuvre à son nombre d’écoutes, et rentre ainsi en contradiction avec la portée « collective » que donne la scène DIY à sa musique. Ainsi la plateformisation, forme moderne de la marchandisation, semble moins constituer une opportunité pour les punks de monnayer leurs œuvres qu’une prolétarisation de leurs conditions de travail et un affaiblissement des ressources communautaires sur lesquelles ils se reposent pour justifier leur présence dans la scène et donc leur capacité à faire communauté.
Dans ce contexte, l’effort collectif typique des punks pour composer entre ces deux logiques contradictoires, celle qui consiste à s’inscrire dans une économie marchande et celle qui cherche à rompre avec cette dernière, n’est plus tenable. La scène DIY est une forge entrepreneuriale déniant du même coup toute recherche personnelle de valorisation économique, voire artistique, contrairement au modèle imposé par ces plateformes. Mais, si les punks procédaient déjà auparavant à l’invisibilisation de leur propre travail artistique, l’extension visible de la sphère marchande par ces intermédiaires extérieurs contrevient directement à l’illusion d’indépendance pourtant nécessaire à l’engagement dans la carrière DIY. Cette indépendance est fictive, mais ils doivent tout de même y croire pour tracer collectivement une frontière plus idéologique que concrète, permettant de distinguer le périmètre de la scène DIY de celui des mondes professionnels de la musique. Ils se retrouvent alors dans l’incapacité de justifier les conditions matérielles précaires par lesquelles ils s’inscrivent dans le champ culturel, au nom de l’indépendance, soit de la liberté de ne pas en être.
Enfin, les employeuses fantômes que sont les plateformes tendent à atomiser les travailleurs de la culture en imposant des conditions de travail renvoyant les musiciennes et les musiciens à leurs propres capacités individuelles à se maintenir dans la carrière. Cette étude témoigne aussi en creux de tout le « travail gratuit[54] » sur lequel repose une industrie musicale. Reste à savoir comment les punks arriveront à reconstruire une nouvelle radicalité qui passe l’épreuve de ces nouvelles contraintes.
[1] HEIN F., « Les fondements culturels de l’action entrepreneuriale. L’exemple des labels punk rock», Revue française de socio-économie, vol. 1, n° 16, 2016, p. 183-200 ; HAENFLER R., « The entrepreneurial (straight) edge. How participation in DIY music cultures translates to work and careers», Cultural Sociology, vol. 12, n° 2, 2018, en ligne : doi.org/10.1177/ 1749975517700774.
[2] ROBÈNE L. et SERRE S., « Le punk est mort. Vive le punk ! La construction médiatique de l’âge d’or du punk dans la presse musicale spécialisée en France », Le Temps des médias, vol. 27, n° 2, 2016, p. 124-138, en ligne : doi.org/10.3917/tdm.027.0124 ; GUIBERT G., « 1972, les débuts du mouvement punk rock ? L’impact décisif du rock critic Lester Bangs des deux côtés de l’Atlantique », dans P. Poirrier et T. Le Texier (dir.), Circulations musicales transatlantiques au XXe siècle, Des Beatles au hardcore punk, Dijon, Presses universitaires de Dijon, 2021.
[3] RABOUD P., « La patrimonialisation du périssable : le punk comme archives », Tétralogiques, n° 24, 2019, p. 95-110.
[4] ROBÈNE L. et SERRE S., On stage, Backstage. Chroniques de nos recherches en terres punk, Paris, Riveneuve, 2021.
[5] HUMEAU P., À corps et à cris. Sociologie des punks français, Paris, CNRS éditions, 2021.
[6] Cette liste n’est évidemment pas exhaustive, et, bien que ces groupes recouvrent des esthétiques musicales différentes issues du punk (punk hardcore, hardcore, screamo, post- hardcore, etc.), les relations entretenues entre ces membres permettent de les identifier en tant que groupe social. Le recours à différents sous-genres du punk dans cet article témoigne de la difficulté à identifier cette scène autour de genres musicaux stabilisés. Pour une description de la méthodologie de délimitation de terrain, voir ROUX M., Faire « carrière » dans le punk. La scène DIY, Paris, Riveneuve, 2023.
[7] ROBÈNE L. et SERRE S., « À l’heure du punk ! Quand la presse musicale française s’emparait de la nouveauté (1976-1978) », Raisons politiques, vol. 2, n° 62, 2016, p. 83-99, en ligne : doi.org/10.3917/rai.062.0083.
[8] BOLTANSKI L. et CHIAPELLO È., Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999 ; MENGER P.-M., Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Paris, Seuil, 2003.
[9] BATAILLE P. et PERRENOUD M. (dir.), « Back to work! Introduction », Volume !, n° 18-1, 2021, p. 8.
[10] MENGER P.-M., op. cit., p. 8-9.
[11] GANDINI A., « Labour process theory and the gig economy», Human Relations, vol. 72, n° 6, 2019, en ligne : doi. org/10.1177/0018726718790002, p. 1-18.
[12] « Punk Rock is not a job » est le titre issu de l’album Punk = existentialisme de Guerilla Poubelle reconnu par lascène DIY française.
[13] Entretien avec Alban, visioconférence, 21 janv. 2019.
[14] Entretien avec Mathis, Void, Bordeaux (33), 17 nov. 2018.
[15] PERRENOUD M. et LERESCHE F., « Les paradoxes du travail musical. Travail visible et invisible chez les musiciens ordinaires en Suisse et en France », Les Mondes du travail, déc. 2015.
[16] THREADGOLD S., « Creativity, precarity and illusio. DIY cultures and “choosing poverty” », Cultural Sociology, vol. 12, n° 2, 2017, en ligne : doi.org/10.1177/1749975517722475.
[17] En 2020, selon le rapport de Recording Industry Association of America, les plateformes de streaming ont généré 83 % des revenus de l’industrie musicale, alors qu’elles ne dépassaient pas les 25 % en 2015. Entre 2004 et 2013, le total des échanges de biens et services culturels rapporté à l’ensemble des échanges mondiaux a généré un montant global d’environ 213 milliards de dollars US.
[18] FRIEDMAN G., « Workers without employers. Shadow corporations and the rise of the gig economy », Review of Keynesian Economics, vol. 2, n° 2, avr. 2014, p. 171-188, en ligne : 10.4337/roke.2014.02.03.
[19] FARCHY J., « Les enjeux de l’IA dans l’industrie musicale », dans La musique en mouvements. Horizon 2030, Paris, Éditions du CNM, 2022, p. 19, en ligne : cnmlab.fr/recueil/horizon-la-musique- en-2030/chapitre/3.
[20] Ainsi, « à partir d’avril 2024, les titres [doivent] avoir atteint un seuil d’au moins 1 000 écoutes dans les 12 derniers mois pour être inclus dans le calcul du fonds de royalties pour l’enregistrement de musique » ; voir le site de Spotify for artists : https://support.spotify.com/us/artists/article/track-monetization-eligibility/.
[21] KLEIN B., MEIER L. M. et POWERS D., « Selling out. Musicians, autonomy, and compromise in the digital age », dans Popular Music and Society, vol. 2, n° 40, 2017, p. 222-238, en ligne : doi.org/10.1080/03007766.2015.1120101.
[22] RANNOU J., « Les métiers artistiques du spectacle vivant et leurs catégorisations », dans P.-M. Menger (dir.), Les professions et leurs sociologies. Modèles théoriques, catégorisations, évolutions, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme, 2003.
[23] BATAILLE P. et PERRENOUD M., « “One for the money”? The impact of the “disk crisis” on “ordinary musicians” income. The case of French speaking Switzerland », Poetics, vol. 86, 2021, p. 7, en ligne : https://hal.science/hal-03180855v2/document.
[24] PERRENOUD M. et BATAILLE P., « Comment être musicien ? Figures professionnelles des musiciens ordinaires en France et en Suisse », dans SociologieS, 2018.
[25] Entretien avec Mathis, association Rock et chanson, Talence (33), 6 nov. 2019.
[26] ROUX M., « Les lieux de l’intelligence punk. Le Void, le dernier club bordelais en voie de disparition », dans Akki, n° 1, Contre-cultures, p. 18-23, 2020.
[27] Contrairement aux représentations construites par Valentin, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) est une société de gestion des droits d’auteur française fondée en 1851 par des artistes régissant le cadre juridique de redistribution des droits d’auteur. Elle ne prélève donc pas de « taxes » auprès des travailleurs de la musique. De plus, les récentes dénonciations d’actes d’agressions sexuelles dans la scène musicale DIY ont montré que cet espace n’est pas aussi protégé que les propos de Valentin le laissent entendre. Pour en apprendre davantage sur les formes de domination (y compris masculine) que reproduit la scène DIY, voir ROUX M., Faire « carrière» dans le punk. La scène DIY, Paris, Riveneuve, 2023.
[28] Entretien avec Valentin, Void, Bordeaux (33), 18 juill. 2019.
[29] BENABOU V.-L., « Le droit exclusif et l’exploitation numérique de la musique. À l’écoute des voix discordantes », La musique en mouvements, op. cit., p. 113, en ligne : https://cnmlab.fr/recueil/horizon-la-musique-en-2030/chapitre/11/.
[30] Entretien avec Mathis, Void, Bordeaux (33), 17 nov. 2018.
[31] ROUX M., ROBÈNE L. et SERRE S., « L’intelligence punk», dans L. Robène et S. Serre (dir.), Punk is not dead. Lexique franco-punk, Paris, Nova éditions, 2019, p. 67.
[32] BECKER H. S., Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988.
[33] BUREAU M.-C., PERRENOUD M. et SHAPIRO R. (dir.), L’artiste pluriel. Démultiplier l’activité pour vivre de son art, Septentrion, Villeneuve-d’Ascq, 2009.
[34] BOURDIEU P., Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, Paris, 1992.
[35] GAGO V., Neoliberalism from below. Popular pragmatics and baroque economies, Durham, Duke University Press, 2017.
[36] Entretien avec Adam, visioconférence, 19-20 mars 2020.
[37] Entretien avec Valentin, Void, Bordeaux (33), 18 juill. 2019.
[38] Entretien avec Stéphane, domicile, Bordeaux (33), 27 oct. 2017.
[39] Entretien avec Franck, visioconférence, 16 oct. 2020.
[40] Entretien avec Théo, visioconférence, 16 janv. 2024.
[41] Voir le site du groupe : bruitofficial.bandcamp.com.
[42] Entretien avec Yannis, domicile, Bordeaux (33), 13 févr. 2020.
[43] Entretien avec Cédric, visioconférence, 16 oct. 2020.
[44] Entretien avec Thibault, visioconférence, 13 avr. 2020.
[45] L’activité intense du groupe danois Hexis est particulièrement significative. Ses membres sont félicités par l’ensemble de la scène européenne pour leur performance : avoir organisé eux-mêmes et effectué 111 concerts en 109 jours dans des conditions de prestation particulièrement difficiles, bien loin du confort des salles professionnelles et subventionnées.
[46] Entretien avec Mathis, association Rock et chanson, Talence (33), 6 nov. 2019.
[47] Entretien avec Marie, domicile, Bordeaux (33), 27 oct. 2017.
[48] Deathwish est créé en 2000 par Tre McCarthy et Jacob Bannon, chanteur du groupe Converge. Son siège social est situé à Salem au Massachusetts. Bannon a profité de la notoriété acquise en tant que chanteur du groupe Converge pour monter son entreprise. Le label indépendant est souvent considéré aujourd’hui comme étant la plus grande instance de consécration pour les groupes de style hardcore et issue de la scène DIY.
[49] Le groupe est l’un des représentants les plus reconnus de la scène DIY française. Voir le site du groupe : wearebirdsinrow.com.
[50] Le verbe « signer » est un abus de langage. En réalité, la signature est seulement symbolique puisqu’aucun dispositif juridique ne vient ratifier cette relation commerciale.
[51] Entretien avec Mathis, association Rock et chanson, Talence (33), 6 nov. 2019.
[52] PARIS T., « Tectonique de la musique. Les mouvements de fond de l’industrie musicale », dans La musique en mouvements, op. cit., p. 15-18, en ligne : https://cnmlab.fr/recueil/horizon-la-musique-en-2030/chapitre/2/.
[53] Idioteq, « Deathwish Inc. teams up with ADA, the independent distribution and services arm of Warner Music Group (WMG) », mars 2016, en ligne : https://idioteq.com/deathwish-inc-teams-up-with-ada/.
[54] IMONET M., Travail gratuit. La nouvelle exploitation ?, Paris, Textuel, 2018.