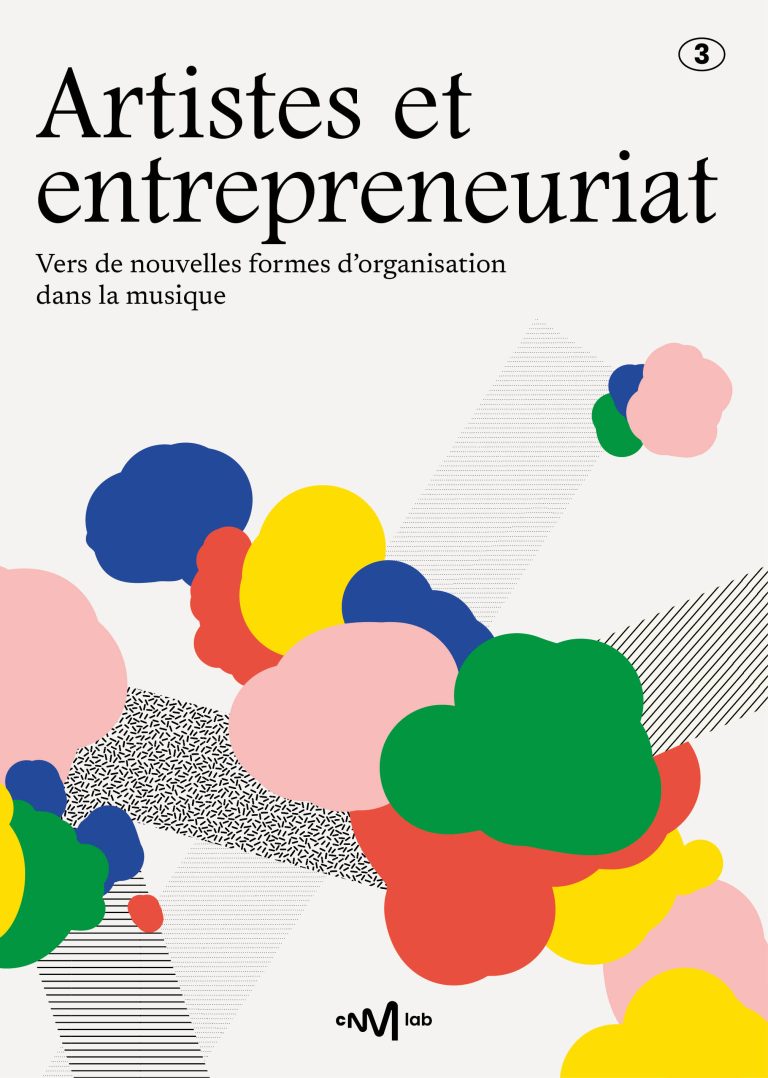« I refuse to be on a slave ship »
Musiciennes, propriété des masters et liberté contractuelle
Introduction
Dans son titre « Angel », Little Simz rappe :
I refuse to be on a slave ship
Give me all my masters and lower your wages[1].
Elle parle ici des droits sur l’enregistrement sonore (master rights). Traditionnellement, les maisons de disques ont toujours contrôlé ces droits, mais les artistes ont de plus en plus fréquemment la possibilité d’en revendiquer la propriété et d’en tirer certains bénéfices : un meilleur partage des recettes ou encore plus de contrôle artistique sur leur travail. C’est à la lumière de cette configuration que l’on peut lire les paroles de Simz.
Cet article s’intéresse à l’évolution des droits sur les enregistrements sonores au sein de l’industrie du disque britannique. Il présente d’abord les fondements de ce droit et analyse la manière dont les entreprises phonographiques et les artistes-interprètes sont parvenus à en prendre le contrôle. Il examine ensuite la propriété de ces droits en fonction des différents types de contrats d’enregistrement phonographique, observant particulièrement les équilibres que les musiciennes et musiciens doivent négocier s’ils souhaitent obtenir la titularité de ces droits. L’analyse se penche ensuite sur les stratégies contractuelles que les artistes peuvent adopter à cette fin : aller vers l’amont (upstreaming) afin d’obtenir plus de soutien de leurs partenaires privés, ou bien viser l’indépendance en aval (downstreaming).
L’article bifurque ensuite assez radicalement. Jusqu’à une période récente, l’histoire de la propriété des droits des masters était restée une affaire surtout masculine – les premiers artistes ayant réussi à récupérer ces droits étaient exclusivement des hommes. De même, le récit de l’expropriation de ces droits avait là aussi été mené par des musiciens masculins, à l’exemple de la campagne « slave » de Prince, qui inspire les paroles de Simz citées en exergue[2]. C’est seulement avec la vente en 2019 des droits d’auteur sur les dix premiers albums de Taylor Swift que des voix féminines se sont hissées au premier plan. Nous allons creuser cette question en observant les possibilités qu’ont les artistes-interprètes féminines de naviguer entre les contrats. Cet article présente le cas de deux musiciennes dont les carrières ont évolué chacune conformément à l’un des deux modèles mentionnés. Little Simz est remontée en amont en passant par des contrats de distribution ou de prestation de services, tout en maintenant la propriété de ses enregistrements. Pionnière en la matière, Kate Bush a suivi un cheminement inverse – en aval –, pour obtenir le contrôle artistique et la propriété de son travail. En conclusion, nous nous penchons sur les obstacles que les artistes-interprètes féminines rencontrent dans leurs carrières et leurs contrats, et envisageons des manières de lutter contre une telle asymétrie de genre.
La propriété des droits d’enregistrement et les contrats d’artiste
Owning the masters[3]
Les droits sur les enregistrements sonores constituent une exception au droit de propriété intellectuelle. Dans la plupart des formes de création artistique, la titularité des droits revient aux créateurs et créatrices de l’œuvre. Mais la législation en matière de phonogrammes en a remis le contrôle aux éditeurs phonographiques, au nom de leur engagement entrepreneurial – la propriété étant remise à la personne (physique ou morale) ayant pris le risque financier de produire l’enregistrement. Cette situation s’est imposée différemment selon les pays, car il a fallu composer avec une variété de conceptions du droit d’auteur. La Grande-Bretagne a rejoint la principale convention internationale en la matière : le Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP) adopté en 1996 par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Ce traité désigne le « producteur» comme propriétaire des droits sur l’enregistrement sonore. D’un point de vue légal, ce terme ne renvoie pas à l’œuvre produite en studio, mais à « la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons[4] ». Pour les maisons de disques, cette définition renvoie à l’entité qui organise et finance les sessions d’enregistrement. C’est sur cette base qu’elles ont revendiqué ces droits[5].
L’Union européenne a également adopté le TIEP et son critère de « producteur » pour déterminer la propriété de ces droits. Toutefois, si la Grande-Bretagne a intégré les master rights dans sa législation en matière de copyright, sur le continent, les pays de droit civil ont suivi une autre voie. La législation y est en effet composée de deux types de droits : les droits d’auteur, qui protègent les œuvres du « génie humain » en conférant la propriété aux créateurs et créatrices[6], et les droits voisins, accordés aux interprètes, diffuseurs et producteurs d’œuvres artistiques.
Les États-Unis ont également ratifié le TIEP. Néanmoins, plutôt que d’accorder la propriété de ces droits aux « producteurs », leur législation sur le copyright reconnaît la créativité à l’œuvre au cours de l’enregistrement. Les artistes-interprètes et le personnel de studio sont considérés comme des coauteurs : les premiers pour « la captation de l’interprétation » et les seconds pour « la captation et le traitement électronique du son [7]». Quoi qu’il en soit, les firmes américaines se sont emparées de ces droits. Elles ont utilisé les règles du work made for hire[8], une exception dans le droit américain qui accorde la propriété du copyright à « l’employeur ou à toute autre personne pour laquelle l’œuvre a été préparée » plutôt qu’aux auteurs et autrices salariés[9].
En dépit de cette configuration, les maisons de disques n’ont pas monopolisé la propriété des droits sur les masters. Les artistes-interprètes se chargent de certains aspects de la production de disques et peuvent par conséquent en revendiquer la titularité. Dans de nombreux cas, ce sont eux qui financent les sessions de studio. Ils peuvent par conséquent être considérés comme « producteurs » selon l’OMPI, dans la mesure où ils assument « la responsabilité de la première fixation des sons ». Dans d’autres cas, ils embauchent des musiciens et du personnel de studio. Ainsi, conformément aux règles du work made for hire américain, ils sont des employeurs et peuvent donc prétendre à la propriété du copyright. Mais les degrés d’implication des artistes-interprètes en matière de financement ou d’embauche varient, et c’est ce qui détermine leur capacité à s’approprier les droits sur les enregistrements. Ce statut est codifié dans différents types de contrats d’artiste.
Les contrats d’artiste
La propriété des droits sur les masters n’est qu’un aspect des contrats d’artiste. Elle est mise en équilibre avec d’autres éléments clés de ces accords, dont les avances, les taux de droits d’auteur ou les dépenses affectées à la promotion et au marketing. Nous allons illustrer ces questions en présentant cinq types de contrats, tirés d’un document publié par la British Phonographic Industry (BPI)[10]. Notons que, si de nombreux pays proposent des contrats similaires, les termes spécifiques relèvent du contexte britannique[11].
Le contrat d’artiste traditionnel
Le premier type de contrat est le contrat d’artiste traditionnel. Longtemps, c’était l’unique option proposée aux artistes-interprètes. En vertu de ce contrat, ceux-ci sont rémunérés de deux manières. Ils reçoivent un premier versement, correspondant à deux types d’avances : une somme pour couvrir leurs frais de subsistance et une autre pour les frais de studio. La valeur combinée de ces avances peut « aller de quelques milliers à des centaines de milliers de pounds[12]». Les musiciennes et musiciens ont également droit à des commissions sur les ventes. Toutefois, celles-ci ne leur seront pas versées avant récupération du montant des avances. On peut ainsi considérer que, sous ce régime, ce sont les artistes qui financent leurs enregistrements : totalement si les avances sont intégralement recouvrées, partiellement dans le cas contraire. Les maisons de disques sont conscientes des implications de cet investissement financier et ont par conséquent sécurisé leurs intérêts en matière de propriété intellectuelle par des dispositions contractuelles. Afin de se préserver de toute remise en cause légale de leur propriété sur les master rights, elles ont exigé des artistes-interprètes qu’ils cèdent ces droits pendant toute leur durée légale. Ces entreprises ont justifié ce contrôle à l’aide de plusieurs arguments. Premièrement, les artistes-interprètes n’assument pas l’intégralité du risque financier pour leurs sessions d’enregistrement, puisqu’ils n’ont pas de dettes à rembourser si ces frais ne sont pas récupérés[13]. Deuxièmement, les artistes bénéficient d’un soutien marketing et promotionnel considérable, que les sociétés financent d’ordinaire sans en déduire les montants des droits qu’ils leur versent. Cet investissement se reflète également dans les pourcentages de droits d’auteur allant « de 15 à 30 % des recettes du label[14] ».
Le contrat de licence
Le deuxième type de contrat est le contrat de licence. Lorsque les droits sont transférés, le titulaire de la licence obtient le contrôle des droits, mais la propriété, elle, n’est pas transférée, contrairement à ce qui prévaut dans un contrat de cession. Par ailleurs, la période de licence est d’ordinaire plus courte que dans une cession. La forme du contrat varie, mais la BPI ne présente en détail que la situation dans laquelle une grande maison de disques acquiert une licence sur des enregistrements « d’entreprises de production ou de labels tiers (qui ont préalablement acquis ces enregistrements par des accords avec les artistes-interprètes)[15] ». Ce type de contrat de licence est considéré comme défavorable aux artistes. Ceux-ci n’obtiennent pas la propriété du copyright (c’est la société de production ou le petit label qui, d’ordinaire, en restent les titulaires), et leurs droits d’auteur ne portent que sur les sommes versées à la société de production ou au petit label. Certains artistes-interprètes ont toutefois réussi à retourner cette situation à leur avantage, en créant leurs propres labels ou structures de production, et en signant des accords de licence avec les plus grandes maisons de disques. À partir des années 1950 aux États-Unis et de la décennie suivante en Grande-Bretagne, ces accords ont posé les jalons d’une conquête par les artistes de ces droits. Ils sont encore très prisés de nos jours. Drake, Kanye West, Rihanna, Beyoncé et Adele ont tous créé des structures afin de s’assurer ces types d’accords.
Plus récemment, un autre type de contrat de licence a vu le jour selon lequel des artistes peuvent transférer ces droits à des maisons de disques même s’ils n’ont pas au préalable créé leur propre label ou société de production. D’un point de vue tant organisationnel que financier, ces artistes s’élèvent ainsi au rang de producteurs – et par conséquent de titulaires – de leurs enregistrements, à l’instar des propriétaires de leur structure de production. Néanmoins, aucun d’entre eux ne prend de risque financier tout seul, et les termes des contrats de licence reflètent le degré d’engagement des labels. Si un artiste exige des avances et un soutien promotionnel à la hauteur de ceux qu’il obtiendrait dans un contrat traditionnel, le montant des droits d’auteur est ajusté en conséquence. S’il réclame un soutien marketing, mais peut financer et organiser les séances d’enregistrement de façon autonome, il peut espérer des commissions supérieures.
Le contrat de coédition
Le troisième type de contrat est le contrat de coédition (profit-share deal) : la plupart des clauses de tels accords impliquent un partage des recettes à 50/50 entre artistes et maisons de disques. Les premiers prennent en charge la moitié de l’ensemble des coûts de production des enregistrements. En sus des frais de studio, ces montants peuvent inclure le marketing, les tournées promotionnelles, la production de clips vidéo ainsi que « les charges légales et comptables[16] ». Une fois ces coûts couverts, les artistes reçoivent généralement la moitié des profits. La situation en matière de droits d’auteur varie. Selon l’accord, les droits peuvent être soit cédés, soit transférés aux labels[17]. Autrement, artistes et labels sont d’emblée copropriétaires et l’on répartit les tâches en conséquence[18].
Le contrat de distribution
Pour la plupart des artistes, c’est avec le développement de l’environnement numérique que les contrats de distribution sont devenus une option viable. Les stations de travail audionumériques ont rationalisé et abaissé le coût de l’enregistrement à domicile. Le téléchargement et le streaming ont permis la distribution marchande d’enregistrements sans avoir à les fabriquer ou à les transporter physiquement. Par conséquent, plutôt que de conclure l’un des contrats précédents, les artistes peuvent produire leurs propres enregistrements et s’associer avec des distributeurs afin de les diffuser sur les plateformes numériques. S’ils n’ont besoin que d’une distribution numérique et de solutions de paiement en ligne, ces accords peuvent être conclus contre une somme forfaitaire convenue dès l’abord, laissant aux musiciens 100 % de leurs recettes en ligne[19]. Si les artistes veulent également bénéficier d’un apport promotionnel, les distributeurs peuvent exiger une commission allant de 15 à 20 % des recettes, ce qui laisse aux premiers l’essentiel de leurs revenus[20]. Certains distributeurs qui fonctionnent à la commission sont prêts à fournir des avances pour les dépenses de marketing si les musiciens peuvent attester du succès de leurs albums précédents[21]. Que ces contrats de distribution soient basés sur des sommes forfaitaires ou des commissions, les artistes assument l’entière responsabilité financière et organisationnelle de leurs enregistrements et conservent ainsi la propriété des droits afférents.
| Type de contrat | Contrat d’artiste traditionnel | Contrat de licence | Contrat de coédition | Contrat de distribution | Contrat de prestation de services |
| Propriété des droits sur l’enregistrement | L’artiste ne peut être titulaire de ces droits | L’artiste est titulaire s’il est le cédant (en tant que personne physique ou morale) | Elle est déterminée par le contrat | Elle revient à l’artiste, car il est un « producteur » selon le régime du copyright | Elle revient à l’artiste, car il est un « producteur» selon le régime du copyright |
Le contrat de prestation de services
On compte enfin les contrats de prestation de services, un type d’accord qui a gagné en popularité à l’ère numérique. Ils ont des points communs avec les contrats de distribution, mais les entreprises de services offrent une panoplie de fonctions supplémentaires, dont le marketing, la promotion sur les médias sociaux, la distribution physique et la gestion de catalogue. Elles calculent les sommes qu’elles sont prêtes à investir en fonction de la taille de la communauté de fans de l’artiste[22]. Ce type de contrat partage également des caractéristiques avec les contrats de coédition et les contrats de licence. Les artistes transfèrent leurs droits aux entreprises de services, qui récupèrent des « coûts ou honoraires définis » avant de verser des sommes aux artistes. La commission ou le taux de partage des bénéfices vont de 25 à 50 % selon les services requis[23]. Toutefois, les coûts n’incluent d’ordinaire pas le tour support ou les avances, ces activités étant d’emblée financées par les musiciens et/ou leurs équipes d’encadrement. Les artistes ayant investi dans leurs enregistrements, ils sont titulaires des droits afférents.
Ainsi, si les artistes peuvent substantiellement s’engager dans l’organisation et le financement de l’enregistrement, ils ont une chance de prétendre à la propriété de ces droits. Cette situation est de plus en plus commune : entre 2016 et 2022, les contrats de distribution sont ceux qui ont connu la plus forte croissance, en nombre[24]. De plus, avant le xxie siècle, dans la plupart des nouveaux contrats, les grandes maisons de disques britanniques obtenaient la cession des droits sur les enregistrements pour toute la durée légale ; la part de ces contrats était de 66 % en 2012, elle est tombée à 26,4 % en 2021[25]. Il apparaît toutefois que les artistes sont rarement tout à fait indépendants. Si l’on écarte ceux qui ont conclu des contrats de distribution, ils sont une majorité à dépendre du financement et de l’expertise de leurs partenaires contractuels. Ceux ayant conclu des contrats traditionnels ou de licence financés par des avances ont besoin de ce soutien pour chaque aspect de leur carrière d’interprète. Avec les autres types de contrats, dans la plupart des cas, les artistes titulaires des droits des masters les financent d’emblée et obtiennent un soutien financier pour la distribution, la promotion et une pluralité d’autres activités.
Stratégies de l’amont et de l’aval
D’autres facteurs compliquent la situation des artistes indépendants. La situation dans laquelle ils s’associent à une maison de disques (contrats traditionnels, de licence, de coédition) est très différente de celle qui prévaut quand ils se lient à d’autres types d’entreprises (contrats de distribution, de prestation de services). Mais les majors disposent toutes d’entreprises de distribution et de services propres. Cette intégration verticale s’explique par leur désir d’absorber des artistes en amont, de les faire remonter vers des contrats traditionnels ou de licence, à partir des autres types d’accords[26]. Toutefois, le processus peut tout aussi bien se déployer en sens inverse, en aval. Afin de faciliter ces deux types de processus, deux facteurs chronologiques entrent en jeu : les clauses contractuelles relatives soit aux nouveaux enregistrements, soit aux anciens enregistrements.
Pour les artistes, pouvoir enregistrer des albums inédits avec de nouveaux partenaires dépend du nombre de disques prévu dans leurs accords en cours. La situation varie selon les types de contrats. La plupart des contrats de distribution valent pour un seul disque : les artistes peuvent changer d’entreprise à chaque nouveau projet[27]. À l’origine, il en allait de même pour les contrats de prestation de services, mais il semblerait que ceux-ci « soient en train de s’allonger[28]. » Certains contrats de coédition sont établis pour un seul enregistrement, d’autres pour plusieurs. Les contrats de licence et les contrats traditionnels plus récents tendent à inclure des « options » : les maisons de disques s’engagent pour les premiers disques des artistes, mais peuvent choisir d’étendre les accords à des sorties futures, et il est commun d’y voir des options pour trois ou quatre albums[29]. Ainsi, si les artistes prennent plus de deux ans pour enregistrer et sortir leurs œuvres, ils peuvent se retrouver engagés pour au moins dix ans.
La durée de la cession est cruciale, car elle conditionne la possibilité pour les artistes d’inclure leur catalogue passé dans de nouveaux accords. Dans les contrats de distribution, les artistes gardent le contrôle sur le copyright et peuvent « déménager» leur back catalogue à l’échéance du contrat. Dans le cas de la prestation de services, ils accordent à l’autre partie une licence pour une période allant de quatre à douze ans et ne peuvent céder leurs enregistrements qu’au terme de celle-ci[30]. Dans les coéditions, ils peuvent avoir la copropriété d’entrée de jeu, ou bien jouir d’une propriété exclusive au bout d’une période convenue[31]. Dans les licences, les termes de la cession peuvent varier, mais sont d’ordinaire liés à la production effective du nombre d’albums prévus, plus un certain nombre d’années et/ou le recouvrement des avances. Dans les contrats d’artiste traditionnels, les interprètes n’obtiennent jamais la propriété des droits.
Ces facteurs chronologiques sont importants, car chaque type de contrat peut présenter des avantages pour les artistes, selon le moment où ils en sont dans leur carrière. Comme on peut le voir avec les situations décrites plus haut, ce sont les artistes ayant assumé la pleine responsabilité financière et organisationnelle de leurs séances d’enregistrement – notamment en les finançant d’avance – qui seront les plus susceptibles d’obtenir des parts importantes de revenus. Cela ne signifie pas pour autant que ceux qui signent directement un contrat avec une maison de disques seront systématiquement en moins bonne posture que leurs congénères plus attachés à l’indépendance. Non seulement ces derniers doivent prendre les devants en matière de financement et d’organisation des séances de studio, mais ils peuvent aussi avoir à saisir les rênes du marketing et de la promotion. Les labels investissent des sommes plus importantes et bénéficient d’une meilleure expertise en la matière. Ainsi, des artistes acceptant des commissions basses, mais dont les disques sont bien promus peuvent finir par gagner plus que ceux ayant négocié des taux plus élevés, mais qui ne rencontrent pas le succès. En fin de compte, le plus judicieux pour les artistes est de faire preuve de flexibilité, afin de pouvoir changer de type de contrat au bon moment. Lors de la production de nouveaux enregistrements, il leur faut dans l’idéal obtenir du soutien promotionnel et des avances élevées lorsqu’ils sont dans le besoin. Pour ce qui est des anciens enregistrements, ils doivent limiter la durée de cession des droits ; ainsi, au moment où ils les récupèrent, ils peuvent les inclure dans de nouveaux accords plus rémunérateurs. Afin de jauger les avantages circonstanciels des différents types de contrats et de la liberté de passer de l’un à l’autre, nous allons désormais nous concentrer sur les cas de Little Simz et Kate Bush. Nous examinerons ensuite la dimension genrée de ces accords.
Les musiciennes et les contrats d’enregistrement
Little Simz
Little Simz est une rappeuse britannique qui est remontée vers l’amont, en signant successivement différents types de contrats. Son premier album est sorti en 2015 et son dernier – le cinquième – en 2022. Pendant toute cette période, elle a été catégorisée comme artiste indépendante, mais au fil de sa carrière, elle a accepté de plus en plus d’apports extérieurs, passant d’un contrat de distribution à un premier contrat de prestation de services – le premier avec son propre label, le second en partenariat avec le label d’une autre personne.
Ses deux premiers albums – A Curious Tale of Triads + Persons (2015) et Stillness in Wonderland (2017) – ont été édités par sa propre société, Age 101, sans le soutien d’une entreprise de services ou d’un label. Elle reçoit donc l’essentiel des revenus tirés des droits sur ces enregistrements, déduction faite d’une somme forfaitaire ou d’une petite commission prélevée par son distributeur. Qu’en est-il de sa popularité ? Jusqu’à présent, aucun de ces disques n’a atteint les hit-parades, en Grande-Bretagne ou ailleurs. Ils ont engrangé environ 50 millions de streams sur Spotify à la date de novembre 2023, ce qui représente environ 150 000 livres de revenus pour Simz, si l’on part d’une commission de 15 %[32]. On peut doubler ce montant pour prendre en compte les droits provenant d’autres services de streaming et d’autres formats d’enregistrement[33], soit un total de 300 000 livres. Cette somme a été accumulée sur une période de huit années, et il faudrait en déduire les sommes qu’elle a investies pour la production des albums, l’enregistrement, les frais de studio, de marketing ou encore les frais généraux de son entreprise. Pour l’année 2018, les comptes d’Age 101 indiquent un profit de 16 388 livres[34], et pour l’année suivante, de seulement 4 016 livres[35] – des chiffres cohérents avec nos estimations.
Les troisième et quatrième albums de Simz – The Grey Area (2019) et Sometimes I Might Be an Introvert (2022) – ont eux aussi été édités par Age 101, mais par l’entremise d’un contrat mondial avec l’entreprise de services AWAL, qui prévoit « la promotion et le marketing mondiaux, la distribution numérique et physique, la coordination des campagnes, le soutien artistique[36] ». AWAL propose aux artistes une « gamme de services à trois étages », et prélève une commission ajustée à son niveau d’engagement[37]. La presse professionnelle nous renseigne sur les contrats conclus avec AWAL : l’envergure de celui de Simz la place dans l’échelon supérieur, ce qui signifie probablement un contrat de coédition à 50/50 et une cession de droits « d’une durée de quatre à dix ans[38] ».
Le soutien d’AWAL a contribué à la reconnaissance et au prestige de Simz en Grande-Bretagne. En 2020, elle a remporté le prix Ivor Novello pour The Grey Area et, deux ans plus tard, le prix Mercury pour Sometimes I Might Be an Introvert, ainsi qu’un Brit Award pour meilleur nouveau talent. Sa popularité en ligne a fortement progressé : l’ensemble des titres de ces albums a été écouté 400 millions de fois sur Spotify, à la date de novembre 2023, ce qui représenterait environ 1 300 000 livres de recettes – un chiffre que l’on pourrait, encore une fois, doubler pour inclure les autres supports et services de streaming. Toutefois, d’après les clauses courantes d’une coédition, sa société a probablement dû couvrir la moitié des frais de production et de distribution des disques, et n’a eu droit qu’à la moitié des recettes restantes.
Si ces succès ont amélioré les revenus de Simz, sa situation est restée précaire. Logiquement, le coup à jouer à la suite de cette réussite nationale aurait été une tournée aux États-Unis. Pourtant, malgré la promesse qu’AWAL lui avait faite de l’aider à « percer sur la scène internationale[39] », ses finances s’avérèrent insuffisantes. Un contrat d’artiste traditionnel aurait inclus un budget récupérable pour le tour support ; les contrats de prestation de services, eux, n’avancent pas ces fonds. Simz décrit bien ces contraintes :
« En tant qu’artiste indépendante, je paie tout de ma poche, y compris mes concerts ; faire une tournée d’un mois aux États-Unis me plongerait dans un déficit énorme[40]. » Elle a par conséquent décidé d’annuler une tournée prévue en mai 2022.
La situation de Simz est symptomatique des difficultés de l’indépendance. AWAL est l’acronyme d’« artists without a label » – artistes sans label. Au moment où elle renouvelait son contrat avec cette société en 2020, son ancien manager Robert Swerdlow disait : « C’est une vraie artiste indépendante et elle a une vision artistique propre englobant toutes les facettes de sa carrière. L’équipe d’AWAL comprend parfaitement cette manière de faire[41]. » Paul Hitchman, le directeur d’AWAL, a fait un commentaire similaire : « En tant qu’artiste ayant une vision singulière de sa carrière, elle est parfaite pour le modèle AWAL[42]. » Ce modèle a changé l’année suivante, lorsque l’entreprise fut acquise par Sony Music Entertainment, la deuxième major du « triopole » mondial. Les productions indépendantes de Simz sont désormais inscrites au bilan de Sony.
Les problèmes ne se sont pas dissipés avec son dernier album, No Thank You (2022), où figure le titre « Angel ». L’album est distribué par AWAL, mais n’est pas édité par Age 101. Il fait partie du catalogue de Forever Living Originals, un label aux mains de Dean Clover, le producteur studio des trois derniers albums de la rappeuse. S’il a signé un contrat de coédition avec AWAL, la part des recettes revenant à Simz est tombée à 25 %. Si l’on en croit les paroles d’« Angel », elle semble néanmoins avoir retenu la propriété des enregistrements.
Les capacités de financement de Simz sont réduites, et son dernier album n’a pas été édité par son propre label. Il faut toutefois noter qu’après remboursement des frais de ses quatre premiers albums, elle bénéficiera d’une portion importante des revenus qu’ils engendrent, tant qu’ils restent populaires. Pour The Grey Area et Sometimes I Might Be an Introvert, sa part pourrait grimper de 50 à 85 % du total, si ce n’est plus, selon les modes de distribution qu’elle choisira après expiration du contrat de licence avec AWAL. On peut également noter que, bien qu’elle jouisse probablement d’une commission plus faible pour No Thank You, il est possible que le contrat ne porte que sur cet album. Les suivants pourraient être édités par Age 101, ou bien elle pourrait s’associer à une maison de disques de plus grande envergure. Comme elle l’a affirmé elle-même, « Je ne dirai jamais à quelqu’un : “sois indépendant” ou “signe avec une entreprise” – c’est une question d’instinct, c’est à toi que revient la décision, et à personne d’autre[43]. »
Kate Bush
C’est en aval que Kate Bush a progressé vers plus d’indépendance. Elle a démarré sa carrière avec un contrat d’artiste traditionnel, signé avec la major EMI en juillet 1976. À l’époque, en Grande-Bretagne, la durée des contrats était fixée en années, et non en nombre d’options sur des albums : le sien courait jusqu’en juillet 1980. Pendant cette période, tout porte à croire qu’EMI l’a beaucoup soutenue : la période de développement entre la signature et la sortie de son premier single (« Wuthering Heights ») dura dix-huit mois. Et c’est elle qui imposa ce titre comme premier single, alors que l’entreprise avait d’autres préférences[44]. L’association s’avéra fructueuse : avec l’apport marketing d’EMI, trois de ses albums figurèrent au Top 10 et six de ses singles au Top 20 en Grande-Bretagne, pendant les quatre premières années de sa carrière. En revanche, les termes de son contrat n’étaient pas particulièrement généreux. L’avance inaugurale de 3 000 livres représentait moins d’un dixième de celle obtenue par les Sex Pistols en 1977[45]. On peut ainsi estimer que le niveau de la commission de Kate Bush fut au mieux moyen pour l’époque – probablement un taux à un chiffre[46]. Par ailleurs, EMI prit des décisions contraires aux intérêts de Kate Bush – notamment en sexualisant son image pour promouvoir son premier album, The Kick Inside[47]. Mais c’est son expérience lors de l’enregistrement du suivant, Lionheart, qui l’a le plus minée. EMI lui accorda peu de temps pour ce travail et elle dut endurer les pratiques discriminatoires du producteur studio Andrew Powell. Kate Bush expliqua : « Si vous êtes une femme, on ne vous prend pas très souvent au sérieux […]. Si j’avais exprimé mes envies, on m’aurait dit que ça ne marcherait pas[48]. » En réaction à cette situation, Kate Bush « redoubla d’efforts pour gagner en contrôle sur sa carrière[49]. » Après la fin de son premier contrat avec la sortie de son troisième album Never For Ever en septembre 1980, elle signa de nouveau avec EMI. Mais plutôt que de le faire directement en tant qu’artiste, elle autofinança ses enregistrements et en céda les droits par l’entremise de sa société Novercia Ltd, ce qui lui permit de conserver la propriété des droits[50]. Cette manœuvre était nourrie et encouragée par son autonomie croissante. Kate Bush endossa le rôle de productrice unique pour son quatrième album The Dreaming (1982) et monta son propre studio pour le suivant, Hounds of Love (1985).
Le contrat de licence de Kate Bush s’étendit sur trente ans, et ne fut interrompu que par l’effondrement d’EMI en 2012. Pendant cette période, l’industrie du disque a effectué plusieurs mues technologiques, du crépuscule du vinyle à l’essor du streaming. Cette évolution pouvait coûter cher aux artistes ayant signé des contrats dans les années 1980 et dont les commissions étaient restées stables, les droits ayant été cédés pour toute la durée légale de protection. À l’ère du vinyle, les commissions des maisons de disques étaient calculées en fonction des coûts de production et de distribution. Les taux en Grande-Bretagne, dans les années 1980, s’élevaient à 14 % en moyenne[51].
En tant qu’artiste détentrice de ses droits, Kate Bush était dans une situation différente. Après la disparition d’EMI, elle ressortit ses enregistrements auparavant sous licence par l’intermédiaire de son propre label Fish People, s’associant à Warner Music Group pour la distribution[52]. Grâce à ce contrat, sa part des recettes tirées des droits des masters aurait été fixée à « plus de 80 %[53] ». Lorsque son single de 1985 « Running Up That Hill » figura en 2022 dans la bande-son de la série Stranger Things, il fut pendant un court laps de temps l’enregistrement le plus populaire au monde sur les plateformes de streaming. Tim Ingham, journaliste spécialisé dans l’industrie musicale, calcula qu’il lui rapportait pendant cette période « un million de dollars de droits d’auteur par mois[54]. »
Ingham a évoqué un désavantage des contrats de distribution. Cherchant à comprendre pourquoi le succès de « Running Up That Hill » n’avait pas amené ces nouveaux auditeurs et auditrices à découvrir « le reste de l’œuvre de Kate Bush », il soutint que c’était parce que les petites marges de Warner ne l’encourageaient pas à « mettre toute la puissance de sa machine marketing au service de sa marque[55]». Mais cette analyse part de l’idée incorrecte selon laquelle Kate Bush posséderait « l’intégralité » des droits sur l’ensemble de son catalogue[56]. Selon les termes de son premier contrat, les droits des masters de ses trois premiers albums sont aux mains de Warner, qui a acquis le label Parlophone d’EMI en 2013. On peut considérer que les taux de droits de Kate Bush sur ces œuvres, sur lesquels figurent ses deuxième et troisième plus grands tubes après « Running Up That Hill », restent significativement plus bas que ceux dont elle dispose pour le reste de son catalogue. En définitive, à l’aune du contrôle qu’elle a sur sa carrière, c’est probablement Kate Bush, et non Warner Music, qui décida de ne pas exploiter sa « marque ».
Asymétrie de genre
Nous avons délibérément choisi d’analyser les cas de Little Simz et Kate Bush. D’une part, ils montrent que les artistes peuvent accroître leurs profits, soit en cherchant plus de soutien de la part des labels – la stratégie de l’amont –, soit en allant dans le sens inverse de contrats traditionnels – la stratégie de l’aval. D’autre part, ces deux artistes ont fait preuve d’une capacité inhabituelle à gagner davantage et à naviguer entre les contrats. Ces occasions ont une dimension genrée, et c’est ce que nous allons maintenant illustrer par une vue d’ensemble du marché britannique.
Avant de commencer, il est utile de noter que si ces deux stratégies tendent à améliorer la situation financière des artistes-interprètes, elles ne les protègent pas contre la misogynie de l’industrie du disque. Comme l’indiquent les informations qui suivent, seules des artistes bien établies et indépendantes telles que Kate Bush peuvent se prémunir contre les discriminations de genre. Un récent rapport du gouvernement britannique a déterminé que les musiciennes dont les carrières n’ont pas atteint ce stade « continuent à devoir souffrir d’obstacles injustifiables, d’un soutien insuffisant, de discriminations de genre et de harcèlement sexuel, ainsi que de “la persistance d’inégalités de rémunérations”[57]. »
On peut tout d’abord remarquer que ces restrictions affectent les musiciennes qui aspirent à l’indépendance dès le lancement de leurs carrières. Il arrive que l’on ne reconnaisse pas leurs capacités entrepreneuriales. Une étude de 2018 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a souligné que, pour dix autoentrepreneurs, on ne compte que six autoentrepreneuses[58]. L’Organisation internationale du travail (OIT) a montré que les entrepreneuses rencontrent de nombreux obstacles du fait de leur genre, dont « des lois et/ou des pratiques culturelles discriminatoires en matière de propriété, de mariage ou d’héritage, des limites à leur mobilité, à leur expression et leur représentation, ainsi qu’une répartition inégale des tâches familiales et domestiques[59]. »
Les musiciennes qui ne parviennent pas à auto-financer leurs enregistrements peuvent rencontrer d’autres entraves lorsqu’elles souhaitent passer de contrats de distribution à des contrats avec des prestataires de services ou des maisons d’édition phonographique. La progression des carrières varie selon les genres musicaux : par exemple, le prix de meilleur nouveau talent que Simz a remporté aux Brit Awards ne lui a été attribué que six ans après la sortie de son premier album et douze après celle de sa première mixtape. Cette reconnaissance différée tient en partie au règlement de ce prix : pour y prétendre, un artiste doit avoir un album dans le Top 40 ou deux singles dans le Top 20. Sa progression fut également pénalisée du fait de biais institutionnels. Elle a évoqué les inégalités de genre, considérant qu’« être une femme a joué un rôle » dans le fait que des rappeurs masculins de deuxième rang lui avaient grillé la politesse[60].
Ce biais avait été mis à l’index dans le titre d’un article de 2016 du magazine Vice : « Little Simz is pioneering UK rap, so why won’t the industry support her[61]? » On en repère également des symptômes dans d’autres genres musicaux. Le personnel et les artistes signés par plusieurs piliers de l’industrie, y compris dans les mondes de la pop indépendante, de la dance ou du grime, sont à une écrasante majorité masculins[62]. Les musiciennes souffrent aussi de discriminations professionnelles. Un succès précoce dans le milieu indépendant peut s’avérer décisif, les artistes tendant à travailler à la limite de la viabilité financière. À cet égard, Dean Clover, le partenaire créatif de Simz et propriétaire depuis peu de son label, a profité d’avantages financiers relatifs en endossant la casquette de producteur studio. Les producteurs de beats sont souvent mieux payés que celles et ceux qui fournissent les éléments vocaux[63]. C’est le cas de producteurs relativement peu connus comme Clover, qui a profité du travail réalisé avec des vedettes telles qu’Adele pour financer son label. Le personnel de studio est très majoritairement masculin. Ces dernières années, les femmes n’occupent qu’environ 5 % des emplois de production et d’ingénieurs en Grande-Bretagne[64]. Comme l’a rapporté le gouvernement britannique, les musiciennes sont « invariablement plus susceptibles d’être acceptées comme chanteuses, et non dans d’autres activités musicales, limitant d’autant plus leurs carrières et ambitions musicales[65] ».
Les différences de genre apparaissent également lorsque les musiciennes commencent leur carrière avec des contrats d’artiste traditionnels puis tentent d’évoluer en aval vers l’indépendance entrepreneuriale. Il faut ici souligner le caractère pionnier des accords conclus par Kate Bush. Lorsqu’elle a signé son contrat de licence en 1980, elle s’inscrivait dans le sillage d’une petite minorité d’artistes britanniques ayant obtenu la propriété des droits sur leurs enregistrements, à commencer par Dave Clark en 1963, et parmi lesquels on compte les Rolling Stones (1970), Pink Floyd (1972), Peter Gabriel (1975) ou Paul McCartney (1979). Kate Bush semble avoir été la première femme britannique à y parvenir. L’absence de précurseuses tient notamment à l’économie de l’industrie musicale britannique qui, de 1968 à l’ère numérique, privilégia les albums au détriment des singles[66]. Ce marché fut biaisé en faveur de groupes masculins et du rock. Un hit-parade hebdomadaire des ventes d’albums britanniques fut lancé en 1956, mais il fallut attendre l’année 1981 pour qu’une femme se hisse à la première place, avec Never For Ever de Kate Bush. Une autre raison à cette situation tient au niveau d’autonomie accordé aux interprètes féminines. En s’engageant dans la production studio de ses albums à partir de Never For Ever, Kate Bush était un cas rare. Bien que le critère de « producteur» soit défini séparément des fonctions de producteur studio, les deux pratiques restent liées dans la législation sur le droit d’auteur. Si un producteur studio est propriétaire de son studio et/ou paie pour les enregistrements, il est en bonne position pour en revendiquer la propriété à l’aide d’un contrat de licence. L’absence de titulaires féminines de ces droits pourrait également tenir à une troisième raison : à l’époque, on valorisait et on parlait peu des bénéfices d’un tel contrôle. À cet égard, Kate Bush a peut-être glané des informations précieuses en travaillant avec David Gilmour et Peter Gabriel, qui avaient tous deux négocié des contrats de licence.
De nos jours, il semble plus facile pour des musiciennes d’opter fructueusement pour la stratégie de l’aval. Pour cela, elles doivent s’être libérées de leur contrat d’artiste traditionnel, ce qui n’est pas chose aisée. Il faut qu’une entreprise phonographique leur ait proposé un accord. Comme toujours, c’est le cas d’une infime minorité. Les femmes ont par ailleurs bien moins de chances d’en conclure un. Dans une analyse récente des biais de genre dans l’industrie musicale britannique, Vick Bain a montré que, à ambition égale, et alors que près de la moitié des étudiants de troisième cycle en musique sont des femmes, celles-ci constituent moins d’un cinquième de tous les artistes signés par les maisons de disques britanniques[67]. De plus, 12,6 % des labels étudiés n’ont pas la moindre interprète féminine[68].
Les artistes doivent ensuite remplir toutes les conditions contractuelles, sans être abandonnés entretemps ou maintenus dans les limbes. Être délaissé par une maison de disques peut nuire à leur marge de négociation lors d’accords futurs ; croupir au purgatoire peut tout simplement anéantir une carrière. Ces deux situations s’avèrent plus compliquées encore pour les femmes. Une étude des lauréats du prix de la critique aux Brit Awards a montré que les labels britanniques tendent constamment à ne miser que sur une seule vedette féminine et à négliger les autres musiciennes de leurs catalogues[69]. Dans les limbes, les femmes sont également traitées de façon plus sévère[70]. Analysant le phénomène, Michael Cragg a souligné que « la pop est jonchée d’artistes féminines, de Chlöe Howl à Sinéad Harnett, qui ont été mises sur la touche après avoir signé avec des majors[71]. » C’est le cas de Raye, qui a conclu un contrat d’artiste traditionnel en 2014 avec des options pour quatre albums, mais qui en 2021 n’avait toujours pas eu le droit d’en sortir un seul parce qu’elle attendait que son « label confirme » qu’elle était « assez talentueuse » pour être lancée[72].
Ces parcours soulignent par ailleurs le traitement différentiel réservé par les maisons de disques aux différents genres musicaux. Keith Negus a distingué l’approche « organique » du rock, qui implique une vision à « long terme » du potentiel d’un groupe et une plus grande liberté accordée en matière de marketing et de choix des répertoires, de la méthodologie « synthétique » de la pop, dans laquelle l’entreprise est très impliquée tant dans l’image que la musique, mais où règne souvent le « court terme »[73]. Comme l’indique Bain, le rock est encore et toujours « dominé » par des interprètes masculins et, par conséquent, bien des musiciennes sont cantonnées à l’approche synthétique[74]. Raye est l’une des rares à y avoir échappé[75]. Elle s’est extirpée de son contrat traditionnel en décembre 2021, puis, par l’entremise d’un prestataire de services, elle a sorti un album autofinancé qui a atteint la deuxième place dans les charts britanniques.
Les obstacles à la conclusion d’un contrat d’artiste et les freins au soutien sont d’autant plus prégnants pour qui n’a pas déjà fait ses preuves. Ils changent si l’artiste remonte vers l’amont à partir de contrats de prestation de services et s’il a déjà obtenu reconnaissance et succès. Par exemple, Little Simz serait bien placée pour exiger des termes préférentiels en matière de marketing, de taux de droits d’auteur et de propriété des bandes. La plupart des grandes vedettes actuelles ont néanmoins commencé leur carrière avec des contrats d’artiste traditionnels et ont par conséquent dû transférer leurs droits pour l’intégralité de la durée légale. Seule une poignée a pu les récupérer. Aux États-Unis, c’est le cas de Bruce Springsteen, Prince et Jay-Z, mais pas de Taylor Swift. En Grande-Bretagne, David Bowie, Queen et Radiohead ont atteint cette position enviée, mais Kate Bush, elle, n’a pas récupéré ses premiers enregistrements. Voilà un autre phénomène qui semble marqué par un certain phallocentrisme. Toutes les entreprises sont poussées à tenir compte de ces types de disparités. À l’échelle mondiale, l’OCDE rassemble des données professionnelles sur les inégalités de genre[76]. L’industrie musicale britannique publie un rapport biennal sur les questions de diversité, pour lequel les entreprises musicales sont invitées à détailler les variations genrées de la progression de carrières et des salaires. Le dernier rapport de 2022 leur suggère aussi de bonnes pratiques : « œuvrer à une stratégie et une vision d’égalité, de diversité et d’inclusion (EDI) à cinq ans » ; « identifier les barrières à l’entrée ou à l’inclusion » et « incorporer l’EDI dans chaque aspect des structures et des systèmes d’une organisation »[77].
À ce jour, les rapports d’UK Music n’évoquent pas les artistes-interprètes, notamment parce qu’ils ne sont pas considérés comme des employés. Malgré la diversité de leurs situations contractuelles et de leurs statuts en tant que titulaires de copyright, l’industrie du disque a en l’occurrence décidé de les considérer tous et toutes comme des entrepreneurs et des entrepreneuses indépendants. Par conséquent, elle n’a pas fourni à UK Music d’informations sur l’évolution des carrières ou des rémunérations. Elle n’a pas non plus intégré ces artistes à son travail d’EDI.
Conclusion
Cet article s’est penché sur trois grands sujets. D’abord, il a montré que si les artistes obtiennent la propriété des droits sur les enregistrements sonores, c’est en général parce qu’ils ont développé une capacité entrepreneuriale à financer et organiser leurs sessions d’enregistrement. Ils ne peuvent que rarement se passer du soutien et des financements des maisons de disques, une situation scellée par les contrats. Ensuite, il a détaillé les bénéfices que les musiciens peuvent tirer en adoptant des stratégies de l’amont ou de l’aval, en naviguant entre les différents contrats qu’ils signent, profitant si nécessaire de l’appui d’éditeurs phonographiques ou d’entreprises de prestation de services et s’engageant dans une démarche plus entrepreneuriale. Enfin, il a souligné les différences de genre qui existent lorsqu’il s’agit de passer d’un type de contrat à un autre et d’obtenir un soutien adéquat. Nous nous sommes intéressés à ce dernier thème, car les artistes-interprètes féminines sont victimes de discriminations en matière de propriété du copyright et d’évolution des carrières.
Comment parvenir à la parité de genre ? Certains problèmes, tels que le manque de productrices studio, tiennent à des idées reçues et peuvent être réglés en encourageant l’émancipation et la reconnaissance des compétences. Dans certains genres comme la dance music, le processus est en cours[78]. D’autres questions commencent aussi à gagner en visibilité, telles que les biais institutionnels qui affectent les contrats et les politiques de développement d’artistes au sein de maisons de disques et de sociétés de prestation de services. Les musiciennes se font de plus en plus entendre sur ces inégalités contractuelles[79], que des études étalent au grand jour. Les entreprises ont néanmoins encore du chemin à faire. En Grande-Bretagne, on les a invitées à incorporer l’EDI dans leurs structures et organisations, et pourtant elles rechignent à évoquer les contrats qui constituent la pierre angulaire de leur travail. On peut les obliger à le faire. En janvier 2024, le Woman and Equalities Committee du gouvernement britannique a invité les labels à « s’engager à publier régulièrement des statistiques sur la diversité de leurs catalogues artistiques[80] ». Il s’agit là d’un travail essentiel. Imaginer un futur égalitaire sans dénoncer les inégalités structurelles gravées dans les contrats et sans les combattre par des mesures concrètes, c’est de l’aveuglement volontaire.
Traduit de l’anglais britannique par Jedediah Sklower
[1] « Je refuse de monter à bord d’un navire négrier/Donnez-moi tous mes masters et baissez vos salaires.» Little Simz, « Angel », écrit par Cleopatra Nikolic, Dean Josiah et Simbiatu Ajikawo.
[2] OSBORNE R., Owning the Masters. A History of Sound Recording Copyright, Londres et New York, Bloomsbury Academic, 2023, p. 144.
[3] En anglais, to own signifie bien sûr « posséder », mais le verbe a récemment acquis une connotation argotique, familière qui renvoie à une victoire écrasante, à la suite d’un affrontement. L’expression « owning the masters » (que l’on retrouve dans le titre de l’ouvrage cité de R. Osborne) joue ainsi sur des connotations multiples : « être propriétaire des droits» et, par cette conquête, avoir provoqué un renversement de situation ayant « défait/dominé/humilié les maîtres » – ces magnats de l’industrie musicale associés aux esclavagistes. [NDT]
[4] « Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes », 12 déc. 1996, art. 2d., en ligne : www.wipo.int/wipolex/en/text/295580.
[5] « Monopolies and mergers commission, the supply of recorded music. A report on the supply in the UK of pre-recorded compact discs, vinyl discs and tapes containing music», Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 1994, sec. 108.
[6] PORTER V., Beyond the Berne Convention. Copyright, Broadcasting and the Single European Market, Londres, John Libbey, 1991, p. 1.
[7] Senate Judiciary Committee, Creation of a Limited Copyright in Sound Recordings. Report to Accompany S. 646, Washington, US Government Printing Office, 1971, p. 5.
[8] Proche de « contrat de louage d’ouvrage ou de service». [NDT]
[9] « Copyright law of the United States (title 17) and related laws contained in title 17 of the United States code », Library of Congress, circulaire 92, déc. 2022, sec. 101 et 201(b), en ligne : https://www.copyright.gov/title17/.
[10] La BPI est le grand syndicat interprofessionnel (producteurs phonographiques, mais aussi fabricants, distributeurs…) du secteur musical en Grande-Bretagne. [NDT]
[11] BPI, Written Evidence Submitted by BPI, 16 nov. 2020, en ligne : committees.parliament.uk/writtenevidence/15427/default.
[12] Ibid., p. 30.
[13] OSBORNE R., Owning the Masters, op. cit., p. 130-135.
[14] BPI, Written Evidence, op. cit., p. 30.
[15] Ibid.
[16] HARRISON A., Music. The Business, Londres, Virgin, 2000, p. 69.
[17] Music Managers Forum (MMF), The Deals Guide, 2017, en ligne : https://completemusicupdate.com/content/files/2023/09/mmf-dealsguide.pdf ; BARR K. W., « Music copyright in the digital age. Creators, commerce and copyright – An empirical study of the UK music copyright industries », thèse de doctorat, université de Glasgow, 2016, p. 33, en ligne : theses.gla.ac.uk/7752.
[18] BYRNE D., How Music Works, Édimbourg, Canongate, 2012, p. 235.
[19] Association of Independent Music (AIM), Distribution Revolution, 2019, p. 41, en ligne : https://unlimitedmedia.co.uk/guides/aim-distributionrevolution.pdf.
[20] BPI, Written Evidence, op. cit., p. 31.
[21] MMF, The Deals Guide, op. cit., p. 14.
[22]AIM, Distribution Revolution, op. cit., p. 33-38.
[23] Ibid., p. 41 ; BPI, Written Evidence, op. cit., p. 31 ; INGHAM T., « If you wanted to know why sony music bought AWAL… This is why», Music Business Worldwide, 17 févr. 2022, en ligne : www.musicbusinessworldwide.com/if-you-wanted-to-know-why-sony-music-bought-awal-this-is-why.
[24] MULLIGAN M., Recorded Music Market 2022. Reality Bites, Midia, mars 2023, p. 2, en ligne : www.midiaresearch.com/blog/recorded-music-market-2022-reality-bites.
[25] Competition & Markets Authority, Music and Streaming. Final Report, 29 nov. 2022, sec. 5,50, en ligne : www.gov.uk/government/publications/music-and-streaming-market-study-final-report.
[26] INGHAM T., « I you wanted to know», art.cité.
[27] « Years of service », Music Week, 16 janv. 2021, p. 8-10.
[28] STOKES P., « At your service», Music Week, 1er mars 2021, p. 50-54.
[29] BPI, Written Evidence, op. cit., p. 30.
[30] HOMEWOOD B., « Service stations », Music Week, 29 janv. 2018, p. 22-26 ; INGHAM T., « I look at AWAL as the best artist development company in the business », Music Business Worldwide, 1er août 2023, en ligne : https://www.musicbusinessworldwide.com/i-look-at-awal-as-the-best-artist-development-company-in-the-business/.
[31] BYRNE D., How Music Works, op. cit., p. 235; MMF, The Deals Guide, op. cit., p. 16.
[32] Ce montant a été calculé en recourant à la méthodologie présentée par Tim Ingham, dans son article « Where are all the Kate Bush T-shirts?», Music Business Worldwide, 22 sept. 2022, en ligne : www.musicbizpodcast.com/203834/11394804. Ingham estime que les droits des masters s’élèvent à 52 % des revenus de Spotify, et que cette société paie 0,008 $ par stream, soit 0,0064 £ par stream si l’on prend le taux de change de 2023.
[33] INGHAM T., «Where are all the Kate Bush T-shirts?», art. cité.
[34] Age 101, « Director’s Report and Unaudited Accounts », Companies House, 31 juill. 2018, p. 4, en ligne : www.gov.uk/government/organisations/companies-house.
[35] Ibid.
[36] STASSEN M., « AWAL renews worldwide partnership with British rapper Little Simz », Music Business Worldwide, 18 juin 2020, en ligne : https://www.musicbusinessworldwide.com/awal-renews-worldwide-partnership-with-british-rapper-little-simz/.
[37] INGHAM T., « If you wanted to know», art. cité.
[38] Ibid. ; INGHAM T., « I look at AWAL », art. cité.
[39] STASSEN M., « AWAL renews worldwide partnership », art. cité.
[40] SNAPES L., « Little Simz cancels US tour citing financial unviability as an indie artist », The Guardian, 20 avr. 2022, en ligne : https://www.theguardian.com/music/2022/apr/20/little-simz-cancels-us-tour-citing-financial-unviability-indie-artist.
[41] STASSEN M., « AWAL renews worldwide partnership », art. cité.
[42] Ibid.
[43] HOBBS T., « Little Simz », Notion, 8 janv. 2020, en ligne : notion.online/little-simz.
[44] GARR G. G., She’s a Rebel. The History of Women in Rock & Roll, 2e éd., New York, Seal Press, 2002, p. 222.
[45] JOVANOVIC R., Kate Bush. The Biography, Londres, Piatksu, 2015, p. 67 ; GORMAN P., The Life & Times of Malcolm McLaren. The Biography, Londres, Constable, 2020, p. 323.
[46] OSBORNE R. et SUN H., « Rights reversion and contract adjustment », Intellectual Property Office, 2023, en ligne : www.gov.uk/government/publications/economics-of-streaming-contract-adjustment-and-rights-reversion/rights-reversion-and-contract-adjustment.
[47] GARR G. G., She’s a Rebel, op. cit., p. 222-223.
[48] Ibid., p. 223.
[49] Ibid.
[50] Ce contrat de licence et le premier contrat de 1976 suivaient les normes britanniques du Copyright Act de 1956, et non les normes du Copyright, Designs and Patents Act de 1988. Là où la loi de 1988 accorde la propriété au « producteur », celle de 1956 l’accorde au « fabricant », en l’occurrence « la personne qui possède l’enregistrement au moment où l’enregistrement est fabriqué» (Copyright Act, 1956, sec. 12-8). Ainsi, la seule façon pour un interprète d’obtenir la propriété des droits des masters consistait à établir sa propre société de production ou son propre label et à s’emparer du processus d’enregistrement.
[51] GARFIELD S., Expensive Habits. The Dark Side of the Music Industry, Londres et Boston, Faber and Faber, 1986, p. 19.
[52] Cet accord dura jusqu’en février 2023, lorsque State51 devint le distributeur du catalogue de Kate Bush.
[53] INGHAM T., « Kate Bush is the world’s biggest independent artist right now. she’s owning it », Music Business Worldwide, 16 juin 2022, en ligne : www.musicbusinessworldwide.com/kate-bush-is-the-worlds-biggest-independent-artist-right-now-shes-owning-it.
[54] INGHAM T., «Where are all the Kate Bush T-shirts?», art. cité.
[55] Ibid.
[56] Ibid.
[57] Women and Equalities Committee, « Misogyny in music », House of Commons, janv. 2024, par. 2, en ligne : committees.parliament.uk/publications/43084/documents/214478/default.
[58] OCDE, « Is the gender gap in entrepreneurship closing? », 2018, en ligne : www.oecd.org/cfe/smes/inclusive-entrepreneurship/gender.htm.
[59] OIT, « Promoting women’s entrepreneurship development and gender equality, phase III », 2008-2022, en ligne : www.ilo.org/asia/projects/WCMS_099683/lang–en/index.htm.
[60] HOBBS T., « Little Simz », art. cité. Simz souffre également de biais intersectionnels. Les aspects raciaux de la question de la propriété des droits d’auteur ont été explorés dans OSBORNE R., « Masters and slaves », dans R. Nolan et D. Arditi (dir.), The Palgrave Handbook of Critical Music Industry Studies, Londres, Palgrave Macmillan, à paraître.
[61] JONES D., « Little Simz is pioneering UK rap, so why won’t the industry support her? », Vice, 1er déc. 2016, en ligne : www.vice.com/en/article/xdwkpq/little-simz-is-pioneering-uk-rap-so-why-wont-the-industry-support-her.
[62] BAIN V., « Counting the music industry. The gender gap », UK Music, oct. 2019, p. 35-36, en ligne : www.ukmusic.org/wp-content/uploads/2020/09/Counting-the-Music-Industry-full-report-2019.pdf ; BUGEL S., « “This wouldn’t have happened 20 years ago.” How women began dominating british dance music », The Guardian, 5 janv. 2024, en ligne : https://www.theguardian.com/music/2024/jan/05/this-wouldnt-have-happened-20-years-ago-how-women-began-dominating-british-dance-music.
[63] SEABROOK J., Hits ! Enquête sur la fabrique des tubes planétaires, trad. H. Loncan, Paris, Philharmonie de Paris/La Découverte, 2016, p. 247-250 ; ALLEN L., My Thoughts Exactly, Londres, Blink, 2018, p. 166-167.
[64] GARNER G., « Rebalancing act », Music Week, 14 août 2017, p. 19-20.
[65] Women and Equalities Committee, « Misogyny in music», art. cité, par. 25.
[66] OSBORNE R., Vinyl. A History of the Analogue Record, Farnham, Ashgate, 2012, p. 111.
[67] BAIN V., « Counting the Music Industry», art. cité, p. 13, 18.
[68] Ibid., p. 13.
[69] OSBORNE R., « The critics’ (second and third) choice award», blog Pop Bothering Me, 17 févr. 2020, en ligne : richardosbornevinyl.blogspot.com/2020/02/the-critics-second-and-third-choice.html.
[70] SEABROOK J., Hits !, op. cit., p. 240-253 ; HEAWOOD S., « Lily Allen: “I was pretty brazen with all my behaviour. I just didn’t care” », The Guardian, 15 sept. 2018, en ligne : www.theguardian.com/music/2018/sep/15/lily-allen-brazen-behaviour-didnt-care-sophie-heawood.
[71] CRAGG M., « “I’m angry, I’m raging.” How Raye took on her record label – and won », The Guardian, 25 sept. 2021, en ligne : www.theguardian.com/music/2021/sep/25/im-angry-im-raging-how-raye-took-on-her-record-label-and-won.
[72] Ibid.
[73] NEGUS K., Producing Pop. Culture and Conflit in the Music Industry, Londres, Arnold, 1992, p. 54-55.
[74] BAIN V., « Counting the music industry», art. cité, p. 35.
[75] CRAGG M., « “I’m angry, I’m raging” », art. cité.
[76] OCDE, « Gender Equality», en ligne : www.oecd.org/gender/data.
[77] UK Music, Diversity Report 2022, p. 27, en ligne : https://www.ukmusic.org/wp-content/uploads/2022/11/Diversity-2022-Spreads-1.pdf.
[78] BUGEL S., «“This wouldn’t have happened 20 years ago” », art. cité.
[79] FORDE E., « Taylor-made deals. How artists are following Swift’s rights example », The Guardian, 9 janv. 2024, en ligne : www.theguardian.com/music/2024/jan/09/taylor-swift-deals-how-artists-rights-example.
[80] Women and Equalities Committee, « Misogyny in music », op. cit., par. 43.