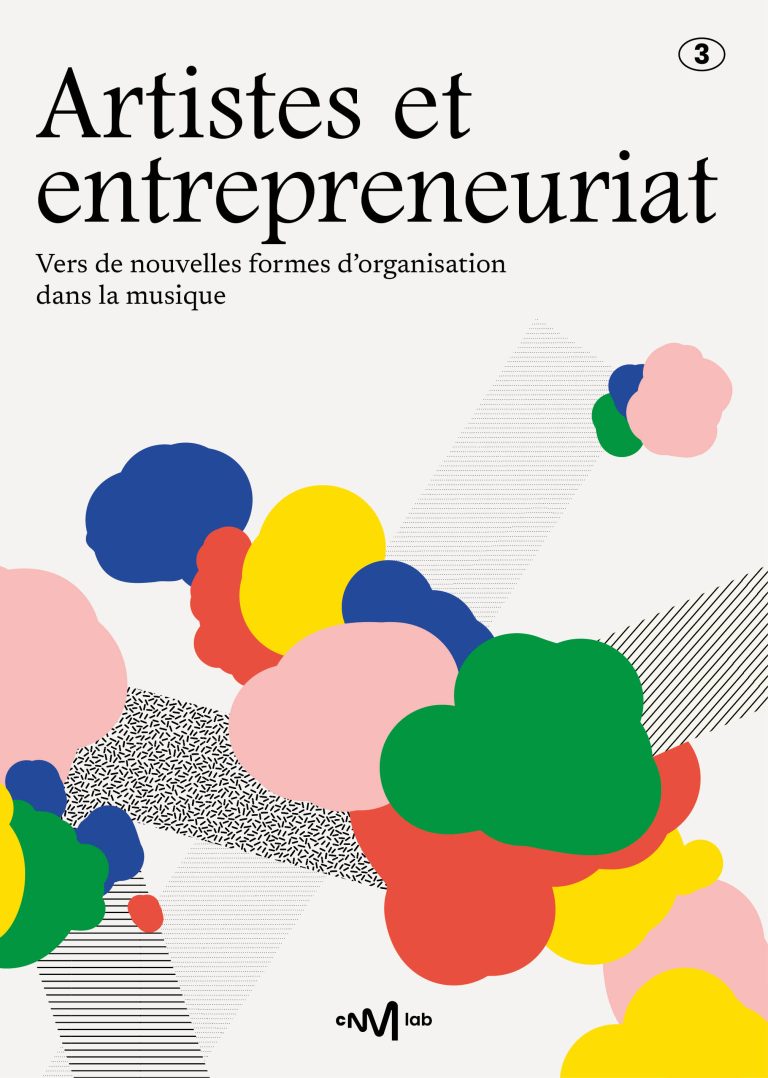Les conséquences psychosociales du do it yourself
De l’éthique à l’injonction
Introduction
Longtemps, l’impact des conditions de travail dans l’industrie musicale sur la santé mentale et physique a largement été ignoré, invisibilisant les difficultés rencontrées par une importante partie de celles et ceux s’y engageant au quotidien. Mais depuis quelques années, des artistes ayant un accès privilégié à l’arène médiatique nationale et internationale, tels qu’Avicii, Selena Gomez, Justin Bieber, Shawn Mendes, Stromae, Lewis Capaldi, Lomepal ou Bigflo et Oli, ont tenu des discours publics traitant des conséquences du travail dans l’industrie musicale sur leur propre santé, et ainsi inscrit à l’agenda des questionnements dont se sont saisis diverses institutions et collectifs professionnels.
Plusieurs sondages et études commandités par ce type de collectifs – pour certains menés par des chercheurs et chercheuses, tant à l’étranger (comme ceux de Help Musicians[1] et de Loveday, Musgrave et Gross[2]) qu’en France (à l’image de ceux portés par l’Insaart[3]et Cura[4]) – ont en effet mis en lumière des conditions de travail ayant des conséquences négatives sur la santé mentale des professionnelles et professionnels de la musique, révélant ainsi la prévalence de ces troubles. En ce sens, une étude que nous avons réalisée en 2022 pour le collectif Cura[5], avec le soutien financier du CNM et de la Guilde des artistes de la musique (GAM), a révélé que la majorité des répondantes et répondants, souvent en situation de précarité, se sentent épuisés au moins une fois par mois. De plus, près de 68 % déclarent que leur charge de travail nuit à leur vie personnelle, et 82 % admettent travailler même lorsqu’ils sont malades. Environ 77,5 % se décrivent comme « anxieux », 34 % comme « très anxieux », et 70 % mentionnent être stressés.
Bien que ces chiffres soient précieux pour mettre en lumière ces questions au sein du champ musical (voire au-delà), ils ne fournissent que peu d’informations sur l’origine de ces problématiques ou sur la façon dont elles se manifestent dans la vie quotidienne des individus. En contrepoint de ces statistiques, cette contribution cherche à examiner ce qui cause ces perturbations et comment elles sont vécues par les personnes que nous avons interrogées[6].
Mais il s’agit également de ne pas omettre le contexte au sein duquel ces dynamiques prennent place et, de la sorte, éviter de se positionner uniquement à l’échelle individuelle, du point de vue des artistes. L’enjeu est au contraire de faire apparaître ce qui les rend possibles, voire encourage un mode d’organisation du travail les favorisant.
Partant de la promesse faite par le néolibéralisme de « réussir si on le veut vraiment », nous nous attacherons donc ici à détailler ce en quoi ces injonctions sur-responsabilisant les individus peuvent induire des subjectivités particulières et entraîner des conséquences psychosociales délétères (anxiété, risque de dépression, surmenage, perte de sens). Alors qu’inscrire son activité dans l’idéologie du « faire soi-même » rappelle le do it yourself hérité des mouvements punk des années 1970, où la capacité d’action individuelle devient gage d’émancipation et génératrice de créativité[7], nous relèverons plutôt une intensification des pratiques musicales prises dans des formes de précarisation et de flexibilisation de l’activité, aux conséquences psychosociales néfastes à moyen et long terme.
La promesse de « réussir si on le veut vraiment »
Pour éclairer le contexte entourant l’apparition de nouveaux modes d’organisation, il s’agit de repartir de la circulation de discours soutenant, à partir de la fin des années 1990, le développement d’une économie dite créative, où l’artiste entrepreneur apparaît comme le parangon du futur travailleur ou de la future travailleuse, flexible et mobile. Et ce, d’autant plus à un moment où Internet et le numérique soutiennent le développement de ces perspectives, via un accès de plus en plus banalisé à toutes les étapes qui permettent aux contenus musicaux d’exister et de circuler dans l’espace public (création, enregistrement, mixage, mastering, distribution, diffusion, promotion, commercialisation).
De l’idéal de réalisation de soi par l’activité à l’injonction à entreprendre
Si le recours au travail indépendant dans les industries musicales est depuis longtemps fréquent[8], s’est récemment accentué[9] et n’est pas propre à ce secteur, nous assistons à partir de la fin des années 1990 à un glissement sémantique progressif entre travail indépendant dans la musique et entrepreneuriat. Selon nous, ce glissement résulte d’une manière nouvelle d’appréhender le travail et sa valeur dans nos sociétés, que les recherches critiques notamment inscrites en sciences de l’information et de la communication dénomment « paradigme créatif[10]». Pris dans le déploiement de l’idéologie néolibérale, ce paradigme pointe les espoirs d’une transformation du travailleur ou de la travailleuse – tels que nous les connaissions jusque-là – en travailleur ou travailleuse « créatif », construit autour du modèle archétypal de l’artiste entrepreneur[11]. Grâce à sa flexibilité et sa mobilité (tant en matière de statuts, d’activité que de lieu de création) et à sa bonne connaissance des dispositifs de propriété intellectuelle et des mécanismes de sa valorisation, l’artiste entrepreneur serait amené à jouer un rôle de plus en plus important dans une économie créative alors à venir et considérée comme « la solution pour résoudre les problèmes de développement économique, social, culturel, politique et même individuel sous toutes les latitudes[12]». Ces dynamiques d’individualisation et de flexibilisation du travail, propres à l’idéologie néolibérale et dissimulées sous un vernis créatif, trouvent alors un ancrage fort dans les activités culturelles, ces dernières étant depuis longtemps porteuses de ces dynamiques d’individualisation et de flexibilisation du travail.
La théorie des industries culturelles a en effet montré que les filières les constituant n’ont cessé de déporter autant que possible le risque sur les créateurs et créatrices (ce qu’elle nomme le « vivier[13]»). Cela permet de réduire l’incertitude de la valorisation économique de la production culturelle, en croissance continue et de ce fait en contexte de concurrence accrue. Soumettre ces travailleurs et travailleuses à la logique du « gagnant rafle la mise[14] » crée de grandes inégalités de rémunération et favorise des engagements professionnels souvent précaires, quand ils ne sont pas simplement non rémunérés[15]. Ainsi, « faire carrière » dans les industries culturelles – et a fortiori dans les industries musicales – est incertain, et pour beaucoup la précarité est une composante structurelle de l’activité, avec laquelle il s’agit de composer[16].
Accessibilité des moyens de production et externalisation des tâches vers les travailleurs et travailleuses
Parallèlement, dès les années 2000, ces changements s’accompagnent de discours sur la désintermédiation des acteurs et actrices traditionnels des industries musicales, autour d’un abaissement annoncé des barrières à l’entrée sur le marché. Ainsi, tout un chacun peut, a priori, à la fois se passer des logiques industrielles et s’y substituer, en rendant facilement accessibles, gratuitement et « sans intermédiaires » ses propres productions à des publics toujours plus étendus.
Ces discours sont avant tout l’apanage des acteurs et actrices des industries de la communication (qu’il s’agisse des fournisseurs d’accès à Internet ou des plateformes d’user-generated contents – UGC) qui ont âprement promu ces dynamiques inédites et en ont bénéficié en tant que nouveaux intermédiaires marchands. La démocratisation de la production et de la diffusion, en même temps que l’accès croissant au contenu pour les consommateurs et consommatrices a rendu difficile le fait d’être entendu parmi la pléthore de musiques proposées. Paradoxalement, les histoires de succès via des plateformes telles que MySpace, SoundCloud, YouTube, ou plus récemment Instagram et TikTok, contribuent à masquer le fait que les intermédiaires culturels, tels que les labels, continuent de jouer un rôle majeur dans l’émergence de la plupart des artistes bénéficiant de la plus grande visibilité. Ainsi, le Web n’a pas radicalement changé la façon dont les industries musicales fonctionnent, en particulier les logiques de franges et l’aspiration des productions vers le centre, décrites de longue date par la recherche les concernant[17].
Cependant, dans le domaine de la production indépendante, la numérisation et la convergence des technologies sont à double tranchant. En effet, la charge associée à la polyvalence et au multi-tâche a généralement été sous-estimée. Miroirs de mutations s’étendant à l’ensemble de l’économie[18], les industries musicales ont externalisé auprès des artistes toute une série d’activités autrefois prises en charge par des personnels spécialisés, telles que la promotion et le marketing, augmentant encore la probabilité de travailler gratuitement. Cela signifie que les musiciennes et musiciens occupent souvent plusieurs postes, voire tous les postes, dans le processus de production, de distribution et de diffusion, en tant que producteurs ou productrices de musique, ingénieurs ou ingénieures du son, graphistes, concepteurs ou conceptrices de sites Web, professionnelles et professionnels des relations presse, illustrateurs, illustratrices, photographes, agentes ou agents de réservation, comptables et gestionnaires de communauté. En d’autres termes, la polyvalence et le multi-tâche sont la norme à laquelle un grand nombre de travailleurs et de travailleuses doivent se plier.
Ainsi, derrière les opportunités d’autonomie accrue qu’offre la figure de l’artiste entrepreneur ou entrepreneuse se cache le fardeau de tout faire. Les distinctions entre artistes, techniciennes, techniciens et cadres tendent à s’estomper, une même personne devant occuper plusieurs postes en même temps, ou se concentrer sur une ou plusieurs de ses compétences en fonction du projet. Cette évolution illustre le fait que les artistes doivent de plus en plus assumer les risques financiers lorsqu’ils font de la musique.
Méthodologie et contexte de l’enquête de terrain
L’enquête se base sur soixante-dix entretiens et plus d’une centaine d’observations menées au cours de ces quinze dernières années en France auprès de musiciennes et musiciens âgés d’une vingtaine à une quarantaine d’années, pratiquant une musique populaire. Nous avons pris le parti d’analyser les conditions de vie et d’exercice de musiciennes et musiciens dont l’activité résiste bien souvent aux définitions, qu’il s’agisse de statut (évoluant dans un continuum amateur, semi-professionnel et professionnel ; l’intermittence étant une exception parmi les participantes et participants) ou de style musical (souvent fait d’assemblages hétéroclites et variant en fonction des projets musicaux). Souvent invisibles au sein des statistiques et des études, les personnes observées font partie de cette frange pourtant croissante de musiciennes et musiciens producteurs (et non uniquement instrumentistes), principalement mobilisés par la création et la diffusion. En matière de revenus, plusieurs études européennes sur les conditions de vie et de travail des musiciennes et musiciens montrent qu’un pourcentage élevé gagne peu : en France, 38 % indiquent gagner moins de 15 630 euros par an en 2021[19], et quasi le même pourcentage (37 %) de musiciens britanniques déclarent des revenus de 5 000 livres (environ 5 800 euros) en 2019[20]. Les musiciennes et musiciens « entrepreneurs » que nous étudierons dans cette contribution correspondent à cette dernière catégorie : trop engagés dans une carrière pour être qualifiés d’amateurs, ils disposent de faibles revenus tirés de l’activité musicale et sont peu insérés dans des réseaux institutionnels. Ainsi, le type de musicien ou musicienne évoqué dans cette contribution se distingue d’autres cas, comme évoqués notamment dans ce recueil[21], rémunérés par des « plans » réguliers, jouant des reprises et accompagnant des événements (mariages, salons professionnels et conventions, etc.). Bien que potentiellement précaire, cette dernière activité, plus institutionnelle, reste mieux protégée de l’incertitude, et les enjeux de projection de soi dans la création ne semblent pas y prendre les mêmes proportions.
Nos entretiens et observations ont été menés autour de concerts, de lieux de répétition, de studios d’enregistrement dédiés, et même aux domiciles des participantes et participants (les espaces étant parfois peu définis). Cette enquête fut grandement facilitée par la carrière musicale menée par l’un des auteurs jusqu’en 2014. À ce titre, le travail de collecte a souvent impliqué une participation directe aux activités (concert, enregistrement). Les matériaux étaient consignés dans des carnets de bord par la suite analysés, et à partir desquels des thèmes ont été extraits. Cette collecte de données sur un temps long permet de réduire l’illusion d’un présent faisant office de référence en étudiant les évolutions de carrières et l’impact de celles-ci sur la santé mentale des participantes et participants.
Cette contribution s’inscrit par ailleurs dans un projet plus large d’analyse de ces problématiques, où les injonctions entrepreneuriales et leurs conséquences psychosociales font écho aux subjectivités observées dans le néolibéralisme[22], et comment elles s’articulent différemment selon l’origine sociale, le sexe et le genre[23] et l’ethnicité. Alors que ces travaux portent sur des analyses qualitatives, nous avons également mené l’étude mandatée par le collectif Cura et financée par le CNM et la GAM, par questionnaire sur un échantillon de 519 personnes[24].
Évolution des conditions de travail et conséquences psychosociales
Nous souhaitons à présent examiner les conséquences psychosociales ressenties par les musiciennes et musiciens liées à la multiplication des tâches et des rôles. Bien que les propos relevés ne puissent être considérés comme représentatifs des situations vécues dans toute leur diversité, ils ont été choisis afin d’illustrer ce que l’analyse des entretiens et observations a révélé.
L’espace domestique comme lieu de vie et de travail
Les conséquences mitigées du home studio
En 1995, dans Being Digital, Nicholas Negroponte (entre autres architecte du magazine Wired ) prophétisait le passage à une ère où la production des contenus se ferait à l’échelle artisanale directement depuis les domiciles des individus (dans l’esprit des cottage industries[25]). Trente ans plus tard, comme l’illustrent les extraits infra, nous constatons qu’une grande majorité des musiciennes et musiciens interrogés « produisent » et gèrent tous les aspects inhérents à leur carrière depuis chez eux, souvent depuis le salon, la table de la cuisine ou la chambre.
La migration de la production musicale des studios d’enregistrement dédiés vers les espaces domestiques devient alors porteuse de nouvelles problématiques inhérentes à cette collusion entre les espaces. Clarisse (femme de 26 ans, bac + 3) pointe en premier lieu les risques physiques : « Je bosse la plupart du temps depuis mon lit. Alors c’est cool, mais je me pète le dos.» Si cet effacement des frontières entre espace privé et espace professionnel se fait souvent au détriment d’un confort de travail approprié, nous constatons qu’il se fait également au détriment de bonnes conditions de jeu et d’enregistrement. Julien (homme de 35 ans, bac + 4) nous explique avoir installé son studio dans sa chambre et profiter de l’absence de son colocataire la journée pour « trouver des trucs pour que ça ne sonne pas trop dégueulasse ».
J’ai essayé de m’enregistrer sous la couette. Tout le monde a déjà fait ça, mais ce n’est pas pratique, tu as la couette qui frotte et tout. Et puis ta pièce, elle sonne mal. J’ai mis de la mousse ici et là. (Julien, 35 ans, bac + 4)
La conclusion de cette tentative d’amélioration de son environnement quotidien de production lui apparaît alors claire : « Au final, ma chambre ressemble plus à une salle de répèt’ d’ado qu’autre chose. »
Certes, la miniaturisation et la digitalisation des outils de production musicale, avec la réduction du coût qu’elles engendrent, présentent un aspect positif à la possibilité de produire de la musique depuis chez soi, hors des contraintes financières liées au temps de location des espaces, du matériel et de l’expertise d’ingénieures ou d’ingénieurs du son. Mais cette collusion rend la musique particulièrement invasive dans des espaces généralement plutôt exigus.
Ces pratiques peuvent être tolérées ponctuellement, voire présenter un caractère ludique, comme nous le rappelle une autre participante :
C’est comme construire des cabanes quand tu étais enfant, sauf qu’il n’y a personne pour te dire de ranger après. (Hélène, 28 ans, bac + 4).
Mais elles peuvent difficilement être considérées comme des conditions de travail décentes au quotidien. Pourtant, faute d’une rémunération suffisante liée à la musique et étant donné le coût du logement dans la région du terrain d’enquête (Paris et sa proche banlieue), les participantes et participants voient ces formes de bricolage comme visant à devenir pérennes. Le contraste entre ces dispositions quotidiennes et l’exposition médiatique ou la reconnaissance sur scène ponctuelles qu’ils peuvent obtenir, est souvent pris sur le ton de l’humour durant les entretiens, afin de tempérer l’écart entre conditions de production et représentations publiques de leur travail.
Par ailleurs, comme pour d’autres occupations professionnelles où tout ou partie du travail se fait depuis l’espace domestique, et dans un contexte où les participantes et participants sont seuls gestionnaires de leur temps et de leurs objectifs[26], nos observations suggèrent un rapport obsessionnel à l’activité. Clarisse, après nous avoir dit « gérer tout ce qui est de l’ordre de la paperasse depuis la table de la cuisine ou depuis [son] lit », indique s’occuper de tout le reste sur son téléphone où « chaque occasion est bonne pour checker et gérer le tout ». Bien souvent, l’impossibilité de quantifier et de prévoir l’activité professionnelle induit stress et anxiété, dérègle les rythmes chronobiologiques, d’autant plus en situation de sédentarité, et augmente en définitive les risques en matière de santé mentale et physique.
J’ai un peu laissé mon corps de côté. Je n’ai pas une hygiène de vie très réglée, j’avoue. Je mange un peu n’importe quand et si je sens que je bosse bien je peux bosser une bonne partie de la nuit. (Julien, 35 ans, bac + 4)
Le fait de privilégier l’activité avant toute autre considération de confort ou d’hygiène de vie se manifeste enfin dans un apparent paradoxe. Bien souvent, les artistes rencontrés investissent beaucoup de temps et d’argent dans le matériel musical, mais peu dans l’amélioration de leur environnement de travail et son ergonomie d’ensemble. Ainsi, une grande distance entre le soin accordé à la collection de matériel et l’espace de travail en tant que tel est constatée chez de nombreux artistes. Ce qui peut paraître comme paradoxal à première vue exprime en réalité la volonté de conserver une capacité d’action sur ce qui peut être maîtrisé (l’achat de matériel) plutôt que sur l’environnement de travail, où les enquêtées et enquêtés disposent de beaucoup moins de prise dans un contexte où, comme nous allons le voir, l’accès et le maintien dans le logement sont complexes.
Ainsi, ce point de focalisation ou de déplacement n’est pas sans créer de tensions chez les participantes et participants. L’espace de travail s’avère souvent exigu et chargé, peu lumineux, mal ventilé, centré autour d’un ordinateur dont la disposition est peu ergonomique, entraînant bien souvent des postures sédentaires et des troubles musculo-squelettiques. Ajoutées à une organisation de travail peu précise et une charge de travail non limitée pouvant induire des conséquences psychosociales comme le stress et l’anxiété, ces observations s’inscrivent dans une constante : l’activité de musicienne ou de musicien, comme tout type d’activité créative, peine à être reconnue comme du travail, et échappe de fait bien souvent aux considérations sur l’élaboration de conditions décentes le concernant[27].
Accéder à un logement et le conserver
La majorité du travail des artistes rencontrés s’effectuant à domicile, la question de l’accès à un logement décent et de sa conservation, souvent impensée, prend une dimension primordiale dès lors qu’il s’agit de comprendre les conditions de production, de travail et de vie. Or, nos observations portent sur Paris et sa proche banlieue, c’est-à-dire là où se concentre la majorité des perspectives d’emploi et de carrière les plus stimulantes. Comme toute autre métropole au rayonnement international, elle se caractérise par un coût du foncier très élevé, des loyers excessifs et des conditions d’accès parfois très contraignantes. Ainsi, nos enquêtées et enquêtés ont fait part de leurs difficultés à accéder à un logement, menant parfois à des situations précaires (hébergement, sous-location sans contrat, etc.), impactant directement les conditions de vie et de travail. Des travaux de référence sur le sujet comme le « Swedish Level-of-Living Survey[28] » permettent de lier sur un temps long sécurité ontologique – condition préalable nécessaire à une vie satisfaisante et à l’épanouissement – et logement. Ils soulignent qu’en l’absence de sécurité ontologique, l’anxiété se développe. Julien semble subir cette dernière, et insiste sur les difficultés qui touchent particulièrement les musiciennes et musiciens, quel que soit leur statut :
Ici à Paris, en banlieue, personne ne te louera un truc, même si tu es intermittent, même si tu as un taux élevé d’intermittence. L’intermittence c’est considéré comme un CDD de 10 mois et demi, donc personne n’est rassuré par ça, donc il n’y a pas vraiment de reconnaissance sociale. Les gens écoutent de la musique et sont contents d’en écouter. Point. (Julien, 35 ans, bac + 4)
Étant donné la précarité vécue par les participantes et participants, les difficultés à se projeter dans l’avenir, le prix des locations et les conditions d’accès restrictives, nombre d’entre eux font preuve de débrouillardise. Grâce au réseau d’interconnaissance, ils sous-louent souvent des chambres dans des colocations ou des appartements dont les loyers restent modérés, car sous le même contrat depuis longtemps. Antoine, 28 ans, ayant réussi à obtenir depuis peu son statut d’intermittent sans toutefois parvenir à le renouveler l’année suivante, nous explique avoir récupéré l’appartement meublé de son frère, que lui-même avait obtenu d’une amie, et nous indique que cette situation reste, pour lui, un entre-deux.
Pour celles et ceux disposant d’un logement dans des conditions moins précaires, il s’agit souvent de lutter pour le conserver. Changer de logement peut ne pas être possible, même lorsque la situation individuelle évolue (séparation, naissance d’un enfant, changement de statut).
Là, je ne paye pas cher parce que ça fait longtemps que ma colocataire a l’appart, du coup elle a les prix d’il y a dix ans. Elle vivait avec son mec dans l’appart, mais ils se sont séparés et du coup elle a gardé l’appart et pris une colocation. (Gilberte, 32 ans, bac + 5)
De plus, si les enquêtées et enquêtés développent des « stratégies de la débrouille » face à la précarité et à l’incertitude liée à l’activité, elles sont souvent le résultat d’un bricolage dans les interstices des cadres de reconnaissance institutionnelle. Cela a pour effet de les contraindre dans leur quotidien (absence de contrat de travail, avis d’imposition faible). Même si nombre de participantes et participants arrivent à se maintenir dans des logements, cette incertitude liée à une composante essentielle du quotidien provoque bien une anxiété diffuse. L’étude que nous avons réalisée pour le collectif Cura indique en effet que 75 % des musiciennes et musiciens interrogés évaluent leur niveau d’anxiété à 4 sur une échelle de 1 à 9, et un peu plus du tiers entre 7 et 9, surtout chez les plus jeunes (moins de 24 ans).
Travail et aptitudes professionnelles
Des compétences multiples à acquérir
La miniaturisation et l’abaissement du coût d’accès aux moyens de production, notamment avec le passage au numérique, permettent un enregistrement de qualité à moindres frais. Les témoignages recueillis pointent le fait qu’il est devenu courant pour les musiciennes et les musiciens d’acquérir des compétences multiples, tant instrumentales qu’en matière de production musicale (prise de son, composition, mixage et mastering). Mais cela demande un temps important pour les acquérir – souvent grâce à des tutoriels en ligne –, et occupe une place toujours croissante dans l’activité.
Je fais tout moi-même (voix, synthés, batterie, guitare, basse, etc.). Au pire, je réenregistre la batterie plus tard en studio, même si franchement là, si tu programmes bien ta batterie sur l’ordi, ça le fait. (Julien, 35 ans, bac + 4)
On comprend bien la liberté offerte par la possibilité de tout faire soi-même, parce qu’elle permet de réduire les coûts associés à l’enregistrement et de dégager du temps pour composer et expérimenter in situ en étant moins subordonné à la contrainte de devoir faire appel à d’autres travailleurs ou travailleuses experts. Toutefois, les compétences requises pour enregistrer, arranger, mixer et masteriser sont complexes et leur apprentissage est chronophage. Cette tension est classique de ce que nous tentons de décrire. L’autonomie offerte par le numérique dans la production sonore est à double tranchant : à la fois émancipatrice, car elle permet une plus grande liberté, et contraignante, car elle devient injonction. Il s’agit en effet pour les musiciennes et musiciens d’apprendre à maîtriser les outils et techniques autrefois l’apanage de techniciennes et techniciens aux compétences spécifiques. Certes, les outils numériques guident fortement les artistes. Les instruments et effets en plug-in comme les préamplificateurs, compresseurs, delay et reverb simulant avec une grande fidélité des outils jusque-là utilisés dans des studios prestigieux, disposent tous de réglages prédéfinis qui facilitent leur usage et réduisent la compétence nécessaire. Mais malgré l’accessibilité accrue à ces moyens de production, un temps d’apprentissage constant – tant l’offre est pléthorique – et la multiplication des compétences requises qui en découle contraignent les participantes et participants dans leur activité au détriment de la composition – peut-être même ces distinctions entre composition, arrangement, enregistrement et mixage deviennent moins primordiales. Bertrand, 35 ans, explique en ce sens « passer des heures sur YouTube et sur les forums pour apprendre comment faire tel ou tel son. […] Un logiciel comme Logic ou [Ableton] Live, franchement tu le prends rapidement en main. Par contre, tu n’as pas idée du temps que je passe à essayer d’apprendre à enregistrer ceci ou cela. Et après, la compo, le mixage… ».
En outre, le quotidien des participantes et participants dépasse la seule maîtrise des moyens de production musicale, en s’étendant à la gestion de l’organisation et de la préparation des concerts. Il est rare de pouvoir jouer localement de manière fréquente, dès lors que l’on interprète ses propres productions musicales et que la saturation du public de la scène locale arrive rapidement. Ainsi, certaines personnes interrogées programment des concerts dans d’autres villes, souvent dans des conditions précaires et éprouvantes en matière de transport, hébergement et alimentation, et sans garantie de réelle rémunération. Dans un contexte où de nombreuses tâches leur sont assignées (promotion, prises de contact avec les programmateurs et gestion de l’organisation), le coût mental associé à cette préparation tend à éroder la motivation et l’implication. En effet, en plus du temps passé à l’apprentissage des outils et au processus d’enregistrement, Julien se dit « fatigué », avec « beaucoup d’énergie bouffée en stress» lors de ses concerts. Et de conclure : «À ce rythme-là, tu es quand même vite épuisé. »
Loin d’une seule émancipation offerte par la possibilité de choisir et organiser son temps de travail, telle que promue par les tenants de l’entrepreneuriat culturel, nous observons surtout des conséquences psychosociales délétères chez les musiciennes et musiciens. Les échéances multiples entraînent du stress, et l’incertitude constante de l’anxiété, dans un contexte de multiplication des tâches et des rôles où, comme l’indique Clarisse, « on ne sait jamais vraiment quoi faire et jamais vraiment si on fait bien ». La possibilité de tout faire soi-même se transforme en une injonction, impliquant une charge mentale nouvelle qui peut être ressentie négativement, notamment en matière de stress, que dans l’étude menée pour le collectif Cura 70 % déclarent ressentir à un niveau au moins égal à 4, et 30 % à un niveau élevé (au-delà de 7).
Musiciennes productrices, musiciens producteurs et gestionnaires : entre négociations et arrangements
Au-delà du seul processus de création et production de contenu et de gestion de l’organisation de concert évoqués précédemment, c’est bien l’ensemble de l’activité qui incombe aux artistes observés. Nombre d’entre eux décrivent combien il est chronophage d’être responsable de l’ensemble des étapes de la production, des premières ébauches à la phase de commercialisation. Là encore, au-delà de la possibilité offerte par l’autonomie acquise, il s’agit d’une situation souvent vécue comme une injonction les empêchant de se consacrer pleinement à la musique. L’extrait présenté infra illustre les inconvénients liés à la numérisation et à la convergence : bien que ces modes de production offrent beaucoup plus de liberté de développer un projet de manière autonome, ils pèsent également sur les musiciennes productrices et musiciens producteurs, obligés de tout faire par eux-mêmes, souvent au détriment de leur activité de création, entraînant de la frustration et de l’insatisfaction au quotidien.
Je fais tout moi-même. Je compose, j’enregistre, mais je fais aussi tout ce qui est management, booking, facturation, relance de facturation… Je passe l’essentiel de mon temps à faire autre chose que de la musique, en fait. (Hélène, 28 ans, bac + 4)
La multiplication des rôles incombant aux enquêtées et enquêtés implique également qu’ils se confrontent bien plus à la dimension économique de leurs contenus. Alors que l’art et le commerce semblent deux domaines idéologiquement opposés, la multiplication des tâches érode la séparation symbolique entre l’acte de création et celui de sa mise sur le marché. Dès lors, dépassant les valeurs anti-marché traditionnellement observées dans la musique, l’apparente acceptation des valeurs entrepreneuriales apparaît comme une stratégie de résistance visant à négocier à la marge entre une vision idéale de la création musicale et les compromissions avec le marché auxquelles ces enquêtées et enquêtés sont enjoints[29]. Cette stratégie de résistance n’est pas sans risque et sans vecteur de conflits internes, comme l’indique René, 29 ans, bac + 4, se disant « autoproduit ». Il explique être parvenu, après de nombreuses discussions et lectures sur l’autogestion, à développer des astuces pour « maximiser» son activité et ainsi optimiser la « monétisation » de sa production musicale. Selon lui, il s’agit de « penser stratégiquement », et ce, de la « planification du clip vidéo aux choix de la police de caractères et l’illustration de la pochette ». Conséquence de cette multiplication et de l’éparpillement des tâches à accomplir pour faire vivre son projet : « Cela m’éloigne de mon objectif premier, qui est de faire de la musique. ».
Ce détournement des participantes et participants de l’activité qui devrait être à leurs yeux centrale déclenche des frustrations et de l’anxiété : « Je cours toujours un peu après les choses, sans pour autant faire ce que j’aime », nous dit Julien. En définitive, les risques d’abandon et d’éparpillement guettent les musiciennes et musiciens, conséquences des désillusions quant à ce que revêt réellement l’activité. En d’autres termes, à côté des discours émancipateurs promouvant l’entrepreneuriat, la nécessité de la polyvalence affecte, pas toujours dans le sens souhaité, le quotidien des personnes interrogées.
Conséquences psychosociales, stratégies de résistance et gestion de soi
Les risques de surmenage liés à l’accumulation de projets
Étant donné l’incertitude et la précarité globalement observées parmi les participantes et participants, nombreux sont ceux multipliant les « projets » musicaux dans l’espoir de décupler les sources de rémunération et chances de réussite. Julien explique sentir « qu’il faut avoir beaucoup de projets pour vivre en tant que musicien », et ainsi devoir « multiplier » les opportunités, tout en cherchant à « éviter d’atteindre la limite ».
Si cette accumulation de projets fait courir le risque d’un éparpillement et d’un épuisement, à plus ou moins long terme s’ajoute le sentiment de ne pas être véritablement présent dans les projets pour lesquels ils se sont engagés. Alors que de nombreux participantes et participants décrivent des stratégies pour éviter de sombrer complètement dans l’épuisement, d’autres, devant répondre à des engagements multiples auxquels ils ne peuvent se soustraire, indiquent courir de réels risques de surmenage.
Le risque c’est que tu t’épuises, et alors là, tout part en vrille. En vrai, annuler des dates, ne pas rendre à temps des morceaux, cela peut avoir un sale effet sur ta réputation. Alors tu restes toujours un peu en dessous de la limite, juste avant que ça lâche et que tu ne puisses plus rien faire. J’ai connu ça, des moments où tu es dans ton lit et plus rien ne se passe vraiment. (Hélène, 28 ans, bac + 4)
Dans cette direction, l’étude que nous avons réalisée pour le collectif Cura a montré que seuls 5 à 6 % des personnes interrogées déclarent ne jamais se sentir épuisées physiquement et mentalement, que ce soit de manière latente ou à la fin d’une journée de travail, et que 41 % se disent « pas du tout » informées des risques liés à leur activité.
Faire collectif : entre-soi et ostracisation
L’environnement social et professionnel (les deux se confondant souvent) permet une solidarité dans la « débrouille », à travers le partage de « plans », tant pour maintenir l’activité que pour apaiser l’incertitude et le sentiment de précarité. Mais cette solidarité n’est cependant pas sans risque. Elle peut en effet participer à construire un entre-soi duquel il est difficile de s’extraire.
Je suis plutôt à la cool, même si je suis plutôt anxieux des échéances. J’ai quelques solutions, des propositions amicales, donc je ne me sens pas tout seul, un peu soutenu, donc ça va. Je ne peux pas dire que je suis à 0 [sur l’échelle concernant le stress ressenti proposée] parce qu’il y a toujours un petit stress qui traîne […]. Mais toutes mes interactions, la plupart de mes interactions sont liées à ça. (Julien, 35 ans, bac + 4)
Cette très forte implication semble par ailleurs se faire aux dépens des relations sociales en dehors de l’environnement musical, qui seraient pourtant nécessaires pour maintenir une bonne santé mentale, comme l’indiquent certains des musiciennes et musiciens rencontrés. Cette absence de distinction entre ce qui relève du personnel et du professionnel rappelle le monde connexionniste au cœur de la cité par projet décrit par Luc Boltanski et Ève Chiapello[30]. L’investissement requis par l’activité, voire le caractère invasif et obsessionnel qu’il revêt, ont des conséquences néfastes pour les individus. Le risque, comme souvent, étant que les représentations romantiques masquent des conditions de travail précaires et des comportements autodestructeurs. Bertrand illustre ce point lorsqu’il nous dit, « d’un point de vue personnel », ne pas pouvoir « construire autre chose » et « avoir un peu laissé une vie perso», justifiant cette situation par « une histoire d’environnement », où « tu croises beaucoup de musiciens, les mêmes personnes ».
Le risque est la perte de confiance dans l’environnement social, pourtant structurant au quotidien. Le regard acerbe que porte René à ce dernier, qu’il nomme le « zoo » – « Avec un ami, on appelle ça le zoo parce que c’est un peu un monde de fou où les relations aux autres sont toujours biaisées » – peut se comprendre comme une stratégie de mise à distance des tensions liées à un environnement où les distinctions entre relations en soi (et pour soi) et relations instrumentales sont floues. Il dit ainsi devoir « toujours être un peu en alerte de ce qui se trame ».
Un travail obsessionnel qui pèse à terme
Derrière l’ascétisme des carrières passionnées des musiciennes et musiciens rencontrés, on observe l’émergence de questionnements sur le devenir de tels styles de vie, souvent après plusieurs années de pratique. Loin des représentations « Sex, drugs & rockʼnʼroll » associées au milieu de la musique, nombreux sont celles et ceux qui tentent de maintenir une hygiène de vie aussi correcte que le contexte précaire le leur permet. Comme l’indique l’enquête que nous avons réalisée pour le collectif Cura, 29 % des personnes interrogées disent ne pas consommer d’alcool, 56 % en consommer entre un et deux verres par jour et 3,5 % entre cinq et plus. D’autre part, bien que les médicaments (10 %) et le THC (6 %) sont déclarés comme consommés quotidiennement, les drogues dites dures le sont de manière très occasionnelle parmi une partie résiduelle de la population étudiée (autour de 4 % par drogue). Il n’en demeure pas moins que les conditions des concerts et des tournées sont bien souvent décrites comme épuisantes.
Les modes de vie prenant les atours romantiques de la bohème artiste semblent être tolérés – voire attendus – dans la jeunesse[31]. Cependant, cet esprit de bohème laisse au fil des ans le goût amer d’un vernis passé peinant à masquer une précarité bien installée et ses conséquences psychosociales et physiques. L’investissement requis par l’activité musicale, ainsi que les choix de vie induits semblent laisser chez beaucoup de participantes et participants une certaine rancœur, que les quelques gratifications symboliques, ces « succès d’estime » (comme des concerts ou tournées bien menés, une signature chez un label ou une institution prestigieuse), peinent à contrebalancer. Aussi, ce qui nous intéresse ici n’est pas tant d’observer les entrées dans les carrières musicales que les conséquences psychosociales de leur maintien à plus ou moins long terme.
Parmi les musiciennes et musiciens rencontrés, Antoine, 28 ans, « intermittent de l’intermittence », explique par exemple ne rien construire « à part ça » : « Je n’ai rien, je ne possède rien, mais rien quoi… À part du matos de musique, je n’ai pas de bagnole, pas d’appart… Voilà, j’ai un ordi, un machin pour faire de la musique…» Poursuivant son propos sur le caractère invasif et obsessionnel de son activité, il dit avoir l’impression « que c’est un truc qui n’a pas de limites », y penser « en permanence », situation aggravée à ses yeux par le fait de ne pas avoir de « petite amie », « pas d’enfants », et d’être ainsi « en permanence en train d’y penser». Une autre musicienne rencontrée, Hélène, va dans le même sens en disant être anxieuse en raison du fait que « toute sa vie soit en stand-by », et que finalement « tout passe après la musique ».
Certes, la place centrale qu’occupe la musique dans la vie des individus est un élément de définition de soi et permet de développer des liens affectifs stimulants. La réduction des coûts et l’engagement dans l’activité ouvrent également des perspectives stimulantes. Mais l’indivision entre le travail et le loisir, l’absence de distinction entre le réseau social privé et professionnel, en font une activité envahissante et ostracisant (c’est-à-dire isolant socialement) les participantes et participants. Ces dynamiques contribuent de la sorte à renforcer un rapport obsessionnel à celle-ci, duquel il peut sembler difficile de sortir, pour en fin de compte accroître l’anxiété et l’humeur dépressive en réduisant les perspectives de vie offertes. Tout comme pour d’autres activités, ces carrières « passion » sont pensées à l’écart du monde du travail « ordinaire[32] », faisant écho aux injonctions contemporaines à devenir soi[33].
Déni et déplacement de l’objet : se blâmer plutôt que blâmer les conditions structurelles
Bien souvent, les personnes rencontrées ont éprouvé quelques marques de reconnaissance – de la part du secteur et du public – ayant permis le développement d’une carrière. Mais en l’absence de normes, de soutien institutionnel et de perspectives réelles auxquelles se raccrocher, elles restent dans le flou concernant les manières dont l’activité peut s’organiser à long terme, et remettent ainsi en question leurs attentes concernant l’avenir. Au cours des entretiens, les musiciennes et musiciens tendent souvent à se blâmer pour les conséquences de conditions structurelles dont ils sont pourtant les premières et premiers à pâtir. Cette tendance est à la fois cause et conséquence d’une subjectivité néolibérale où la responsabilité individuelle serait surinvestie[34]. Les propos de Clarisse sont éclairants à ce propos :
Mais c’est de ma faute. Je suis feignante. Je devrais travailler plus. Certains pensent que je suis productive, mais c’est une illusion. Je suis la maîtresse de la procrastination. J’ai même fait une thérapie à ce propos (rire). Clarisse (26 ans, bac + 3)
Nombreux sont les exemples illustrant cette tendance à s’en vouloir de ne pas pouvoir prendre soin de soi et être plus performant, plutôt qu’à s’en prendre aux logiques inhérentes au système qui créent ces tensions et troubles. Gilberte nous dit à propos de son activité « partir dans tous les sens », contrairement « à des gens qui ont un processus de travail », avec des horaires établis, et de ce fait « y penser en permanence, jusqu’à ce que ce soit fini ». Antoine, quant à lui, dit « culpabiliser » dans les moments où il ne travaille pas, tout en regrettant le fait que cette culpabilité ne le « force pas à travailler ». Ce que je fais est proche de l’artisanat et je pourrais booster ma créativité en me forçant à être ultra régulier tous les jours.
Enfin, la pression mise sur les attributs de la réussite peut d’autant plus renforcer cette réaction, en entraînant du stress sur des événements précis tels que la sortie de nouveaux morceaux, les concerts, etc., souvent associé à une anxiété plus diffuse liée au contexte dans lequel se déroule l’activité. Julien nous décrit le lien qu’il fait entre des ambitions difficilement atteignables provoquant stress et anxiété, et sa manière, avec l’expérience, de les gérer :
Du stress ? J’en ai un peu en permanence. Après, les pics de stress sont vraiment liés à des échéances particulières, mais c’est quelque chose que j’arrive de mieux en mieux à gérer. Avec l’expérience, je mets beaucoup moins d’enjeux, je me dis si ça ne marche pas c’est pas grave, voilà où j’en suis à ce stade-là.
Tout comme pour les exemples précédents, ce processus peut être vu comme une stratégie de résistance à une forme de subjectivité néolibérale portant un individu conquérant tenu à la réussite, dans un contexte où la distinction entre le producteur ou la productrice et le fruit de sa production est mince, alors même qu’il s’agit d’un milieu compétitif où l’échec est plus commun que le succès.
Conclusion
En définitive, cette responsabilisation à outrance, revers d’une médaille tout à fait séduisante faisant la promotion d’un individu autonome, tend à déconsidérer l’impact sur la santé mentale et physique de celles et ceux qui la portent. De possibilité de tout faire soi-même, nous passerions, de manière assez débridée, à l’injonction de tout faire soi-même. Ces dynamiques, que la numérisation et la convergence accompagnent, deviennent dès lors synonymes de polyvalence et de multitâche[35] à toutes les étapes de la production, depuis l’enregistrement (multi-instrumentalisme) à la production-commercialisation (le Web dit collaboratif favorisant la diffusion et l’autopromotion) jusqu’à la gestion administrative et financière (recherche de subventions et prise de risque économique).
Mais nous avons pu voir que malgré les injonctions faites aux individus à se penser comme entrepreneurs ou entrepreneuses, ils peinent souvent à s’imaginer comme tels. Le terme d’entrepreneuriat pourrait en réalité être considéré comme une notion floue légitimant une accumulation des tâches laissées à ce que certains travaux nomment « l’artiste en porteur de projet[36]». Faite de flexibilisation et de capacités d’adaptation à la mobilité, cette forme d’organisation du travail présente dans la musique, comme nous avons cherché à le montrer, s’observe de manière plus générale dans d’autres secteurs d’activité et pourrait être considérée comme s’inscrivant dans les dynamiques d’« uberisation » de nos sociétés contemporaines. À la différence près que les musiciennes et musiciens rencontrés ne s’imaginent pas en tâcherons : la production culturelle présente cette particularité que les individus se projettent dans leurs productions. L’espoir de réalisation de soi dans l’activité s’inscrirait en effet dans un contexte d’« injonction à être soi », constante observable à l’ensemble des sociétés contemporaines occidentales, « où tout est possible, mais rien n’est vraiment réalisable[37] ».
Enfin, les « solutions » proposant d’intervenir à l’échelle individuelle sur des problématiques pourtant rencontrées par beaucoup, nous semblent être certes de potentielles aides ponctuelles, mais perpétuent une responsabilisation individuelle à outrance, qui mettent au second plan l’origine structurelle des problématiques rencontrées. Face aux défis majeurs que rencontrent ces musiciennes et musiciens, les réponses collectives à la précarité et aux conditions de travail et de production nous apparaissent, plus que jamais, essentielles[38].
[1] « Three in ten musicians report having low mental wellbeing – with those at the start of their career most impacted », Help Musicians, 23 nov. 2023, en ligne : https://www.helpmusicians.org.uk/media-and-press-office/three-in-ten-musicians-report-having-low-mental-wellbeing-with-those-at-the-start-of-their-career-most-impacted.
[2] LOVEDAY C., MUSGRAVE G. et GROSS S. A., « Predicting anxiety, depression, and wellbeing in professional and nonprofessional musicians », Psychology of Music, vol. 51, n° 2, 2023, p. 508-522, en ligne : doi.org/10.1177/ 03057356221096506.
[3] En ligne : www.insaart.org/l-%C3%A9tude.
[4] En ligne : www.cura-music.org/ressources.
[5] VACHET J., BUBENDORFF S. et GOURVÈS M., « Enquête sur le bien-être et la santé mentale dans l’industrie musicale en France», 2022, en ligne : hal.science/hal-03683731.
[6] Les entretiens, observations et analyses servant de base à cette contribution ont été menés par Jérémy Vachet. Pour de plus amples développements, voir VACHET J., Fantasy, Neoliberalism and Precariousness. Coping Strategies in the Cultural Industries, Bingley, Emerald Publishing Limited, 2022, en ligne : hal.science/hal-03631878 ; VACHET J., « “L’utopie, c’est pas pour tout le monde.” Inégalités de carrières et ajustements des musiciennes indépendantes », Biens Symboliques/ Symbolic Goods, à paraître.
[7] HEIN F., « Le DIY comme dynamique contre-culturelle ? », Volume !, vol. 9, no 1, 2012, p. 105-126.
[8] MIÈGE B., The Capitalization of Cultural Production, New York, International General, 1989.
[9] MENGER P.-M., Le travail créateur. S’accomplir dans l’incertain, Paris, Gallimard/Seuil, 2009.
[10] MŒGLIN P., « L’hypothèse d’un paradigme créatif sociétal », Communication, vol. 36, no 1, 2019, en ligne : doi.org/10.4000/communication.9702.
[11] BOUQUILLION P., « Les industries et l’économie créatives, un nouveau grand projet ? », dans P. Bouquillion (dir.), Creative Economy, Creative Industries. Des notions à traduire, Vincennes, Presses universitaires de Vincennes, 2012, p. 5-46.
[12] Ibid. ; voir aussi MATTELART A., Diversité culturelle et mondialisation, Paris, La Découverte, 2017.
[13] MIÈGE B., The Capitalization, op. cit. ; voir aussi MAGIS C., « Une marche “manquée” dans l’histoire du capitalisme médiatique ? Analyse des mutations du rôle des droits dans l’industrie musicale », Les Enjeux de l’information et de la communication, vol. 23, no 3, 2022, p. 37-54, en ligne : www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2022-3-page-37.htm.
[14] CAVES R. E., Creative Industries. Contracts Between Art and Commerce, Harvard, Harvard University Press, 2000.
[15] PERRENOUD M., Les musicos. Enquête sur des musiciens ordinaires, Paris, La Découverte, 2007. Voir aussi SINIGAGLIA J., « Le bonheur comme rétribution du travail artistique. De l’injonction à l’incorporation d’une norme », Sociétés contemporaines, vol. 91, no 3, 2013, p. 17-42.
[16] BATAILLE P., CASSE R. et PERRENOUD M., « Rythmes et ancrages sociaux des carrières musicales “ordinaires”. Le cas de la Suisse romande », Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. 50, n° 2, 2019, p. 75-99.
[17] HUET A. et al., Capitalisme et industries culturelles, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1978.
[18] BOLTANSKI L. et CHIAPELLO È., Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999 ; LASH S. et URRY J., Economies of Signs and Space, Londres, Sage, 2000 ; MENGER P.-M., Portrait de l’artiste en travailleur, Paris, Seuil, 2003.
[19] VACHET J., BUBENDORFF S. et GOURVÈS M., « Enquête sur le bien-être », art. cité.
[20] HESMONDHALGH D. et al., « Music Creators’ Earnings in the Digital Era», Newport, The Intellectual Property Office, 2021.
[21] Voir au sein de ce recueil l’article de Marc Perrenoud, « “Se réinventer”. La romantisation d’une injonction néolibérale à l’adresse des musiciennes et musiciens en temps de Covid », p. 49.
[22] VACHET J., Fantasy, Neoliberalism and Precariousness, op cit.
[23] VACHET J., « “L’utopie, c’est pas pour tout le monde” », art. cité.
[24] VACHET J., BUBENDORFF S. et GOURVÈS M., « Enquête sur le bien-être », art. cité.
[25] NEGROPONTE N., Being digital, New York, Knopf Doubleday Publishing Group, 1996, p. 57.
[26]GREGG M., Work’s Intimacy, Cambridge, Polity Press, 2011
[27] HESMONDHALGH D. et BAKER S., Creative Labour. Media Work in Three Cultural Industries, Londres, Routledge, 2011.
[28] « Swedish Level-of-Living Survey», Swedish Institute for Social Research, 2017, en ligne : www.sofi.su.se/english/2.17851/research/three- research-units/lnu-level-of-living/the-swedish-level-of-living-survey-lnu-1.65112.
[29] MCROBBIE A., « Clubs to companies. Notes on the decline of political culture in speeded up creative worlds», Cultural Studies, vol. 16, n° 4, 2002, p. 516-531 ; KLEIN B., MEIER L. M. et POWERS D., « Selling out. Musicians, autonomy, and compromise in the digital age », Popular Music and Society, vol. 40, n° 2, 2017, p. 222-238.
[30] BOLTANSKI L. et CHIAPELLO È., Le nouvel esprit, op. cit.
[31] ALLEN K., « Top girls navigating austere times: interrogating youth transitions since the “crisis” », Journal of Youth Studies, vol. 19, n° 6, 2016, p. 805-820.
[32] BERTRAND J., « Entre “passion” et incertitude. La socialisation au métier de footballeur professionnel », Sociologie du travail, vol. 51, n° 3, 2008, p. 361- 378 ; JOURDAIN A., « Faites de votre passion un métier », La Nouvelle Revue du travail, vol. 13, 2018, en ligne : journals.openedition.org/nrt/3870 ; LORIOL M. et LEROUX N. (dir.), Le travail passionné. L’engagement artistique, sportif ou politique, Toulouse, Érès, 2015.
[33] EHRENBERG A., La société du malaise. Le mental et le social, Paris, Odile Jacob, 2010 ; HONNETH A., « Organized self-realization. Some paradoxes of individualization », European Journal of Social Theory, vol. 7, n° 4, 2004, p. 463-478 ; GIDDENS A., Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge, Polity Press, 1991.
[34] VACHET J., Fantasy, Neoliberalism and Precariousness, op. cit.
[35] CHRISTOPHERSON S., « Beyond the self-expressive creative worker. An industry perspective on entertainment media », Theory, Culture & Society, vol. 25, n° 7/8, 2008, p. 73-95 ; MEIER L. M., « Popular music making and promotional work inside the “new” music industry», dans J. O’Connor. et K. Oakley (dir.), The Routledge Companion to the Cultural Industries, Londres, Routledge, 2015, p. 11-24.
[36] ROUZE V. et MATTHEWS J., « Les plateformes de crowdfunding culturel. Entre figures de l’artiste entrepreneur et entrepreneurs polymorphes », Les Enjeux de l’information et de la communication, vol. 1, n° 19, 2018, p. 35-50.
[37] EHRENBERG A., La fatigue d’être soi. Dépression et société, Paris, Odile Jacob, 1998 ; HONNETH A., « Organized self-realization », art. cité.
[38] À l’instar d’initiatives se développant à l’international. Voir : culturalworkersorganize.org.