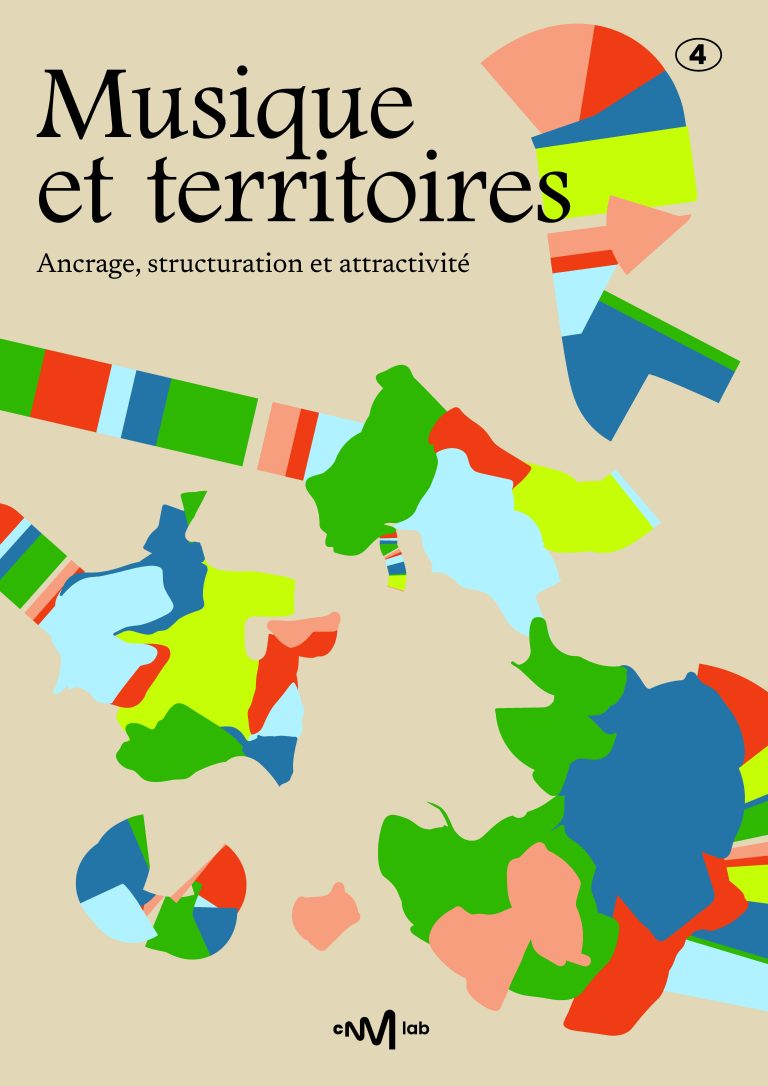L’Estafette : un projet en itinérance pour une fabrique des territoires ?
Introduction
Figure 1. Carte « Localisation du Carmausin-Ségala », réalisée par Tschubby, traduite de l’allemand. License : CC BY-SA 3.0
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GNU_Free_Documentation_License,_version_1.2)

Depuis juin 2023, trois associations – l’Association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL), Pollux Asso et l’X Fest Organisation[1] – portent ensemble un dispositif scénique itinérant original, « l’Estafette », dont l’objectif est de renforcer le lien social par la musique dans un territoire rural, le Ségala (voir figure 1). Un camion remorquant une buvette fonctionnelle se transforme, en trois heures, en une scène de 35 mètres carrés, le tout dans un style Art nouveau, fruit de la collaboration avec l’atelier toulousain Bakélite. Ce dispositif vise à offrir une prestation « clés en main » d’événements culturels gratuits pour les communes en déficit d’équipements, comme c’est le cas en Ségala. Cette région naturelle, faite de collines et de vallées parfois encaissées, dont une partie est un ancien bassin minier, comme en témoigne la toponymie (Blaye-les-Mines, Cagnac-les-Mines), est à cheval entre les départements du Tarn et de l’Aveyron. Certains villages sont difficiles d’accès et les structures sont peu nombreuses. Le constat est partagé par les élues et élus, qui voient d’un bon œil ce projet d’itinérance culturelle, lauréat du budget participatif de la région Occitanie en 2021. Les trois associations ont collaboré afin d’obtenir les financements et continuent de se partager les équipements.
La ruralité est un objet de recherche ancien, dont Marc Bloch et l’École des Annales soulignaient déjà la transdisciplinarité[2]. La culture en milieu rural a ainsi été étudiée par le prisme des politiques culturelles[3], mais aussi évidemment par celui de la géographie. Claire Delfosse met par exemple en avant le « renouveau de l’intérêt des artistes pour la campagne[4] » ; la géographe décrit une tendance à la « co-construction urbain-rural[5] » de projets culturels, questionnant même « la fin d’un antagonisme[6] » entre villes et campagne. Nombre d’études mettent l’accent sur « les vertus territoriales de la culture[7] » et son rôle dans le développement local des territoires. Vincent Guillon et Pauline Scherer relèvent cependant que la culture est souvent parée d’attributs contradictoires, devant tout à la fois « assurer l’attractivité et la compétitivité des territoires […], participer au développement économique et touristique, renforcer des liens sociaux distendus, générer des points de référence identitaire pour les sociétés locales, etc.[8] ».
La ruralité est encore souvent réduite au cliché de désert culturel ou, à tout le moins, de zones où l’accès à la culture est plus difficile, notamment pour des raisons de mobilité et d’infrastructures. Or non seulement la culture y est et y a toujours été bien présente[9], mais la ruralité peut être a contrario un terrain favorable à la réinvention des industries culturelles et créatives (ICC)[10], par les innovations culturelles qui s’y produisent et la façon dont une nouvelle territorialisation de l’offre culturelle s’y construit[11]. L’Estafette nous semble s’inscrire dans ce cadre : c’est pourquoi, à l’occasion d’une date du Ségala Music Tour organisé par Pollux Asso dans le Tarn, nous décidons de nous rendre sur place.
Suivre les routes de l’Estafette en Ségala permet de découvrir de nouveaux lieux, même quand on est de la région. Le paysage qui s’offre à nous, fait de puechs (monts) et de nombreux cours d’eau, tient toutes ses promesses en cette fin de mois d’août. Dans le village de Montirat où nous arrivons par une route étroite et pentue, rien ne laisse présager la foule qui s’amassera le soir, si ce n’est les personnes bénévoles de Pollux et de l’X Fest Organisation déjà présentes et qui nous font bon accueil. Elles viennent de terminer le montage de la scène et de la buvette, et l’impression est saisissante. Sur une place de taille modeste, que dominent une église et son parvis, la structure en métal a été installée et ne jure en rien avec le patrimoine existant. Un poteau électrique, planté à côté de la petite bâtisse en pierre où se trouve la mairie, fournit l’électricité. La buvette a été montée près de la scène, mais c’est sur le parvis de l’église que le traiteur du village a installé les barbecues qui serviront à préparer les grillades pour le public.
Le centre de Montirat se compose d’une dizaine d’habitations regroupées sur les hauteurs autour de l’église et, bien que l’intérieur entièrement peint de l’édifice religieux soit très beau et que celui-ci ait vu naître Bernard-François Balssa, le père d’Honoré de Balzac, la commune reste en dehors des circuits touristiques. Qu’est-ce qui a bien pu alors mener l’Estafette jusqu’ici ? Comme nous le raconte David Papaïx, président de Pollux, c’est un musicien anglais installé à Montirat, Howard Johnson, qui, ayant entendu parler de l’Estafette, s’est rendu dans les bureaux de l’association à Albi pour proposer une date chez lui. La proposition a ainsi été retenue pour s’inscrire dans le Ségala Music Tour, et les élus locaux ont été contactés. L’anecdote est révélatrice de l’usage de l’équipement qu’envisagent les responsables des associations concernées. Tandis que nous discutons avec les membres de Pollux et de l’X Fest, dont le style vestimentaire témoigne de l’héritage punk rock de ces associations, le public arrive à pied, la configuration du lieu les obligeant à se garer en bas du village. Bientôt la place devient noire de monde et Montirat résonne de façon inattendue de rires, de chants et de rock. Est-ce à dire que l’événement est une réussite ?
S’interroger sur la réussite du projet, c’est mettre en lumière, dans les discours des acteurs et des actrices, la concordance ou non de leurs attentes. Par exemple, les attentes des responsables associatifs, qui veulent faire de ces manifestations des moments de rencontres ; celles des publics, qui soulignent la convivialité de l’événement ; celles des pouvoirs publics, qui se félicitent de l’opération et du consensus qu’elle semble faire autour d’elle. Cette concordance n’est pas si commune : il faut voir ce qui a conduit à son émergence. Néanmoins, cette réussite apparente semble également avoir ses limites. De fait, l’isolement de l’Estafette dans le paysage culturel local la fragilise. De plus, si l’un des objectifs déclarés est bien de promouvoir les musiques actuelles, les problèmes d’« adressage » – qui correspond selon Gilles Brougère et Sébastien François à « la façon dont un produit, dès sa conception, prend en compte son destinataire que cela soit de façon organisée et rationnelle ou intuitive voire fantasmée[12] » – et de liberté de programmation sous conditions, ainsi que la nécessité même de maintenir le consensus, ne mettent-ils pas à mal la découvrabilité qui semblerait induite par les intentions des associations ? L’Estafette est d’abord l’histoire d’une élaboration collective. Mais comment ces liens collaboratifs se sont-ils établis, et autour de quels objectifs ?[13]
Une histoire de concordances
L’Estafette est avant tout une histoire de concordances. Concordance des temps, d’abord, entre une réflexion amorcée en amont par les responsables associatifs et un budget participatif régional proposé en 2021 ; concordance et collaboration entre associations, ensuite, pour le montage du dossier, et qui restent nécessaires au bon fonctionnement du dispositif. La réflexion a bien comme point de départ un « constat commun d’un manque d’équipements culturels en milieu rural[14] » :
On est partis de notre expérience des besoins qu’on estimait qu’il y avait sur les territoires […] : pas de matériel, difficulté d’avoir des prestataires du spectacle qui puissent venir à des tarifs qui correspondent à une économie de culture en milieu rural. [Rire.] […] La scène, le bar, le sol, la lumière : il fallait qu’on ait le moins de frais possible, après, à mettre en œuvre, pour que l’événement puisse avoir lieu dans le village. (David Papaïx, président de Pollux Asso)
Les anciens lieux de socialisation ont disparu, la rencontre ne se fait plus. (Basile Delbruel, co-directeur de l’AJAL)
L’objectif est bien de revitaliser les territoires, le dispositif étant pensé comme une « fabrique » des sociabilités. En effet, les communes qui composent le territoire possèdent peu de structures capables d’accueillir du public[15]. L’offre culturelle est rare, et les villes d’Albi et Rodez sont déjà lointaines (respectivement à 45 minutes et 1 heure en voiture de Montirat). L’Estafette est née de ce besoin, avec une volonté forte si ce n’est d’« apporter la culture dans les territoires[16]» – termes symptomatiques d’une vision parfois caricaturale de la démocratisation culturelle –, du moins de proposer de la musique amplifiée dans les villages. Les références à l’éducation populaire sont présentes dans les discours, mais l’accent est mis sur l’ancrage local. Habitant le Ségala aveyronnais, Basile souligne l’importance d’un maintien des événements culturels dans le Ségala pour lui et ses proches :
Nos territoires, on les habite. Il y a un défi qui est, du coup, le lien social.
Membre du groupe punk Dirty Fonzy, David met en avant l’auto-organisation héritée du do it yourself (DIY) – en français « fais-le toi-même » – punk ; selon lui, l’initiative ne peut être un succès que si le public se sent participant de l’événement mis en place :
Et comme Pollux Asso a aussi cet historique d’être basée sur du do it yourself au tout début, sur la réunion de quelques groupes de punk rock, de metal, ou de musiciens locaux qui avaient zéro euro pour organiser et faire des choses, on a quand même toujours gardé un petit peu ce truc de faire nous-mêmes. En fait, on s’est dit que le mieux, pour aller faire des concerts dans des bleds où, mis à part de l’électricité, il n’y aura pas grand-chose, c’est d’avoir un équipement.
Les entretiens traduisent également une remise en question commune, renforcée par la pandémie de Covid-19, du mode de fonctionnement jusqu’alors utilisé. En effet, dès mars 2020, les autorités françaises ont instauré des mesures d’urgence entraînant la fermeture des lieux de spectacle vivant. Bien que le secteur culturel ait bénéficié de dispositifs de soutien économique et d’aides spécifiques, le secteur musical – et plus particulièrement le live – en est ressorti fragilisé. Entre 2019 et 2020, les recettes de billetterie ont chuté de plus de 80 %, et les habituées et habitués des concerts ont difficilement repris le chemin des salles en sortie de confinement[17]. Cette crise du Covid a ainsi accéléré le besoin de changement et d’élaboration d’un modèle alternatif : c’est désormais au concert de venir directement au public.
L’objectif est bien de revitaliser les territoires, le dispositif étant pensé comme une « fabrique » des sociabilités. […] L’Estafette est née de ce besoin, avec une volonté forte si ce n’est d’« apporter la culture dans les territoires »– termes symptomatiques d’une vision parfois caricaturale de la démocratisation culturelle –, du moins de proposer de la musique amplifiée dans les villages.
La réponse au budget citoyen participatif lancé par la région Occitanie en 2021 a été l’occasion de concrétiser le projet Estafette, et fournit un bon exemple de l’efficacité d’une mise en collaboration d’associations. En effet, afin de recueillir le maximum de voix, l’AJAL, Pollux Asso et l’X Fest Organisation ont décidé de réunir leurs forces, leurs réseaux. Elles montrent ainsi que des structures diverses, établies dans des départements différents, peuvent collaborer pour bâtir un projet pertinent pour le territoire.
Pour faciliter le financement de l’ensemble, le camion, qui fait également office de bar, appartient à l’AJAL, et la scène à Pollux. Ainsi monté, ce projet à cheval entre deux territoires remporte le budget participatif en seconde position derrière un projet de parc préhistorique dans le Gers. Ces financements servent à payer la construction de l’Estafette ainsi que l’atelier toulousain (Bakélite)[18] qui en a réalisé le décor. Une fois l’équipement obtenu, il ne restait plus qu’à le faire « tourner ». En réalité, l’AJAL et Pollux n’avaient pas attendu pour mettre en place leurs projets d’itinérance culturelle. Pollux a lancé le « Ségala Music Tour », dont on peut déjà noter l’aspect performatif pour le territoire, l’année précédant le financement régional, puisque le simple nom du projet inscrit l’espace géographique dans une réalité sociale. C’est bien dans cette perspective qu’a été pensée l’Estafette, c’est-à-dire comme un objet facilitant les projets et dont chacun et chacune peut s’emparer :
Je la vois comme un moyen de production. C’est-à-dire comme un moyen pour nous d’aller développer de nouveaux projets et de s’appuyer là-dessus pour vraiment répondre au fond du projet associatif de Pollux, qui est, pour moi, de créer des moments de rencontre, de partage, des moments un peu suspendus, de liberté, qui appartiennent aux gens qui sont là sur ce moment-là très précis. (Aude Esquilat, directrice administrative et financière de Pollux)
L’Estafette est ainsi utilisée côté tarnais à l’occasion de l’Xtreme Fest, pour le off du festival Pause Guitare et principalement, donc, pendant le Ségala Music Tour, pour 4 à 5 dates par an. Côté aveyronnais, l’équipement a été beaucoup utilisé pour des événements culturels variés. Pour l’été 2023, le site de l’AJAL indique au total 11 événements, dont deux festivals organisés dans 14 communes du Ségala tarnais et aveyronnais, 39 groupes présentés et des dizaines de milliers de personnes présentes.
Une soirée réussie ?
La présentation de l’Estafette par les associations met au cœur du projet la « convivialité » et la création « du lien par la culture[19] ». L’ambition des trois structures est bien de construire un espace et un temps de socialisation par la musique. Comment cela se traduit-il, et pouvons-nous qualifier les exemples que nous avons observés de « réussites » ? C’est dans l’équipement lui-même que se trouve un premier élément de réponse. En effet, la collaboration avec l’atelier Bakélite de Toulouse a permis la construction d’un objet artisanal reconnu pour son esthétique. Il est parfois, comme nous le dit David, un premier médium de communication avec les habitantes et habitants, qui reconnaissent la quantité de travail nécessaire à son élaboration :
L’idée de travailler la ferraille, c’était de travailler de manière artisanale. Dans le projet de l’Estafette, il y a « la valeur travail » qui ressort. Elle est aussi vachement importante dans le territoire, notamment dans l’intégration des gens. L’idée, c’était que quand les gars du territoire arrivent devant l’Estafette, ils font : « Ah ouais, ils ont bossé. » […] À chaque fois qu’on va dans un village, qu’on monte l’Estafette, tu peux être sûr que l’agriculteur du coin qui est hyper bricoleur, s’il passe avec son tracteur ou sa voiture, il va s’arrêter […], et ça crée une connexion qu’il y aurait pas du tout eu si on avait posé quatre planches pour faire une scène et juste un concert comme ça. […] L’idée, c’était justement de pouvoir quand même parler à tout le monde, même si la proposition musicale, c’est pas un baloche.
Cette reconnaissance du travail manuel évoque l’« habitus de l’artisan » décrit par Marc Perrenoud dans ses enquêtes menées dans le Luberon. La figure de « l’artisan-bricoleur », qui en est l’une des incarnations, était surreprésentée au sein des mondes ruraux qui composent le Midi[20], avant l’apparition aujourd’hui d’une nouvelle population de « néo-ruraux », témoignant de la recomposition sociologique récente de la population[21]. On peut donc voir, dans la reconnaissance mutuelle de cette forme d’« effort », la manifestation d’une première stratégie de réduction de la distance entre les structures et leur public en ruralité. Elle est un indice fort que l’événement ne se réduit pas à la diffusion de musique, comme le prévenait David :
L’idée, c’est de créer un moment aussi de partage des habitants. Mais pas que forcément par rapport aux concerts. Donc le concert est aussi un peu un prétexte en fait pour créer un moment social et culturel.
Les discussions au comptoir de la buvette, ouverte une heure avant le concert, et l’odeur des grillades émanant des barbecues installés sous le porche de l’église qui surplombe la place de Montirat sont d’ailleurs les premiers signes festifs que nous identifions en arrivant sur place. Or ces moments de commensalité constituent un aspect central de notre réflexion. En effet, les repas servis par un traiteur du village signalent la collaboration entre plusieurs structures lors de l’événement et renforcent de fait la convivialité. Cet échange de services montre comment les parties coopèrent à la réussite d’un moment dont elles vont retirer, elles et les publics, le meilleur bénéfice : l’Estafette sollicite des entreprises ou des associations locales qui prennent en charge le catering, en échange de quoi ces dernières récupèrent de quoi se financer. Les tables dressées entre l’église et la mairie se remplissent et s’animent tandis que la nuit tombe. Comme le souligne le maire de Montirat, si le succès d’une soirée est évalué selon le nombre de repas servis, les 250 couverts permettent de mesurer quantitativement un pan de cette réussite.
Mais d’autres critères sont à considérer, car le service de bouche ne prime pas sur d’autres considérations ou représentations de la bonne tenue de l’événement. Tout concourt à nourrir le bonheur du moment : on vient aux soirées Estafette pour écouter de la musique, se retrouver et manger ensemble, et on ne saurait définir un ordre de priorité.
Les tables municipales orange dressées devant les planchas rappellent l’ambiance de la fête de village. Cet aspect nourrit une comparaison que nous entendons dans les entretiens avec le public. David l’évoque également dans le choix de l’espace (la place du village) où se déploie l’Estafette :
L’idée, c’est d’aller à l’endroit, dans un village, où déjà il s’y passe quelque chose, parce que c’est pas forcément évident de ramener les gens, notamment quand un projet qui n’est pas résident [du village même] ou quoi, qui peut être considéré un peu hors-sol, des fois. L’idée est de créer une vraie dynamique humaine et sociale autour d’un moment. C’est ce qu’on dit aux élus aussi, c’est un moment de convivialité : restauration, buvette, musique.
Basile souligne quant à lui que « les locaux viennent aussi parce qu’ils peuvent avoir quelque chose qui ressemble à une fête de village en étant plus pimpé ».L’ancrage dans le territoire passe également par un recrutement de bénévoles locaux, que les trois associations justifient par une volonté de se rapprocher du par nous et pour nous. La communication autour de l’événement se fait par le bouche-à-oreille, l’affichage dans l’espace public et les réseaux sociaux numériques. L’interconnaissance et la cooptation apparaissent centrales, aussi bien dans la production que dans la réception de l’événement :
Pour le projet, il faut qu’il y ait des gens du territoire. Parce que ça lui donne de la légitimité, et c’est aussi grâce à ça qu’on en trouvera d’autres. Et c’est ce qui a commencé à se mettre en place au fur et à mesure des années, c’est que : « Tiens, je vais dire à mon cousin de venir, blabla », puis le cousin, il vient, et puis… […] C’est vraiment que du réseau humain, social […]. Et après, que des connaissances par amis. On n’a pas mis d’annonce. (David Papaïx)
Le résultat est un sentiment exprimé d’appartenance à un groupe, la « famille Pollux ». Un des bénévoles nous l’assure :
Il n’y a pas du lien social que pour le public, mais pour nous aussi. (Bénévole de l’Estafette)
Le public confirme également ce sentiment d’inclusion, témoignant de la mise en phase de leurs attentes avec le dispositif proposé. Ève en témoigne bien, qui déclare :
Ici ça reste familial. Tout le monde se connaît, après, dans le coin. (Ève, public de l’Estafette)
Nos observations et les entretiens du public témoignent d’une ambiance chaleureuse partagée par l’ensemble des participantes et participants, et d’une adhésion globale au dispositif culturel.Beaucoup de gens se reconnaissent, on vient des villages proches, du Tarn (Mirandol-Bourgnounac) comme de l’Aveyron (La Salvetat-Peyralès), parfois de Carmaux, plus rarement d’Albi. Si l’affichage et les réseaux représentent une grande part de la communication, on vient aussi parce qu’on connaît Pollux :
Ève : Ils sont déjà venus en Aveyron, je les ai déjà vus.
Manuel Roux : Avec l’AJAL ? C’est une autre association qui gère le truc.
Ève : Ouais. L’Estafette. Et puis l’Estafette, c’est suivi, quand même. (Sophie, public de l’Estafette)
L’association s’est fait un nom et a gagné en légitimité, vis-à-vis du public comme des institutions. Toutes les tranches d’âge sont représentées sur le site, bien que peu d’enfants et de jeunes en dessous de vingt ans soient présents. Nous rencontrons une population provenant d’horizons sociaux assez variés. Beaucoup travaillent dans l’agriculture et dans le soin à la personne. Nous faisons tout de même la rencontre de quatre personnes âgées d’une petite trentaine d’années, qui se sont installées en collectif sur la commune, originaires de Graulhet, Castres et Carmaux. Elles mènent diverses activités qui vont de la brasserie au développement de jeux vidéo. L’une d’entre elles est même l’ancien batteur de deux groupes de la scène punk hardcore DIY, Hexis et Exylem.
L’aspect total de l’événement culturel est souligné par le public, qui se félicite de la convivialité du moment. L’objet de la soirée, le concert, est néanmoins rappelé. On vient voir jouer Howard et son groupe : la musique est replacée au centre de l’expérience. Avant que les concerts ne commencent, nous observons que le public se scinde dans l’espace : les plus âgés s’assoient en hauteur sur le muret en pierre tandis que les plus jeunes ont tendance à se regrouper dans la fosse du concert, où un espace a été aménagé pour les danses qui vont suivre. Les concerts débutent à 19 heures. Deux groupes se succèdent sur la scène. Comme lors des autres prestations de l’Estafette, il s’agit de groupes locaux et de notoriété modeste. Le premier, L’instant Baloche, est un groupe de reprises de classiques du rock couplés, à l’intérieur même des morceaux, à des références populaires de variétés françaises. Le chanteur fait sensation avec ses tenues bariolées et pailletées. Son épaisse moustache lui confère des airs de Freddie Mercury. La fin du set est particulièrement bien choisie par rapport aux attentes supposées du public : le dernier morceau mêle les premiers accords du titre « Nothing Else Matters » de Metallica avec « Le chasseur » chanté par Michel Delpech, que le public entonne en chœur les bras levés. Le second groupe, Dawn After Dark, joue quant à lui un hard rock assez classique. La soirée prend une forme spécifique. Elle se situe à mi-chemin entre une fête de village traditionnelle et un spectacle de musiques actuelles. La buvette ne désemplit pas, et les tables non plus. Il y a du monde qui s’amuse ce soir à Montirat, comme il y en a eu à Trévien et comme il y en aura quelques semaines plus tard à Saint-Benoît-de-Carmaux. L’Estafette rencontre un succès indéniable et les organisateurs, organisatrices et les élues, élus présents jugent la réussite de la soirée à l’aune des sourires qui ponctuent les salutations. Du porche de l’église séculaire, nous regardons les techniciennes et techniciens s’activer pour tout ranger et rendre le camion à l’AJAL dans la nuit ; ce soir, la concordance des attentes des acteurs et actrices semble manifeste.
Réplicabilité et prospectives
Mais comment expliquer cette réussite ? Peut-elle être reproduite sur le reste du territoire, et confirmer une orientation de politique culturelle ? Il faut en premier lieu mettre en avant les compétences présentes en amont du projet. Les associations qui le portent sont composées de femmes et d’hommes rompus à l’animation socioculturelle, d’abord par leur formation, mais surtout par leurs expériences. Les réflexions engagées sont l’aboutissement d’une confrontation avec le terrain et ses difficultés sur plusieurs années. C’est sans doute par ce prisme du capital expérientiel qu’il faut comprendre la double revendication d’éducation populaire et d’auto-organisation. L’ancrage local est également un atout important. Le réseau tissé par les trois structures depuis leur création a été utile au moment des votes pour le financement, et continue à l’être dans la recherche de bénévoles ainsi que d’artistes à programmer. Il s’est aussi révélé précieux au moment de la construction de l’Estafette, comme nous l’explique David :
Donc, on s’est mis à chercher comment, d’abord, on pourrait fabriquer cet équipement. On a consulté des gens qu’on connaît qui bossent dans le spectacle, des directeurs techniques. Ils ont tous des relations dans le milieu. Ils nous ont vite orientés vers les gars qui fabriquent les scènes.
L’atelier Bakélite a été choisi là encore avec la volonté d’inscrire le projet dans le territoire :
Bakélite, quand on leur a présenté le projet, ils sont venus un peu s’immerger sur le territoire. Et eux, ils ont travaillé pas mal la ferronnerie, le fer, les métaux. Plutôt en lien avec le pont du Viaur, qui est vraiment un des monuments qui relient les deux Ségala. (David Papaïx)
C’est sans aucun doute l’un des ingrédients du succès, et cela représente un travail de long terme. Néanmoins, l’ancrage du dispositif est limité, et les trois structures doivent composer avec des publics qu’elles connaissent moins :
Pierre Génard : Parce que vous, vous êtes de là-bas [Ségala-Carmausin] ? Dans Pollux ou dans l’AJAL, il y a des gens qui sont du secteur ?
David : On vit tous là-bas, mais on n’est pas forcément dans tous les villages. (David Papaïx)
Les propos tenus en entretien par Basile et David révèlent une attention particulière portée à la programmation, ainsi qu’à sa compatibilité avec les publics visés. Il y a par conséquent une forme d’« adressage ». Comme le souligne David :
Sur la programmation, on essaie de proposer des trucs quand même qui soient relativement ouverts, qui soient le moins excluants possible. On va pas programmer un groupe de deathgrind dans un petit village, de punk complètement déluré ou de techno hardcore. Ça aurait aucun sens, parce que ça serait plus clivant qu’autre chose.
Cette attention portée aux attentes supposées du public est un autre exemple de la volonté d’implication des partenaires ainsi que du désir exprimé de faire événement ensemble, grâce à leur connaissance fine de leur territoire et de sa population : la programmation d’Howard, musicien anglais « local » de Montirat, en témoigne. Jean-François Kowalik, maire de Blaye-les-Mines et vice-président du conseil communautaire de Carmausin-Ségala, nous confirme en entretien cet attendu implicite :
Au départ, c’était un peu complexe, parce qu’ils étaient réputés [pour] l’Xtreme Fest, c’est-à-dire du rock très, très dur, avec une clientèle particulière pour des zones rurales et des maires ruraux. Mais ils ont très vite rassuré en disant que leur programmation n’aurait rien à voir. C’est des groupes gentils qui viennent, entre guillemets.
Cette nécessité d’adressage peut parfois être vécue comme un cadre pour les associations porteuses, les obligeant elles-mêmes à s’adapter aux attentes suscitées par l’Estafette :
Après, c’est sûr que t’as moins de liberté de programmation. T’as des élus, des fois, dans des réunions, ils te disent « ouais bah vous faites ce que vous voulez […] vous avez une liberté de programmation, vous faites ce que vous voulez, il y a aucun souci, mais par contre… ». C’est différent, il faut que tu sois plus consensuel. (Basile Delbruel)
En cohérence avec le cadre de l’éducation populaire et de l’auto-organisation, les membres des trois associations s’interrogent sur les retombées de l’initiative :
Tu vois ça peut susciter une vocation de quelqu’un qui se dit : « Ah mais en fait, j’ai trop envie de travailler le fer, pour faire des trucs aussi beaux. » Je crois vraiment qu’un événement comme celui-là, ça peut laisser des traces dans le temps, consciemment ou inconsciemment, chez les gens. Et ça, c’est cool. (Aude Esquilat)
Symétriquement, l’une des réussites de l’Estafette se situe dans le fait d’avoir impulsé la relance de comités des fêtes dans les villages visités. L’influence exercée par le projet sur le tissu politique et social constitue un indice remarquable du succès de l’expérience. Car en sollicitant l’appui d’associations locales ou de bénévoles non encore structurés, l’Estafette se pose en cadre structurant. Elle permet la rencontre des volontés et balise des projets futurs, puisque ces liens perdurent. Dans l’une des communes, il a ainsi été décidé de relancer la fête du village, qui n’avait plus lieu faute de comité des fêtes. Ces dynamiques positives, outre leur force recréatrice de lien, de sociabilités dans l’action, renforcent en creux l’idée qu’une seule structure ne peut assumer l’ensemble du travail culturel d’un territoire, et qu’elle doit pouvoir essaimer pour se maintenir. David rapporte par exemple qu’en raison du succès de l’Estafette auprès des maires, qui souhaiteraient la voir revenir, Pollux a calculé qu’il faudrait presque dix ans pour faire le tour des villages du Ségala et repasser dans une commune. La dimension patrimoniale de l’Estafette est également prégnante : il s’agit de valoriser les lieux présents dans leurs représentations et leurs utilisations, comme le souligne David quand il parle du choix de l’emplacement de l’événement. L’idée est d’inscrire le projet, le spectacle, le dispositif dans ce qui existe, afin d’ouvrir une nouvelle dynamique, de faire avec les habitudes locales et les modes d’appropriation des lieux. Plus qu’un nouveau dispositif adapté au contexte local, l’Estafette est une démarche visant à optimiser les espaces existants pour que s’y développent d’autres usages :
La scénographie de l’Estafette fait que même une place de village qui est plutôt banale, qui a pas de caractère en particulier, ça l’habille, et la scénographie l’amène à mener une convivialité. La personne qui voudrait prendre quinze jours en vacances quelque part, si [elle] suit le festival, [elle] découvre des lieux incroyables et connus, avec, en plus, des propositions. (Basile Delbruel)
L’influence exercée par le projet sur le tissu politique et social constitue un indice remarquable du succès de l’expérience. […] Ces dynamiques positives, outre leur force recréatrice de lien, de sociabilités dans l’action, renforcent en creux l’idée qu’une seule structure ne peut assumer l’ensemble du travail culturel d’un territoire, et qu’elle doit pouvoir essaimer pour se maintenir.
Enfin, l’éventuelle reproductibilité de l’Estafette à plus grande échelle se heurte selon nous à plusieurs verrous et obstacles qu’il est nécessaire d’analyser. Le renouvellement des mandats municipaux représente un premier facteur d’instabilité. Un élu favorable au projet peut être remplacé par un autre, moins sensible à la question de l’itinérance culturelle. L’acceptation de l’Estafette est forcément arrimée à un contexte politique propre au lieu de vie, et donc conditionnée par la vision des élus locaux, certains considérant que l’offre culturelle existante suffit :
La communauté de communes ils étaient sur un financement à hauteur de 30 000 euros. Et du coup il y a eu cette crispation, en 2022, qui a fait qu’ils ont baissé à 10 000. Et du coup, voilà, on est devenus l’objet d’une crispation interne […] qui fait que ça s’étripe un peu dans le conseil communautaire, quand notre sujet arrive. (Basile Delbruel)
La coopération avec les communes se heurte aussi à des tensions liées à l’organisation logistique, comme la gestion des buvettes, qui sont parfois une source de revenus pour les associations locales. L’exploitation de cette manne par l’Estafette peut créer des frictions. De plus, à l’instar de nombreuses initiatives culturelles indépendantes, l’Estafette repose sur un équilibre fragile entre autofinancement et subventions publiques, ce qui rend son expansion et sa pérennisation incertaines. Les arbitrages budgétaires des collectivités peuvent ainsi réduire les financements, compromettant la viabilité du projet. Enfin, la faible structuration des partenariats privés limite les alternatives de financement.
En définitive, le modèle de l’Estafette peut rencontrer des difficultés à s’imposer dans les cadres institutionnels existants. Si cette situation est généralement le propre de tout projet innovant, elle débouche souvent sur une difficulté d’accès à des ressources à plus large échelle, pour un modèle qui repose principalement sur le soutien des réseaux associatifs et des élus engagés localement. Les financements publics restent majoritairement orientés vers des lieux fixes (salles de spectacle, médiathèques, salles des fêtes, etc.), tandis que l’itinérance culturelle reste encore une catégorie floue pour les politiques culturelles. Cette approche, axée sur la sédentarité des infrastructures, peut limiter la reconnaissance institutionnelle de projets mobiles comme l’Estafette, y compris à l’échelle des mairies. De même, les dispositifs de financement qui bénéficient à la ruralité, même s’ils sont de plus en plus nombreux, s’adaptent encore lentement aux spécificités de la diffusion culturelle dans des territoires faiblement équipés. Dès lors, l’Estafette est-elle véritablement un ovni culturel, ou le Ségala Music Tour, présenté comme « une série de concerts », s’inscrit-il simplement dans un continuum d’activités culturelles en milieu rural déjà marqué par une grande hétérogénéité ? En effet, il n’existe pas de définition unique du festival, mais plutôt une multitude de modèles qui varient selon leur ancrage territorial, leur temporalité, leur économie et leur rapport au public[22]. L’Estafette, par son déploiement sur divers événements tout au long de l’année, sa mobilité entre plusieurs communes et deux départements, ainsi que son économie hybride, semble s’inscrire dans le cadre des festivals, tout en remettant en question plusieurs de leurs caractéristiques fondamentales. Les conséquences en matière sociale et écologique de ces événements se distinguent également[23] : plutôt que de créer une forte concentration de publics (locaux mais surtout se déplaçant parfois de loin pour l’occasion), l’Estafette favorise des rencontres localisées et temporaires dans chaque commune desservie, encourageant ainsi le circuit court et le lien social de proximité. Mais contrairement aux festivals ancrés dans un lieu et un temps donnés, le projet fonctionne de manière diffuse et récurrente, traversant plusieurs territoires sans point central de rassemblement. Si certaines catégories, comme les « petits formats » ou les « pôles publics » d’après la classification d’Emmanuel Négrier et Aurélien Djakouane[24], intègrent des formes décentralisées, les festivals restent généralement pensés comme des événements ponctuels, là où l’Estafette s’apparente davantage à un dispositif permanent de diffusion culturelle. Ensuite, le modèle économique de l’Estafette repose sur des structures associatives en équilibre instable, entre financements publics et participation du public, la plaçant de ce point de vue à distance des festivals majoritairement financés par la billetterie ou le mécénat :
On a renversé la vapeur sur un modèle autour de la proximité et de l’itinérance, avec plus [au sens de davantage] de financement public – enfin, un même financement public, mais un autofinancement moindre. On est toujours en difficulté et donc, là, on arrive à une situation où on doit amener un choix politique, des partenaires, en leur disant : « Souhaitez-vous un opérateur structure en itinérance en ruralité, ou pas ? » (Basile Delbruel)
Les financements publics restent majoritairement orientés vers des lieux fixes (salles de spectacle, médiathèques, salles des fêtes, etc.), tandis que l’itinérance culturelle reste encore une catégorie floue pour les politiques culturelles.
Outil hybride, l’Estafette est ainsi utilisée comme facilitateur d’événements existants. Par ailleurs, sa polyvalence façonne en retour une action culturelle polymorphe qui échappe aux définitions établies.
Conclusion
En quoi peut-on considérer l’Estafette comme une réussite ? Pour comprendre, il faut chercher au-delà de la culture de convivialité et d’amusement affichée, partagée et exprimée dans un néologisme que les bénévoles de Pollux utilisent désormais régulièrement : le « Zguen[25] ». Pour David Papaïx, l’intérêt de Pollux, et par extension de l’Estafette, est de proposer des spectacles « carrés » et « pros ». Il n’oublie pas de rappeler l’ancrage alternatif de l’association, tout en prenant soin d’évacuer tout élément subversif que cette image pourrait contenir : « C’est pas parce qu’on est des punks qu’on est des schlagos. » Dans la représentation que construit David de l’association, le noyau punk constituerait le ciment de l’équipe. Il en subsisterait in fine l’esprit de débrouille :
Les équipements manquent, il n’y a pas de lieux, même sur Albi. C’est la raison d’être de Pollux que de proposer de créer le lieu du spectacle […]. On a fait nos premiers concerts en les créant de A à Z avec trois planches.
En définitive, l’Estafette construit son territoire autant qu’elle l’anime. En mettant en avant le Ségala dans l’appellation même de la tournée, elle le redéfinit au-delà des frontières administratives[26]. En construisant un réseau d’interdépendance, elle fait territoire.
David assume cependant la volonté de ne pas faire grossir l’événement et de rester à l’échelle locale, ce qu’il justifie par « la peur de se disperser », et le souhait de « faire de la qualité ». De manière globale, ses propos reflètent une stratégie de respectabilité et une quête de reconnaissance de la part de l’ensemble de ses partenaires – efforts placés autant vers le plus haut degré de la chaîne institutionnelle qu’au niveau le plus local des habitants des villages. Cette stratégie se reflète également dans la programmation : les groupes sont choisis avec un soin particulier pour composer entre différentes contraintes, la première étant celle de l’adressage et de la découvrabilité, puisque l’Estafette souhaite mettre en avant des groupes locaux. Ses initiateurs et initiatrices cherchent ainsi à s’assurer de l’adhésion des habitants, tout en participant au développement d’artistes locales et locaux. Rappelons que le succès de la soirée se mesure en premier lieu par la présence massive des personnes originaires du territoire. Cette stratégie comporte aussi la nécessité de se distinguer, d’un point de vue culturel, de la fête de village classique, sans pour autant que cette distinction se fasse par la programmation d’esthétiques clivantes : « Je ne veux pas que ce soit de la baloche, ni le bordel[27]. » Rien n’est laissé au hasard, et la complexité de cette stratégie a certainement été nourrie par l’alliance des diverses compétences des porteurs et porteuses du projet.
La difficulté à catégoriser l’Estafette dans les formes classiques d’événement culturel, combinée à une approche territoriale non conventionnelle, complique son intégration dans les critères d’attribution des budgets culturels. L’Estafette répond pourtant à plusieurs objectifs du Plan culture et ruralité lancé en 2024, qui vise à renforcer la présence culturelle en milieu rural. Ce plan, doté de 98 millions d’euros sur trois ans, met l’accent sur la valorisation des initiatives locales et le soutien aux acteurs culturels de proximité[28]. L’Estafette incarne ces ambitions en proposant, à sa manière, une décentralisation culturelle active tout en facilitant l’accès à une autre offre dans des zones souvent éloignées des dispositifs classiques.
Le projet, qui fait de la mobilité souple et de la capacité à aller vers les publics un principe cardinal, s’inscrit dans une dynamique plus large et en plein essor de renouvellement de la ruralité par la culture[29], notamment avec des initiatives qui privilégient l’itinérance pour revitaliser les territoires[30]. Le Slowfest, par exemple, plus axé sur le volet écologique, est lui-même inscrit dans le réseau européen et récent Armodo tourné vers les pratiques culturelles en mobilité douce. Des projets similaires existent également dans le monde du théâtre et des arts de rue, à l’image du Centre international pour les théâtres itinérants (CITI), qui est rattaché au plus grand réseau national de l’Union fédérale d’intervention des structures culturelles (Ufisc). Le cinéma n’est pas en reste, puisque l’Association nationale des cinémas itinérants (ANCI) ou le dispositif Cinémobile, dans le Centre-Val de Loire, contribuent eux aussi à ce renouveau de la diffusion culturelle. L’Estafette participe donc d’un développement plus large de la culture en itinérance, auquel il faudrait aussi ajouter d’autres initiatives émanant des mondes des musées, des bibliothèques, des arts et du spectacle vivant en général : une nouvelle étape de décentralisation de l’offre culturelle semble ainsi progressivement se dessiner.
[1] L’Association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) est fondée en 1966 puis relancée au début des années 2000, Pollux est créée en 2000 et l’X Fest Organisation en 2016.
[2] BLOCH M., Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Paris, Les Belles Lettres, 1931.
[3] Voir par exemple NÉGRIER E. et TEILLET P., Les projets culturels de territoire, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble (PUG), 2019.
[4] DELFOSSE C., « La culture à la campagne », Pour, no 208, 2011, p. 46, en ligne : https://doi.org/10.3917/pour.208.0043.
[5] Ibid., p. 47.
[6] DELFOSSE C., « De nouveaux liens villes-campagne, en termes de culture : la fin d’un antagonisme ? », Pour, no 249-250, 2024, p. 143-160.
[7] GUILLON V. et SCHERER P., « Culture et développement des territoires ruraux. Quatre projets en comparaison », rapport pour Inter-Parcs du Massif central (Ipamac), 2012, p. 6, en ligne : https://aaar.fr/wp-content/uploads/2017/08/etude-culture-scherer-guillon.pdf.
[8] Ibid.
[9] DELFOSSE C. et al., « Culture et patrimoine en milieu rural », Pour, n° 226, août 2015 ; voir aussi SAINT-DO V. de, « Synthèse des rencontres du festival La Grande Défriche à Lalbenque (Lot) les 13 et 14 octobre 2022 : “Culture et dynamiques citoyennes en milieu rural” », fév. 2023, en ligne : https://cultureruralite.fr/wp-content/uploads/2023/02/Synthese_Rencontres_Lalbenque-2.pdf.
[10] DELFOSSE C., « Les ruralités, un ailleurs de l’innovation culturelle ? », Observatoire des politiques culturelles (OPC), 27 fév. 2025, en ligne : https://www.observatoire-culture.net/ruralites-ailleurs-innovation-culturelle.
[11] CAMUS D., « Une topologie socio-spatiale des initiatives artistiques en milieu rural », thèse en architecture et paysage, Bordeaux, université Bordeaux-Montaigne, 2022, en ligne : https://theses.hal.science/tel-03890432 ; NÉGRIER E. et TEILLET P., « La montée en puissance des territoires : facteur de recomposition ou de décomposition des politiques culturelles ? », dans J.-P. Saez (dir.), Culture & société. Un lien à recomposer, Toulouse, L’Attribut, 2008, p. 91-108.
[12] BROUGÈRE G. et FRANÇOIS S., « Introduction », dansG. Brougère et F. Sébastien (dir.), L’enfance en conception(s). Comment les industries culturelles s’adressent-elles aux enfants ?, Bruxelles, Peter Lang, 2018, p. 11.
[13] Pour répondre à ces questions, nous avons mené une enquête fondée sur trois volets méthodologiques. Nous avons d’abord conduit deux séances d’observation lors d’événements Estafette, en tant que spectateurs et spectatrices identifiés comme chercheurs et chercheuses auprès de l’organisation et du public. La majorité des données ont été recueillies lors d’un premier concert à Montirat, le 31 août 2024, consignées dans un journal ethnographique enrichi d’entretiens informels avec le public et les membres de l’organisation Pollux, ainsi que de quelques photographies. Une deuxième séance d’observation a eu lieu à Saint-Benoît-de-Carmaux, le 7 septembre 2024. Par ailleurs, sept entretiens ont été menés avec les initiateurs de l’Estafette, les présidents des associations Pollux et AJAL, la coordinatrice de Pollux, des élus ayant accueilli l’Estafette, le président de l’intercommunalité Carmausin-Ségala, ainsi qu’un musicien et habitant de Montirat. Les entretiens avec le public ont été anonymisés. Enfin, un travail d’archives (projets associatifs, dossiers de subventions) et une revue de presse ont complété l’enquête.
[14] Voir le projet de l’Estafette vu par l’AJAL sur son site Internet : assoajal.fr/estafette.
[15] Voir l’annuaire « Structures culturelles et lieux de diffusion en Carmausin-Ségala » sur le site de la communauté de communes : https://www.carmausin-segala.fr/associations-culturelles-artistes-compagnies.
[16] Entretien avec l’un des bénévoles de l’organisation.
[17] MÜLLER J. et SCHREIBER A., « Les sorties culturelles des Français après deux années de Covid-19 », Culture Études, no 6, 2022, p. 1-20, en ligne : https://doi.org/10.3917/cule.226.0001.
[18] Voir le site de l’atelier : https://bklt.fr/agence.
[19] Voir le projet de l’Estafette vu par l’AJAL et Pollux sur leurs sites Internet : assoajal.fr/estafette ; polluxasso.com/evenements_full/lestafette.
[20] PERRENOUD M., « Artisanat et gentrification rurale en France méridionale », SociologieS, 2012, en ligne : https://doi.org/10.4000/sociologies.3991 ; PERRENOUD M., « Les artisans de la “gentrification rurale” : trois manières d’être maçon dans les Hautes-Corbières », Sociétés contemporaines, n° 71, 2008, p. 95‑115, en ligne : https://doi.org/10.3917/soco.071.0095.
[21] RIEUTORT L., « Les territoires ruraux face à quatre transitions », Population & Avenir, n° 761, 2023, p. 4‑7.
[22] DJAKOUANE A. et NÉGRIER E., Festivals, territoire et société, Paris, ministère de la Culture-Presses de Sciences Po, 2021.
[23] NÉGRIER E., Les festivals à l’épreuve de la transition, Fontaine, PUG, 2024.
[24] DJAKOUANE A. et NÉGRIER E., « Vers une typologie des festivals », dans Festivals, territoire et société, op. cit., p. 209-235.
[25] D’après l’association, « zguen » est un « terme fréquemment utilisé dès le milieu des années 90 par une frange de la population albigeoise afin de désigner un peu tout et n’importe quoi ». Voir Pollux Asso, « Rapport d’activité 2021 », 21 mai 2022, en ligne : https://www.calameo.com/books/006029325fd774711c798.
[26] DORÉ G., « Quelles géographies pour les aides publiques de l’État aux territoires ? », Population & Avenir, n° 756, 2022, p. 17‑19, en ligne : https://doi.org/10.3917/popav.756.0017.
[27] Entretien avec David Papaïx.
[28] Voir le dossier « Plan culture et ruralité : une ambition pour la vie culturelle dans les territoires ruraux » sur le site du ministère de la Culture : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/culture-et-territoires/culture-et-ruralites/le-plan-culture-et-ruralite-renforcer-la-place-de-la-culture-au-caeur-des-territoires-ruraux.
[29] DELFOSSE C., « Les ruralités, un ailleurs de l’innovation culturelle ? », op. cit.
[30] Pour un état des lieux des initiatives culturelles en itinérance, voir « Les itinérances artistiques, un modèle en plein renouvellement », ministère de la Culture, 25 mars 2024, en ligne : https://www.culture.gouv.fr/fr/actualites/les-itinerances-artistiques-un-modele-en-plein-renouvellement.