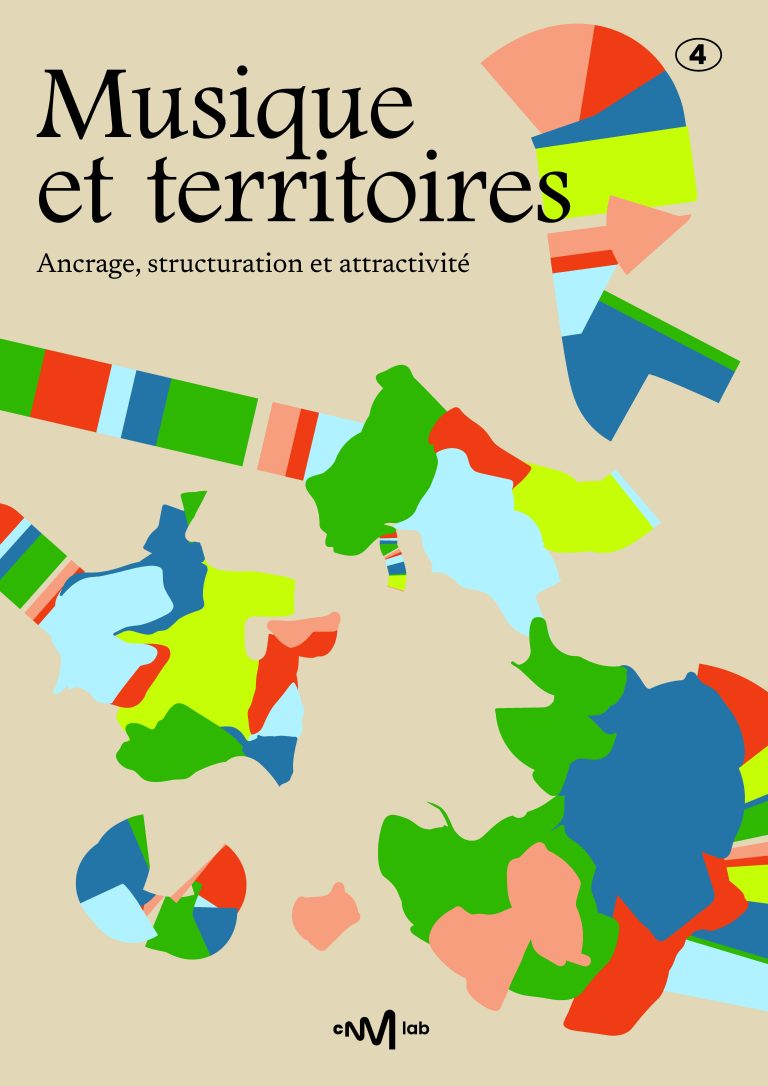Les crédits d’impôt musicaux : un outil au service des territoires
Introduction
Le lien entre fiscalité, culture et territoire est méconnu et peu traité dans la littérature sur la politique culturelle[1]. Pourtant, l’un des succès les plus emblématiques de développement culturel local, celui de l’industrie hollywoodienne, repose justement sur ce lien. En effet, la consolidation et la réussite de cette industrie sont en grande partie dues à la fiscalité avantageuse de la Californie, même si elle ne concernait pas, à l’époque de son émergence, spécifiquement le secteur audiovisuel[2]. Dans de nombreux pays, les arts et la culture bénéficient d’une fiscalité adaptée, dans le but d’encourager leur financement, de stimuler la création ou encore de préserver le patrimoine[3]. Bien souvent, ces mesures fiscales s’inscrivent dans une politique plus large de soutien à la culture, par exemple via des taxes dédiées alimentant des programmes de subvention ou d’accompagnement, des incitations fiscales pour les tiers, de type mécénat, et des exemptions ou réductions de taxes sur certaines activités.
Les crédits d’impôt se distinguent des autres mécanismes car ils sont devenus des outils courants pour soutenir la culture sur un territoire donné, notamment dans le domaine audiovisuel et, de plus en plus, musical. Ils consistent en un remboursement d’un pourcentage des dépenses de production, sous la forme d’un crédit qui peut être utilisé pour réduire les obligations fiscales de la production ou d’un crédit en espèces. Ces mécanismes visent à stimuler l’activité dans un secteur donné ; on les retrouve donc dans de nombreux domaines culturels, ainsi que, en dehors du champ du ministère de la Culture, dans la recherche, l’innovation, le tourisme, ou encore l’environnement.
Ils occupent aujourd’hui une place de plus en plus importante, étant perçus comme plus efficaces que les aides directes de type subvention ou, a minima, comme complémentaires à celles-ci. En effet, les crédits d’impôt se distinguent de ces dernières ou du mécénat car ils apparaissent davantage horizontaux, prévisibles, et s’étendent généralement au-delà du secteur non marchand, ce qui décuple leur impact sur les territoires. Cet article vise non seulement à aborder comment les crédits d’impôt sont pensés de manière différente selon les territoires et les secteurs, mais aussi à explorer les opportunités de développement de mécanismes fiscaux dans le secteur musical français.
Caractéristiques des crédits d’impôt dans la musique
La plupart des programmes, en France comme à l’étranger, reposent sur un modèle de remboursement d’un pourcentage des frais de production musicale engagés. En théorie, les crédits d’impôt ont pour vocation principale d’inciter la réalisation de projets qui n’auraient pas eu lieu sans ce soutien. C’est le principe de l’additionnalité : le crédit d’impôt doit générer une activité supplémentaire, soit en quantité (plus de projets), soit en qualité (des projets plus ambitieux), soit en localisation (des projets réalisés dans un territoire donné grâce à l’incitation). Mais dans la pratique, les crédits d’impôt soutiennent aussi des projets qui auraient peut-être eu lieu de toute manière, surtout dans les secteurs très dynamiques ou internationalisés (comme l’audiovisuel, le jeu vidéo ou la musique), où les producteurs et productrices savent optimiser les dispositifs fiscaux. C’est ce que l’on nomme l’effet d’aubaine[4].
Comme nous le verrons, l’un des facteurs qui différencient le plus les crédits d’impôt concerne le focus sur les productions locales, étrangères, ou un mélange des deux. Les autres facteurs à retenir sont :
- le type de production musicale : spectacle vivant et/ou œuvres enregistrées[5] ;
- les types de dépenses éligibles : développement, composition, production, postproduction (mixage, mastering), captation[6] ;
- le pourcentage des dépenses concernées (entre 15 et 30 %, voire 40 % pour des cas spécifiques) ;
- dans certains cas, des restrictions concernant le type de contenu produit[7].
Ces mécanismes fiscaux reflètent une évolution de la philosophie de l’aide publique à la culture, notamment en France, où le principe sélectif basé sur l’excellence a longtemps primé[8]. Nombre de subventions sont historiquement accordées de manière sélective par des commissions représentant la profession[9]. Elles visent à privilégier les projets artistiques innovants au-delà de leurs potentiels de rentabilité, bien qu’elles soient aussi envisagées comme des vecteurs de professionnalisation du secteur.
Or, cette forme de soutien a fait l’objet de certaines controverses, malgré la perception largement répandue de son importance. Le caractère sélectif des financements directs privilégie une « qualité » artistique socialement construite par les groupes professionnels des milieux culturels français, dont la légitimité est régulièrement remise en cause. En outre, ces aides sont elles-mêmes financées par les contributions d’autres maillons de la chaîne de valeur (taxe sur les services de streaming, taxe sur la vente de billets de spectacles, etc.), attisant les attaques. Les crédits d’impôt, par leur fonctionnement, recentrent en apparence le financement sur les porteurs et porteuses de projet, puisqu’il s’agit d’encourager des investissements qui n’auraient pas eu lieu autrement et d’en alléger l’imposition. Ils se présentent comme un manque à gagner fiscal, compensé par davantage d’investissement privé, plutôt que comme une « charge » pour les finances publiques. En même temps, ils sont perçus comme plus horizontaux, car accordés sur des principes économiques plutôt qu’esthétiques. En ce sens, ils auraient le double avantage d’éviter l’élitisme culturel et de générer de l’investissement dans un territoire donné, et sont encouragés à ce titre.
Entre soutien local et compétition territoriale
Aux États-Unis et au Canada, les premières discussions sur les crédits d’impôt musicaux remontent à la fin des années 2000 et concernent davantage le spectacle vivant que la production phonographique, au niveau local plutôt que national. Chicago et Toronto se livrent, de longue date, une compétition pour obtenir l’exclusivité de certaines productions de spectacle10. Au début des années 2010, l’Illinois a introduit un crédit d’impôt, offrant jusqu’à 2 millions de dollars de rabais, afin d’attirer les spectacles de Broadway et de contrecarrer la concurrence de Toronto. Les principaux producteurs de spectacles de Toronto ont alors collaboré avec les syndicats, l’industrie touristique et les associations professionnelles pour faire pression en faveur de crédits d’impôt similaires au niveau provincial et fédéral. Ce cas montre à quel point les crédits d’impôt musicaux peuvent constituer une arme dans la bataille que se livrent les territoires pour rester compétitifs sur le plan culturel, et met en évidence le potentiel économique de la musique au niveau local11. Les systèmes fédéraux, comme les États-Unis et le Canada, sont particulièrement enclins à développer des incitations fiscales en raison de leurs structures de gouvernance décentralisées, favorisant la concurrence et, supposément, l’innovation12.
Le domaine audiovisuel a depuis longtemps ouvert la voie à cette bataille via les crédits d’impôt. À partir des années 1970, en Allemagne, en Irlande, puis dans certaines provinces canadiennes et certains États américains, des programmes ont été mis en place pour attirer des productions cinématographiques extérieures au territoire concerné, en utilisant la fiscalité comme ressort principal[13]. À la fin des années 1980, nombre d’États américains, comme la Caroline du Nord et le Texas, ont créé des film commissions chargées d’attirer des cinéastes grâce à des aides en nature (repérage de lieux, services de relations publiques, utilisation gratuite d’installations publiques) et des exonérations fiscales[14]. En 1992, la Louisiane est devenue le premier État à proposer des crédits d’impôt remboursables pour des dépenses de production. Ce modèle s’est ensuite généralisé, au détriment des crédits d’impôt destinés à des investisseurs tiers ou transférables, plus proches du mécénat. Si, en 2000, seuls six États disposaient d’incitations fiscales pour la production de films et de vidéos, en 2010, tous sauf six en disposaient[15]. Les grandes sociétés de production cinématographique telles que Warner Bros, Universal, Paramount et Disney se sont progressivement équipées de départements exclusivement chargés d’évaluer où la production aura lieu, en prenant en compte les incitations fiscales disponibles. Cela a engendré une véritable compétition au sein même du territoire américain, qui s’est ensuite propagée au reste du monde.
Sur la base des résultats déjà obtenus dans le milieu audiovisuel, notamment en matière d’attraction des productions étrangères, le Royaume-Uni s’est doté d’un mécanisme de déduction d’impôt pour les spectacles depuis 2014[16]. Ainsi, contrairement à la France, nombre de crédits d’impôt en faveur de la musique agissent sans discrimination et sans considération des contenus, y compris de la langue. C’est le cas au Québec qui, normalement, est très protectionniste sur le plan linguistique, mais qui, dans le cas du crédit d’impôt pour le spectacle vivant, ne requiert que la participation d’une entreprise locale.
Le cas de l’Islande
Comme dans le cinéma, la production musicale contemporaine est très mobile : les films comme les chansons et albums peuvent aujourd’hui être réalisés et postproduits n’importe où, et il est possible de trouver des studios de grande qualité dans de nombreux pays. Pour cette raison, toutes les productions musicales sont des « productions fugitives » potentielles, ce qui en fait des cibles intéressantes pour des crédits d’impôt visant à stimuler l’activité économique d’un territoire. Bien que les productions musicales n’engagent pas d’aussi grandes sommes que dans le cinéma, en volume, leur impact est tout à fait significatif, sans parler de leurs effets sur l’image des territoires, justifiant une approche fiscale qui permet d’amplifier ces retombées[17].
Depuis 2019, le programme Record in Iceland propose un remboursement direct de 25 % des frais engagés pour l’enregistrement de musique sur l’île[18]. Record in Iceland est probablement le programme le plus directement lié à des objectifs d’attractivité territoriale. Il renvoie au reste de l’économie islandaise, qui repose largement sur l’importation de biens. Il ambitionne d’attirer principalement des projets internationaux de production phonographique : d’une simple chanson à un album entier. De plus, il a été décidé de ne pas imposer de procédure d’approbation préalable ou de budget minimum pour l’initiative d’enregistrement, afin de rendre le processus plus fluide et plus attrayant pour les producteurs internationaux[19]. Par ailleurs, le programme islandais se différencie de la plupart des crédits d’impôt, puisque le remboursement est effectué directement par le gouvernement, sans même passer par l’entité fiscale. Il suffit de déclarer des dépenses pour être directement remboursé, sans autre difficulté administrative que la présentation des notes de frais.
Le programme repose en grande partie sur la renommée internationale des studios, de l’arrangement, de la production et de l’ingénierie du son en Islande. Il s’appuie également sur l’idée que l’expérience des artistes venant de l’étranger serait sublimée par la beauté des paysages islandais. De fait, le programme est promu sur la base de l’argument suivant : « La musique est toujours le produit de son environnement[20]. » Le manager du programme cite notamment le succès d’artistes reconnus pour leur identité islandaise unique, comme Björk, Sigur Rós et Of Monsters and Men, mentionnant leur lien avec l’environnement naturel et social de l’île. En ce sens, le programme vise à promouvoir l’image de l’île tout en générant des bénéfices économiques, plutôt que de soutenir la production locale. Toutefois, indirectement, ces productions étrangères soutiennent le développement local des métiers de l’enregistrement, l’arrangement et l’ingénierie du son, dont l’expérience peut ensuite bénéficier à la création locale. Par ailleurs, d’autres programmes existent pour soutenir la création et la production locales[21].
Record in Iceland s’inscrit dans la lignée du programme Film in Iceland, également fondé sur la spécificité des paysages de l’île. Ce dernier a réussi à attirer des productions comme Interstellar, Game of Thrones ou The Northman. En plus d’impulser une nouvelle économie, Film in Iceland est censé avoir apporté à l’Islande les savoir-faire et les infrastructures nécessaires pour accueillir des productions internationales de haut niveau, ce dont elle ne disposait pas avant. Un effet secondaire est que l’Islande est devenue une destination davantage attrayante pour les voyageurs et voyageuses : s’ils ont vu des images de l’Islande dans un film ou une série, ils ont envie de visiter le pays[22]. Le principal objectif de l’initiative de production musicale est d’atteindre les mêmes résultats, bien que les vidéos musicales ne soient pas incluses dans le programme.
Certains artistes profitent d’aller jouer en Islande, par exemple au festival Iceland Airwaves, pour prolonger leur séjour et faire un enregistrement, avant de demander le remboursement Record in Iceland[23]. Le fait que les frais de voyage et d’hébergement puissent être inclus dans le budget renforce l’attrait de ce programme. En ce sens, il s’agit d’un programme particulièrement agile sur le plan administratif, attractif pour les productions étrangères et clairement lié à la spécificité du territoire, notamment dans sa dimension naturelle. S’il bénéficie aux studios locaux et génère un certain impact économique indirect, il s’inscrit davantage dans la capitalisation de l’image et des paysages préexistant au programme que dans le soutien à de nouvelles propositions culturelles. Une véritable politique musicale territoriale appelle, dès lors, d’autres programmes de soutien à la production locale, comme nous le verrons dans la dernière partie.
Le cas de la France
À partir des données disponibles, il semble que la France soit pionnière dans la mise en place de crédits d’impôt en faveur du secteur musical, alors même qu’elle s’y est intéressée tardivement dans le secteur audiovisuel. L’instauration du premier dispositif de ce type en France date de 2006, deux ans après celui destiné au cinéma. Il s’agit du crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP), dont l’objectif était de soutenir les labels installés en France[24]. En effet, face à l’étendue de la crise du disque de l’époque, les mesures sélectives de type subvention, qui étaient l’apanage de la politique culturelle française jusqu’alors, ne semblaient plus suffire. Le crédit d’impôt avait, quant à lui, l’avantage de moins discriminer et de soutenir le secteur dans toute sa diversité, depuis les multinationales jusqu’aux associations, en passant par les labels indépendants. En plus de soutenir divers modèles économiques, le programme visait à inclure toutes les esthétiques musicales et, ainsi, à niveler les domaines qui dépendent généralement de financements directs, comme la musique classique, contemporaine, l’opéra, ou encore le jazz.
Dans la lignée des crédits d’impôt pour le cinéma, le CIPP couvre une partie cruciale de la chaîne de valeur, c’est-à-dire les dépenses de développement, de production et/ou de postproduction, d’un disque et/ou d’une vidéomusique[25]. Son taux de remboursement est de 20 % des dépenses concernées, mais il passe à 40 % pour les très petites et petites et moyennes entreprises (TPE et PME) de production – des taux alignés sur les standards les plus élevés du soutien à l’industrie audiovisuelle dans le monde (Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Espagne, Japon, Inde, Arabie saoudite, etc.)[26]. Les dépenses de développement éligibles au CIPP sont plafonnées à 700 000 euros par enregistrement et ne peuvent excéder 1,5 million d’euros par entreprise. Toutefois, ce dispositif ne concerne que les entreprises de production françaises[27].
Le modèle du crédit d’impôt a été étendu à la production de spectacle vivant (CISV) en 2016, puis à l’édition depuis 2022[28]. Le cas du spectacle vivant est intéressant car il fait également écho à un moment de crise du secteur, tout en répondant à des enjeux plus profonds liés au financement des spectacles. En effet, le CISV a été créé après l’attaque terroriste au Bataclan en 2015. Cet événement a profondément affecté le secteur, sur le plan non seulement émotionnel, mais aussi économique, du fait de la baisse de fréquentation du public et de la hausse des coûts de sécurité.
Comme le CIPP, le CISV couvre les dépenses de développement et de production des spectacles vivants musicaux (salaires, honoraires, droits d’auteur, taxes et organismes de gestion collective, location de lieux, location de matériel, hébergement, restauration, transport, entretien du matériel, promotion), ainsi que leur captation ou numérisation. Ses taux sont toutefois plus faibles : 15 % du montant total des dépenses engagées (30 % pour les TPE et PME). Le montant des dépenses éligibles est limité à 500 000 euros par spectacle. Le crédit d’impôt accordé est limité à 750 000 euros par entreprise, et des limites de jauge sont imposées par genre musical.
Contrairement à d’autres crédits à travers le monde centrés principalement sur le soutien aux entreprises de production étrangères, le CIPP et le CISV soutiennent non seulement les entreprises basées en France[29], mais aussi l’émergence artistique et la francophonie. Cela s’explique par leur lien avec le ministère de la Culture, pour qui ce type de mécanisme fiscal doit répondre à une mission d’intérêt général, ici conçue à partir d’un idéal de diversité culturelle incarné par le renouvellement culturel (émergence) et la promotion de la langue (face à l’hégémonie de l’anglais notamment). Le ministère de la Culture reconnaît par exemple que l’activité de production de nouveaux talents est structurellement déficitaire, justifiant l’intervention publique pour la conserver[30].
Ces critères font des crédits d’impôt des outils au service des éléments proprement culturels du territoire : ses langues[31] et sa capacité d’innovation. Le CIPP s’adresse certes à des entreprises de toute taille, mais concerne seulement des artistes qui n’ont pas dépassé le seuil de 100 000 équivalents-ventes pour deux albums distincts depuis le début de leur carrière. Par ailleurs, le critère de langue n’est pas exclusif et compense ainsi le biais en défaveur des styles musicaux interprétés dans des langues non locales, même lorsque les interprètes sont de nationalité française ou installés en France[32].
De manière plus générale, la dimension culturelle des crédits d’impôt est facilitée par le fait que le ministère de la Culture participe à leur attribution via ses différentes entités (Centre national de la musique [CNM] dans le cas de la musique), en délivrant des agréments permettant d’attester que les projets remplissent les conditions d’éligibilité aux dispositifs. Dans d’autres secteurs, comme celui de la recherche, les crédits d’impôt sont gérés directement par le ministère de l’Économie et des Finances. Ce modèle, où les entités responsables de la politique culturelle fonctionnent comme des relais fiscaux relativement autonomes, est unique au monde[33]. Il fait en partie écho au principe d’exception culturelle, au sens où il s’agit d’un régime spécifique au secteur culturel, visant à le protéger des règles commerciales de libre-échange. Il diffère des pays, notamment fédéraux, comme les États-Unis et le Canada, où les compétences fiscales se situent au niveau des États ou provinces. Cela a un impact sur la manière dont les crédits d’impôt s’imbriquent dans le territoire. D’un point de vue comptable, on peut considérer les mécanismes français comme un dévoiement de l’idée de crédit d’impôt, ou, du point de vue de la politique culturelle, on peut le voir comme un outil certes non rentable, mais qui relève d’un soutien aux écosystèmes locaux[34].
Le cas de la Louisiane
En 2009, pour aider ses industries culturelles à se remettre de l’ouragan Katrina, la Louisiane a mis en place un crédit d’impôt sur les dépenses de production et le développement d’infrastructures de spectacles vivants, dans la limite de 10 millions de dollars par projet. Ce crédit d’impôt s’inscrivait alors pleinement dans une logique de régénération territoriale. Par ailleurs, il s’inspirait du programme similaire dédié à l’industrie audiovisuelle, créé en 1992 et dont les résultats ont été éprouvés, en ce qui concerne les revenus et les emplois[35]. À l’époque, bien que la culture musicale louisianaise fût largement reconnue, la région ne disposait pas d’une industrie bien implantée localement et souffrait de son éloignement géographique. La mise en place d’incitations fiscales a permis de compenser, voire d’instrumentaliser, dans une certaine mesure, cet éloignement, offrant une alternative sérieuse aux producteurs situés hors de l’État, tout en soutenant les productions locales.
La Louisiane propose aujourd’hui des crédits à la fois pour le spectacle vivant et la production phonographique[36].
- Le Louisiana’s Sound Recording Investor Tax Credit pour la musique enregistrée concerne 18 % des dépenses des projets d’enregistrement sonore réalisés dans l’État. Le programme est soumis à un plafond de 2,16 millions de dollars par an, tandis que les projets sont plafonnés à 100 000 $ par an. Les dépenses doivent s’élever à un minimum de 25 000 $ (10 000 $ pour les résidentes et résidents de Louisiane).
- Le Live Performance Production Incentive Program concerne les dépenses de spectacles réalisés dans l’État (7 % pour des productions comprises entre 100 000 et 300 000 $ ; 14 % entre 300 000 et 1 000 000 $ ; 18 % pour les budgets supérieurs). Le programme est soumis à un plafond de 10 millions de dollars par an (dont 50 % sont réservés aux organisations à but non lucratif). Les projets sont soumis à un plafond d’un million de dollars par an.
Le patrimoine culturel local est un argument central dans la stratégie de Louisiana Entertainment : « Connue pour être le berceau du jazz et abriter de nombreux artistes récompensés par des Grammy Awards, la culture créative renommée de la Louisiane a donné naissance à des artistes légendaires de tous les genres depuis des générations […][37] Entertainment recense également les studios, les salles de concert et le personnel qualifié, se tenant à la disposition des producteurs extérieurs. Les incitations fiscales fonctionnent, dès lors, comme une manière de promouvoir et de soutenir la culture et l’industrie musicale locales, en même temps que cette culture sert à promouvoir les incitations fiscales. Entertainment recense également les studios, les salles de concert et le personnel qualifié, se tenant à la disposition des producteurs extérieurs. Les incitations fiscales fonctionnent, dès lors, comme une manière de promouvoir et de soutenir la culture et l’industrie musicale locales, en même temps que cette culture sert à promouvoir les incitations fiscales.
La Louisiane fournit un exemple notable de mélange des logiques précédemment exposées, où productions étrangères et locales sont encouragées, bien qu’à des taux et conditions différents. En effet, le crédit d’impôt sur le spectacle vivant permet de déduire 7 % de dépenses supplémentaires pour les salaires des résidents de la Louisiane, tandis que le crédit d’impôt phonographique dispose d’un seuil minimum moins élevé pour les producteurs locaux. En ce sens, l’incitation fiscale intègre une double logique (attractivité et soutien local) dans son fonctionnement même. De plus, Louisiana Entertainment s’efforce de soutenir l’éducation et la formation professionnelle dans l’industrie du divertissement (live, phono et audiovisuel) en connectant l’incitation fiscale à un programme de soutien à l’éducation, via le Fonds de développement du divertissement, créé en 2017. Le fonds est financé par un droit de transfert de 2 % perçu lorsque des crédits d’impôt certifiés sont générés, et vise à soutenir les établissements d’enseignement supérieur accrédités en Louisiane et les instituts de formation spécialisés dans les domaines des arts, des médias et du divertissement. À pleine capacité, cela représente environ 2,7 millions de dollars par an[38]. Ce type de mécanisme s’apparente, d’une certaine manière, à la taxe prélevée sur les spectacles en France, qui sert ensuite à alimenter les fonds de soutien au secteur, sauf qu’il est ici connecté aux crédits d’impôt et à la formation. La Louisiane est l’unique exemple identifié pour cet article où une partie des crédits générés est réinjectée dans les structures de formation locales.
Malgré des fluctuations, la Louisiane reste aujourd’hui l’un des États américains, avec la Géorgie[39], les mieux positionnés en matière d’incitation fiscale pour la culture, avec des programmes dédiés à l’audiovisuel, au live et à la production phonographique, tous réunis sous une même bannière : Louisiana Entertainment. Cette marque confère aux crédits d’impôt musicaux une grande visibilité et lisibilité.
Les effets économiques et culturels des crédits d’impôt
Dans de nombreux cas, la mise en place de crédits d’impôt a entraîné une augmentation significative des dépenses de production, de la valeur économique des secteurs culturels auxquels ils s’adressent, de leurs emplois et des impacts dits indirects dans les territoires concernés. Par exemple, en Louisiane, le crédit d’impôt pour la production de spectacles vivants a vu ses dépenses certifiées augmenter sans cesse entre 2007 (date de son entrée en vigueur) et 2014. Malgré une baisse des dépenses de production engagées après 2014, le programme a maintenu son impact, notamment en soutenant la production locale. En 2019 (derniers chiffres disponibles), les dépenses liées à ce programme ont atteint 16 millions de dollars, générant 414 emplois, ainsi que 30 millions de dollars de ventes. Les recettes fiscales associées ont atteint 1,6 million en 2019, avec un retour sur investissement allant jusqu’à 0,63 $ de recettes publiques par dollar de crédit accordé. Chaque dollar de crédit a entraîné jusqu’à 4,99 $ de revenus et plus de 9 $ de ventes. De son côté, le crédit d’impôt pour l’enregistrement sonore a eu une activité stable entre 2017 et 2018, puis a légèrement augmenté en 2019 avant de chuter durant la pandémie. Plus modeste, ce programme a généré 6 emplois en 2019, avec des retombées fiscales de 41 000 $[40].
En France, au-delà des effets économiques, les crédits d’impôt sont évalués vis-à-vis de leur impact en matière de diversité culturelle, d’accès à la culture et de structuration sectorielle. Par exemple, 95 % des bénéficiaires du CIPP sont des TPE ou PME, qui représentent 80 % de la dépense fiscale totale[41]. Le dispositif joue ainsi un rôle redistributif vers les acteurs les plus fragiles de la filière, en particulier dans des esthétiques moins rentables ou plus expérimentales. Il agit aussi comme un puissant levier d’investissement : sans ce soutien, 34 % des projets n’auraient pas vu le jour et 58 % auraient été réalisés de manière moins ambitieuse, selon les personnes enquêtées. Le crédit d’impôt permet d’amortir les risques liés au développement d’un nouveau talent, en facilitant les investissements à long terme[42]. En ce qui concerne l’emploi, les bénéficiaires ont connu une croissance significative de leurs effectifs, et une part de contrats à durée indéterminée (CDI) supérieure à la moyenne nationale. Du côté du CISV, le constat est proche. Il permettrait aux producteurs de spectacles de sécuriser des tournées et de les rentabiliser, y compris dans des lieux à faible jauge. Le dispositif a favorisé la création d’emplois (+ 10 % en moyenne), avec un taux de CDI deux fois supérieur à celui observé dans l’ensemble de la filière. Il est estimé qu’il a permis la création d’environ 160 équivalents temps plein permanents.
Dans de nombreux cas, la mise en place de crédits d’impôt a entraîné une augmentation significative des dépenses de production, de la valeur économique des secteurs culturels auxquels ils s’adressent, de leurs emplois et des impacts dits indirects dans les territoires concernés.
Ces programmes français sont considérés par les producteurs musicaux comme un soutien fondamental à l’activité de leur filière dans toute sa diversité[43]. Celui-ci contribue à préserver une filière musicale francophone et à encourager la production d’œuvres en langue française, qui représentent plus de la moitié (53 %) des projets soutenus. Le CISV a notamment permis d’élargir la diffusion des spectacles sur l’ensemble du territoire, dans des zones peu couvertes par l’offre culturelle marchande. Si les études d’impact ne montrent pas de retour sur investissement particulier, ces dispositifs bénéficient non seulement aux petites structures, mais surtout à celles qui ne touchent pas ou très peu de subventions, notamment dans le secteur des musiques dites actuelles situées en dehors de la région parisienne[44]. Autrement dit, la dimension territoriale des crédits d’impôt musicaux français résiderait avant tout dans une forme de soutien à la décentralisation de la production.
Il est également utile de comparer ces résultats avec ceux des programmes pour l’audiovisuel qui ont davantage d’ancienneté. L’analyse longitudinale (1998-2010) couvrant 50 juridictions américaines montre que la présence d’incitations, même sans tenir compte de leur montant, est associée à une hausse de 37 % du nombre de tournages, de 17 % de l’emploi, et de 19 % des créations d’entreprises dans le territoire concerné[45]. Ces effets sont décuplés lorsque le territoire est composé d’entreprises cinématographiques diversifiées capables de se saisir du mécanisme. Par exemple, en 2022, l’industrie audiovisuelle aurait soutenu 59 700 emplois en Géorgie[46]. Un aspect particulièrement intéressant de l’essor des dépenses de production est qu’il s’est accompagné d’un investissement privé de 1,28 milliard de dollars pour la construction de nouveaux studios, l’agrandissement de studios existants et la reconversion de bâtiments. Bien qu’il soit toujours difficile de l’affirmer avec certitude, il est peu probable que ces investissements aient eu lieu sans les incitations fiscales. Cela ouvre des perspectives intéressantes pour le secteur musical, où l’on manque encore de données de ce type.
En France, le cas des crédits d’impôt pour les productions audiovisuelles internationales indique également des développements possibles pour le secteur musical. On assiste en effet à un essor remarquable de ces productions depuis l’instauration du crédit d’impôt international (C2I). En 2009, la France accueillait environ 100 jours de tournages étrangers. Ce chiffre a bondi à 1 900 jours en 2021[47]. En 2022, un record a été établi avec 133 projets internationaux bénéficiant du C2I (contre seulement 5 en 2009), représentant près de 591 millions d’euros de dépenses. Des réalisateurs de renom tels que Woody Allen (Minuit à Paris), Martin Scorsese (Hugo Cabret), Christopher Nolan (Dunkerque), Ridley Scott (Le dernier duel), Wes Anderson (The French Dispatch) ou Tom McCarthy (Stillwater) ont tourné en France. Selon le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), ces grandes productions ont mis en valeur les compétences des producteurs exécutifs et des équipes techniques françaises, contribuant à leur forger une réputation internationale, sans affecter le dynamisme de la production locale qui bénéficie de nombreux soutiens dédiés. On peut ainsi imaginer comment les studios et producteurs musicaux français, dont la qualité est déjà reconnue au niveau international, pourraient profiter d’un tel programme. La stratégie d’internationalisation du CNM pourrait ainsi inclure l’attraction de productions internationales, en plus du soutien aux producteurs français qui cherchent à s’exporter.
Par ailleurs, l’un des impacts qui n’ont pas encore été envisagés dans le cadre des crédits d’impôt musicaux français concerne l’essor d’un tourisme spécifique, comme dans le cas islandais. Une étude réalisée en 2021 pour Netflix et l’Organisation mondiale du tourisme montrait que visionner des contenus provenant d’autres pays augmente significativement la probabilité d’y voyager. Par exemple, plusieurs sites apparus dans la série Game of Thrones ont vu leur fréquentation croître fortement[48]. Les productions musicales internationales réalisées en France pourraient avoir des effets similaires, notamment lorsqu’elles concernent les vidéos musicales[49]. Le tourisme musical connaît déjà un certain essor à travers le monde et pourrait bénéficier de nouvelles synergies[50].
Malgré ces exemples de réussite, l’analyse des dispositifs fiscaux dans le domaine audiovisuel met aussi en évidence des résultats mitigés, notamment l’impact faible sur l’économie de certains territoires[51]. Nombre de crédits d’impôt, dans la musique comme dans d’autres secteurs comme l’audiovisuel, ont été créés selon des logiques d’attractivité territoriale sans que les écosystèmes locaux existants ou en devenir soient toujours pris en compte. Les critiques ont pointé du doigt les effets d’aubaine pour les producteurs internationaux au détriment des locaux[52]. Par exemple, en Espagne, les entreprises étrangères accaparent 76 % des avantages fiscaux[53]. Une autre critique s’est concentrée sur la « course vers le bas » : les territoires se livrent à une concurrence excessive, en offrant des incitations toujours plus élevées. En effet, nombre de crédits d’impôt répondraient à une « logique de l’ajustement sectoriel […], privilégiée par des gouvernements souvent soucieux de compromis politiques et d’électoralisme[54] ». Ils éroderaient les finances publiques sans même contribuer au bien commun. Pour compenser cela, une vision davantage écosystémique des crédits d’impôt doit être envisagée.
Pour une vision écosystémique des crédits d’impôt musicaux
Cette dernière partie propose une série de recommandations qui font des crédits d’impôt des outils au service d’un tissu industriel structuré en forme d’écosystème territorialisé. Le secteur audiovisuel a pris de l’avance sur ce terrain, via des approches écosystémiques qui combinent les mécanismes fiscaux avec d’autres instruments, liés au développement de la formation professionnelle, des infrastructures, et de la diversité socioculturelle par exemple, le tout dans une logique double de développement territorial et culturel[55]. Ces instruments forment un ensemble interconnecté, un écosystème censé à la fois attirer des productions internationales et favoriser des industries locales. Cette vision peut être adaptée, dans une certaine mesure, au secteur musical.
Pour que les incitations fiscales constituent des éléments moteurs des écosystèmes musicaux, elles doivent non seulement envisager les productions locales et internationales, mais aussi être prévisibles, simples et transparentes, afin de permettre aux producteurs phonographiques et de spectacles français comme étrangers de planifier de manière efficace. Les recommandations issues des études d’impact des programmes français vont d’ailleurs dans ce sens[56]. Pour que les incitations profitent aux producteurs étrangers désirant développer un spectacle, une œuvre ou un enregistrement en France, elles doivent être présentées en différentes langues, recenser les partenaires locaux et clarifier les modalités de coproduction. Dans l’audiovisuel, c’est le rôle que jouent les sites Internet dits « one-stop shop », qui prennent généralement la forme d’une plateforme numérique qui centralise toutes les ressources, autorisations, informations et soutiens nécessaires à la réalisation d’une production audiovisuelle (film, série, publicité, etc.) au sein d’un territoire donné (ville, région, pays). En France, le modèle de référence est le site Film France du CNC.
De plus, pour attirer des productions internationales, les incitations fiscales doivent supprimer tous les filtres liés au contenu des productions, par exemple le critère de francophonie, sur le modèle du C2I dans l’audiovisuel. Cela n’empêche pas de conserver ce critère pour les productions locales, ou sous forme de bonus en pourcentage des dépenses remboursées. Tant que les dépenses sont engagées sur le territoire français, les projets devraient pouvoir renvoyer à n’importe quelle expression culturelle.
Pour une efficacité optimale, les incitations fiscales doivent aussi s’inscrire dans un environnement propice, notamment sur le plan légal et administratif. En effet, comme dans le cinéma, les incitations fiscales ne servent à rien si, par exemple, les permis liés à la mise en place de spectacles, les visas et autres procédures visant les productions locales et étrangères sont trop complexes. Si les organismes rchargés des incitations fiscales n’ont généralement pas la main sur ces processus, ils peuvent au moins les rendre plus clairs et faciles à appréhender, via des fiches pratiques et des services de conseil.
De même qu’en Islande et en Louisiane, le savoir-faire des techniciennes et techniciens locaux et la force d’inspiration liée à l’atmosphère locale peuvent constituer des arguments forts pour attirer les productions étrangères. Il est donc nécessaire que les crédits d’impôt se dotent de stratégies de communication faisant la promotion de ces aspects. En retour, les crédits d’impôt peuvent contribuer à la formation des acteurs locaux. Si nombre de régions et pays investissent dans la formation des intermédiaires de la culture, ces programmes sont bien souvent déconnectés des incitations fiscales. Or, il est crucial pour leur attractivité que les territoires soient alignés sur les besoins des industries qui y investissent potentiellement, en particulier en ce qui concerne les compétences pratiques sur scène et en studio. Les dispositifs fiscaux constituent non seulement un outil pour recueillir des données au sujet de ces besoins, mais aussi un réservoir de ressources financières, lorsque leur impact économique est positif. Il en va de même pour les investissements dans les infrastructures (résidences, studios d’enregistrement, studios de répétition, scènes). Ils peuvent aussi contribuer à une plus grande diversité, équité et inclusion, en se dotant d’outils supplémentaires : par exemple, des taux de remboursement préférentiels (comme pour les TPE et PME) lorsque les productions musicales favorisent la participation de cultures, de territoires et groupes sociaux marginalisés.
Conclusion
La France a historiquement envisagé les incitations fiscales et les programmes de soutien à la culture comme des outils au service du développement du secteur plutôt que du territoire. Toutefois, dans l’absolu, rien n’oblige à conserver une telle dichotomie, comme le montrent les cas de l’audiovisuel français et, dans une certaine mesure, de la Louisiane. Au contraire, les deux paradigmes peuvent coexister et être mutuellement bénéfiques. Pour cela, il faut sortir d’une vision où les incitations fiscales fonctionnent en silo, que ce soit pour le développement culturel, territorial, ou économique. En effet, les incitations fiscales peuvent attirer des productions à court terme, mais elles ne suffisent pas à créer un secteur local durable, même dans d’autres secteurs économiques[57]. Elles peuvent certes envoyer un signal positif, mais leur impact reste limité lorsqu’elles fonctionnent de manière isolée.
Les approches écosystémiques, cependant, peuvent permettre aux crédits d’impôt musicaux de devenir de véritables outils au service des écosystèmes musicaux et, par là même, des territoires qu’ils occupent. Dans les secteurs culturels, face à la perception largement répandue d’une diminution générale des ressources publiques directes disponibles, les crédits d’impôt peuvent non seulement fournir une alternative de financement[58], mais aussi devenir des éléments moteurs du renouvellement des politiques culturelles pour la musique, notamment au niveau européen.
[1] Cet article fait partie d’un projet qui a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie no 101022942.
[2] SCOTT A. J., « Origins and growth of the Hollywood motion-picture industry: the first three decades », dans P. Braunerhjelm et M. P. Feldman (dir.), Cluster Genesis. Technology-Based Industrial Development, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 17-37.
[3] DUVAL S., « État des lieux des mesures fiscales incitatives en faveur de la culture et de la presse », La lettre juridique, no 175, 7 juill. 2005, en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3207477-le-point-sur-etat-des-lieux-des-mesures-fiscales-incitatives-en-faveur-de-la-culture-et-de-la-press. À l’inverse, il faut signaler que la fiscalité peut également constituer un obstacle voire un outil de répression pour la culture.
[4] Pour cette raison, certains programmes, comme à Porto Rico ou en Louisiane, disposent d’un plafond pour chaque production incitée, mais aussi pour le programme entier. Voir Nordicity, « Live performing arts sector. Tax credit research », oct. 2024, en ligne : https://www.arts.on.ca/research-impact/research-publications/live-performing-arts-sector-%E2%80%93-tax-credit-research-final-report.
[5] Par exemple, en Irlande, le crédit d’impôt musique ne concerne que la musique à l’image, tandis que dans de nombreux pays, il ne concerne que des chansons ou albums. En France, il inclut à la fois les disques et les vidéomusiques.
[6] Par exemple, certains crédits prennent en charge les tarifs horaires des studios d’enregistrement, d’autres les dépenses salariales (pour l’embauche d’interprètes, de producteurs et productrices, d’ingénieures et ingénieurs ou de personnel de studio ou de scène), ou alors les décors et costumes dans le cas du live, et éventuellement les frais de voyage et de transport des instruments de musique et des interprètes.
[7] En France, les programmes soutiennent la francophonie, tandis qu’au Mexique, ils se limitent à certains répertoires musicaux (classique, jazz et traditionnel).
[8] Par exemple dans le cinéma, où les projets sont évalués par des commissions via des critères artistiques qualitatifs. GIMELLO-MESPLOMB F., « Un régime de justification comme modèle historiographique de la politique du cinéma : l’idéaltype de la “qualité” », Les Actes du Cresat, no 11, 2014, p. 27-39, en ligne : https://hal.science/hal-00997944.
[9] CHARBONNIER R., « La régulation à l’épreuve du changement : le cas de la musique », thèse en sciences de gestion, Palaiseau, Institut polytechnique de Paris, 2022, en ligne : https://theses.hal.science/tel-04082849.
[10] NESTRUCK J. K., « In Toronto-vs-Chicago theatre war, tax credits are the new ammo », The Globe and Mail, 30 janv. 2012, en ligne : https://www.theglobeandmail.com/arts/theatre-and-performance/in-toronto-vs-chicago-theatre-war-tax-credits-are-the-new-ammo/article554545.
[11] ENOS M., « Oxford Economics reveals findings on the fiscal impact of live music », Recording Academy, 5 août 2021, en ligne : https://www.recordingacademy.com/advocacy/news/oxford-economics-reveals-findings-fiscal-impact-live-music.
[12] MARKUSEN A. et NESSE K., « Institutional and political determinants of incentive competition », dans A. Markusen (éd.), Reining in the Competition for Capital, Kalamazoo, W. E. Upjohn Institute for Employment Research, 2007, p. 1-42.
[13] CASTENDYK O., « Tax incentive schemes for film production: a pivotal tool of film policy? », dans P. Murschetz et al. (dir.), Handbook of State Aid for Film. Finance, Industries and Regulation, Cham, Springer, 2018, p. 597-614.
[14] CHRISTOPHERSON S. et RIGHTOR N., « The creative economy as “big business”. Evaluating state strategies to lure filmmakers », Journal of Planning Education and Research, vol. 29, no 3, mars 2010, p. 336-352.
[15] LEISER S., « The diffusion of state film incentives. A mixed-methods case study », Economic Development Quarterly, vol. 31, no 3, août 2017, p. 255-267.
[16] ALBERGE D., « Tax relief sets stage for investment boom in UK theatre », The Guardian, 1er sept. 2014, en ligne : https://www.theguardian.com/stage/2014/sep/01/tax-relief-uk-theatre-investment-boom?CMP=twt_gu.
[17] ENOS M., « Oxford Economics reveals findings on the fiscal impact of live music », art. cité ; STONER R. et DUTRA J., « The U.S. music industries: jobs & benefits. The 2020 report », Economists Incorporated, déc. 2020, en ligne : https://www.riaa.com/reports/the-u-s-music-industries-jobs-benefits-economists-incorporated.
[18] YGLESIAS A. M., « Be like Björk: Iceland unveils new ‘Record In Iceland’ initiative », Recording Academy, 9 oct. 2019, en ligne : https://www.grammy.com/news/be-bjork-iceland-unveils-new-record-iceland-initiative.
[19] À la différence des programmes en France et en Louisiane, qui imposent des seuils minimaux.
[20] Voir le site du programme : https://www.record.iceland.is.
[21] Voir notamment le Music Fund : https://www.icelandmusic.is/en/music-fund.
[22] Voir le site du programme : https://filminiceland.com/about.
[23] Music Cities Events, « #InConversationWith Leifur Björnsson. All you need to know about Record in Iceland programme », 15 mars 2024, en ligne : https://www.musiccitiesevents.com/post/leifur-bjornsson-record-in-iceland.
[24] Les données historiques sont notamment issues d’un entretien avec Cécile Jeanpierre, responsable des crédits d’impôt au Centre national de la musique (CNM).
[25] CNM, « Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique », 30 sept. 2020, en ligne : https://cnm.fr/aides-financieres/credit-dimpot-en-faveur-de-la-production-phonographique.
[26] CHIANESE J., « Global production incentives to watch: a look back at 2024 and what’s ahead in 2025 », Entertainment Partners, 14 janv. 2025, en ligne : https://www.ep.com/blog/global-production-incentives-to-watch-a-look-back-at-2024-and-whats-ahead-in-2025.
[27] « [E]ntreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, françaises ou ressortissantes d’un autre État membre de l’Espace économique européen ayant un établissement stable en France pour toute dépense effectuée dans un État membre de l’Espace économique européen » : voir CNM, « Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique », op. cit.
[28] Les taux du crédit d’impôt en faveur de l’édition sont équivalents au crédit spectacle vivant, mais son périmètre est plutôt similaire au crédit phonographique, du fait d’un focus sur les nouveaux talents francophones. Le montant des dépenses éligibles est limité à 300 000 euros par contrat et ne peut excéder 500 000 euros par entreprise. Voir CNM, « Crédit d’impôt en faveur de l’édition d’œuvres musicales », 18 nov. 2022, en ligne : https://cnm.fr/aides-financieres/editeurs/credit-dimpot-en-faveur-de-ledition-doeuvres-musicales.
[29] Dans les deux cas, les entreprises éligibles doivent être françaises, et les dépenses doivent être engagées majoritairement sur le territoire français ou dans un autre État membre de l’Union européenne.
[30] Direction générale des Médias et des Industries culturelles (DGMIC), « Synthèse de l’étude sur l’évaluation de la répartition des rémunérations entre producteurs phonographiques et artistes-interprètes », ministère de la Culture, 4 juill. 2017, en ligne : https://www.culture.gouv.fr/espace-documentation/etudes-et-statistiques/Repartition-des-remunerations-entre-producteurs-phonographiques-et-artistes-interpretes.
[31] Le critère de langue inclut les langues régionales.
[32] Lorsque les albums sont chantés dans une langue autre que le français ou qu’une langue régionale en usage en France, leur éligibilité au crédit d’impôt est soumise à une condition dite de « francophonie » évaluée au niveau de l’ensemble de la production annuelle de l’entreprise : au moins la moitié des albums d’expression qu’elle produit chaque année doivent être en français ou dans une langue régionale reconnue. Une dérogation à cette clause est mise en place pour des projets portés par des microentreprises. Toutefois, elle reste un frein pour des structures spécialisées dans des esthétiques internationales (musique classique, musiques du monde), où l’usage d’autres langues est constitutif de l’identité de l’entreprise. Voir CNM, « Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique », op. cit. ; SPANU M., « Pour une approche critique de la diversité des langues chantées dans les musiques populaires à l’ère de la mondialisation numérique », Questions de communication, no 35, 2019, p. 281-303, en ligne : https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.19465.
[33] CHARBONNIER R., « La régulation à l’épreuve du changement : le cas de la musique », op. cit.
[34] O’CONNOR J., Culture Is Not an Industry. Reclaiming Art and Culture for the Common Good, Manchester, Manchester University Press, 2024.
[35] SELSKY R. et TAGLAFIERRO J., « Economic and fiscal impact. Motion picture production tax credit (2019-2020): Louisiana Entertainment », Camoin Associates, mars 2021, en ligne : https://www.opportunitylouisiana.gov/wp-content/uploads/2023/12/2021-economic-and-fiscal-impact-reports-film-live-sound.pdf.
[36] Il convient de préciser que l’étude présentée ici a été conduite avant juin 2025, date de la restructuration du programme et de la disparition de l’entité « Louisiana Entertainement ».
[37] Louisiana Entertainement, « Why record here? », consulté en ligne le 23 mars 2025.
[38] Louisiana Entertainment, « Entertainment Development Fund », consulté en ligne le 23 mars 2025.
[39] Depuis 2005, en Géorgie, les entreprises peuvent économiser sur des dépenses telles que l’enregistrement du son et de la vidéo grâce à un crédit d’impôt transférable pouvant aller jusqu’à 30 %. Ce crédit s’inscrit dans le programme audiovisuel préexistant et concerne également des industries connexes, comme le jeu vidéo. Un crédit d’impôt dédié au spectacle vivant a également été mis en place pour stimuler l’investissement local.
[40] SELSKY R. et TAGLAFIERRO J., « Economic and fiscal impact », op. cit.
[41] ZAPARUCHA E. et al., « Étude d’impact de deux dispositifs fiscaux du CNM : Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique et Crédit d’impôt en faveur des producteurs de spectacles vivants », Technopolis Group, août 2023, en ligne : https://cnm.fr/wp-content/uploads/2023/10/Technopolis-Rapport-devaluation-des-credits-dimpot-geres-par-le-CNM.pdf.
[42] Ibid.
[43] Ibid.
[44] EY (Ernest & Young), « Étude d’impact du crédit d’impôt pour le spectacle vivant musical ou de variétés », juill. 2018, en ligne : https://ekhoscenes.com/storage/medias/impact-credit-dimpot_o_1hst01rol1fnq1j4vm2b18f7haf13.pdf.
[45] O’BRIEN N. F. et LANE C. J., « Effects of economic incentives in the American film industry: an ecological approach », Regional Studies, vol. 52, no 6, 2018, p. 865-875.
[46] Ibid.
[47] Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), « Rapport d’activité 2022 », oct. 2023, en ligne : https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/etudes-et-rapports/rapports-d-activite/rapport-dactivite-2022-du-cnc_2281214.
[48] ZURRO J., « España, el “Hollywood de Europa” : el 85 % de los beneficios fiscales del cine son para producciones extranjeras », El Diario, 11 avr. 2023, en ligne : www.eldiario.es/cultura/cine/espana-hollywood-europa-85-beneficios-fiscales-cine-sonproducciones-extranjeras_1_10107815.html.
[49] Le CNC propose déjà une aide particulière pour les vidéomusiques, mais celle-ci est une subvention sur dossier à laquelle ne peuvent prétendre que les productions françaises.
[50] Sound Diplomacy et ProColombia, « Music is the new gastronomy », en partenariat avec l’Organisation mondiale du tourisme, 2018, en ligne : https://www.sounddiplomacy.com/reports/music-is-the-new-gastronomy.
[51] BUTTON P., « Can tax incentives create a local film industry? Evidence from Louisiana and New Mexico », Journal of Urban Affairs, vol. 43, no 5, 2021, p. 658-684 ; BRADBURY J. C., « Do movie production incentives generate economic development? », Contemporary Economic Policy, vol. 38, no 2, avr. 2020, p. 327-342.
[52] MESSERLIN P. et PARC J., « The myth of subsidies in the film industry: a comparative analysis of European and US approaches », Innovation. The European Journal of Social Science Research, vol. 33, no 4, 2020, p. 474-489.
[53] ZURRO J., « España, el “Hollywood de Europa” : el 85 % de los beneficios fiscales del cine son para producciones extranjeras », art. cité.
[54] LEROY M., « Découvrir la sociologie fiscale », Regards croisés sur l’économie, no 1, 2007, p. 94-100, en ligne : https://doi.org/10.3917/rce.001.0094.
[55] Je m’appuie ici principalement sur l’étude suivante : Olsberg SPI, « Best practice in screen sector development », en collaboration avec l’Association of Film Commissioners International (AFCI), sept. 2024, en ligne : https://afci.org/wp-content/uploads/2024/09/Best-Practice-in-Screen-Sector-Development-Final-2024-09-18.pdf.
[56] ZAPARUCHA E. et al., « Étude d’impact de deux dispositifs fiscaux du CNM : Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique et Crédit d’impôt en faveur des producteurs de spectacles vivants », op. cit.
[57] DELTOUR-BECQ L., « Attractivité des territoires et fiscalité locale des entreprises », Paris, Conseil des prélèvements obligatoires, janv. 2014, en ligne : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/rapport_particulier_Deltour_Becq.pdf.
[58] SCHUSTER J. M., « Tax incentives in cultural policy », dans V. A. Ginsburg et D. Throsby (éd.), Handbook of the Economics of Art and Culture, Amsterdam, Elsevier, vol. 1, 2006, p. 1253-1298.