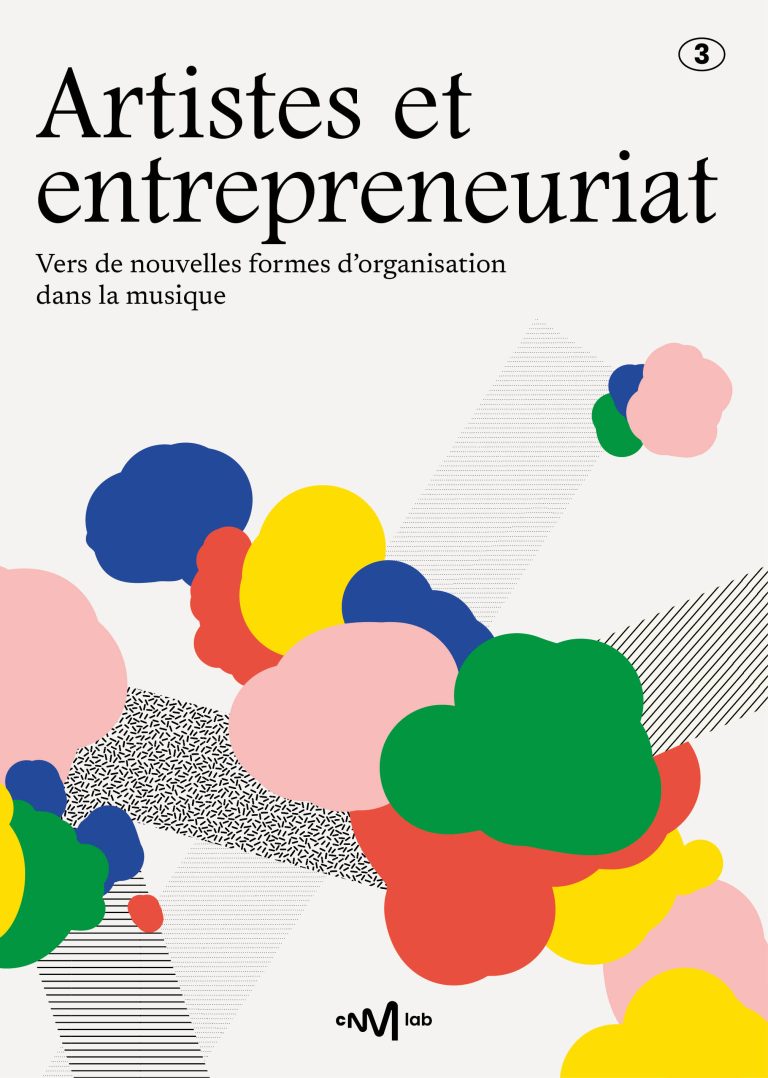Rebeka Warrior – Entretien
Que vous évoque la notion d’artiste entrepreneur ?
Je dirais que, en 2024, si tu n’es pas un ou une artiste entrepreneur, tu as peu de chances de t’en sortir. Aujourd’hui, c’est devenu de plus en plus courant et de plus en plus essentiel. Je viens du milieu de l’electro et de la techno, et c’est quelque chose qui était déjà courant : chaque DJ était aussi son propre producteur parce qu’il n’y avait tout simplement pas de débouchés. Cela fonctionnait ainsi et cela a fait jurisprudence, aujourd’hui c’est valable pour de plus en plus d’artistes.
À quand remontent les premiers moments de votre carrière où vous avez dû faire par vous-même ?
Avec Sexy Sushi et Mansfield.TYA, tous les premiers disques ont été autoproduits. Nous étions débutantes et débutants et nous avions complètement l’esprit DIY. Pour nous c’était assez normal et naturel. Avec les copains et copines, nous enregistrions à la maison avec ce que nous trouvions, et nous gravions ensuite nous- mêmes les CD. Puis, nous les distribuions vraiment en DIY, sous le manteau, par courrier postal ou même par Internet. Nous avions un Tumblr au début, sur lequel les gens mettaient leur adresse. Nous avions embauché ma colocataire pour envoyer les disques.
C’est pour cela qu’il y a un milliard d’albums de Sexy Sushi avec des titres qui sont toujours les mêmes, mais nous avons changé le nom des albums parce que nous faisions comme nous voulions : cet album, il s’appelle Ça m’aurait fait chier d’exploser, l’autre c’est exactement les mêmes tracks mais il s’appelle J’aime les tartes, nous avons changé le nom. Tout était très artisanal et cela nous permettait une grande flexibilité.
Comment en êtes-vous venue à utiliser Internet pour toucher des gens ?
Sexy Sushi est un groupe que j’appellerais « groupe Myspace » : c’est Myspace qui nous a conçus. Il y avait cette plateforme qui venait d’être créée, nous trouvions cela génial, nous passions notre temps dessus. Et puis, tout d’un coup, les auditeurs s’emparaient d’un groupe parce qu’ils en avaient envie. Donc il n’y avait pas besoin de gens extérieurs, pas besoin du marché de la musique, pas besoin de major, besoin de personne. Et nous nous retrouvions avec des millions d’auditeurs de partout dans le monde. Cela nous a vraiment motivés. Avec Myspace, avec la possibilité de faire des sites sur Free, avec Megaupload, tout était gratuit et disponible tout le temps. C’est la période pendant laquelle Sexy Sushi a commencé, et il y a eu cette empreinte très forte du DIY, c’est-à-dire que c’est le public qui a fait les groupes (ce qui n’était pas trop le cas avant).
Comment expliquer que, d’emblée, vous faisiez par vous-mêmes ?
Je venais vraiment de la scène techno et underground, donc je n’ai même pas pensé à un autre système. Plus tard, ce sont plutôt les maisons de disques qui sont venues me chercher, moi je n’y avais même pas songé, cela ne me concernait pas. Avec Mansfield.TYA, j’ai adopté le même système, j’ai appliqué la méthode en usage là d’où je venais, alors que clairement ce n’était pas le même genre de musique et c’était un marché différent. J’ai été surprise quand, tout d’un coup, Myspace nous a fait avoir autant d’auditeurs et d’auditrices, que l’on nous contacte, que l’on veuille de nous dans des grands festivals mainstream, puis, par la suite que l’on veuille de nous pour sortir des disques. Je me disais : « Mais qui va acheter nos disques ? »
Pareil pour le live ?
Au début, c’était ma colocataire qui nous trouvait des dates, alors que ce n’était pas tellement son boulot. Elle nous trouvait des dates dans des squats, dans des endroits improbables. Et nous, nous y allions une fois sur quatre, parce qu’une fois sur quatre, on oubliait, ou alors cela ne nous intéressait plus, c’était trop loin, on annulait, etc. Sexy Sushi a fait une carrière comme ça, sur un malentendu : les gens se demandaient : « Ils ne sont jamais là, est-ce qu’ils vont venir ? », et c’est devenu un peu un mythe. Je pense que ce sont des méthodes qu’appliquent les majors (peu d’infos divulguées, pas de promo, comme le culte du secret autour de Mylène Farmer) ou certaines et certains artistes, mais que nous avons appliquées à notre insu, ce n’était pas du tout intentionnel. Il y avait beaucoup d’endroits qui nous voulaient, nous ne venions pas, et les gens devenaient fous, cela créait une énorme demande.
Quand nous avons commencé à comprendre que ça marchait bien, nous avons commencé à aller dans des gros festivals, aux Vieilles Charrues, à Glastonbury, on a joué en Chine, en Russie, beaucoup dans les pays de l’Est, au Canada, en Amérique latine…, nous avons joué un peu partout. Là, nous nous sommes rendus compte que Myspace avait de la puissance, et que nous avions construit quelque chose en étant un peu en dehors de l’industrie de la musique.
À ce moment-là, comment gériez-vous les droits d’auteur et l’administratif ?
C’était l’anarchie, parce que c’était aussi ma colocataire qui s’est occupée de récupérer les droits de la Sacem. Au début, nous l’avons déclarée comme arrangeuse, nous la payions sur nos royautés, elle était déclarée comme faisant partie du groupe. Au bout d’un moment, nous nous sommes dit que nous avions fait n’importe quoi. Nous avons fait beaucoup d’erreurs qui ont continué à se répercuter jusqu’à récemment puisque les albums de Sexy Sushi n’étaient pas sur Spotify. Rien que pour démêler quels titres étaient sur quels albums, cela nous a pris du temps.
Donc, il y a eu beaucoup de réussite et de joie, et aussi beaucoup d’erreurs et de problèmes. Aujourd’hui encore, avec mon agente, on essaie de réparer les dégâts qui ont été faits à cette époque. C’est vraiment le ying et le yang. On a avancé comme on pouvait, avec des nouveaux schémas.
Par la suite, comment a évolué l’envie d’éviter les acteurs du marché ?
C’était très ambivalent parce que nous voyions bien qu’avec Sexy Sushi nous avions énormément de succès et qu’en même temps nous étions inadaptés au marché tel qu’il était. Nous ne voulions pas nous plier à certaines règles, cela nous a valu des conflits avec certaines personnes. Et moi, en parallèle, je développais aussi Mansfield.TYA, groupe pour lequel j’avais trouvé des partenaires : un label indépendant puis un tourneur. Tout se mettait en place avec ce groupe plutôt chanson, j’ai ensuite concédé à appliquer le même schéma pour Sexy Sushi. Mais cela s’est fait assez lentement.
Qui est ce « nous » ? Qui sont les gens qui vous entourent à ce moment-là ?
En l’occurrence, je parle de Mitch, qui faisait Sexy Sushi avec moi, et de Carla, qui faisait partie de Mansfield.TYA, nous avons un peu grandi ensemble. Mais ce sont aussi les partenaires que nous rencontrions, les managers, les tourneurs, etc. Par exemple, cela fait vingt ans que je bosse avec la même boîte de tour, Wart, et au début ils étaient tout petits, comme moi. Nous nous sommes super bien entendus et nous nous sommes un peu développés ensemble parce que nous apprenions un peu tous en même temps. De même, j’ai la même agente pour tous mes projets depuis vingt ans. Au départ, elle organisait des soirées à Paris et nous essayions tous et toutes de comprendre comment le monde allait changer et comment s’adapter. C’est le propre de l’artiste que de savoir comment la société va bouger. Si tu as une vision étriquée de l’art, si tu es trop rigide, tu es condamné.
En fait, entre mes débuts et maintenant, on a demandé à l’artiste de faire de plus en plus de choses : faire ses pochettes, avoir une identité visuelle et audiovisuelle, faire des clips, des collaborations, s’acoquiner avec les gens de la mode, etc. En fait, on nous a demandé d’avoir un concept global, mais d’où nous venions nous avions déjà cette mentalité. Et on ne peut pas parler d’avoir un concept global sans parler d’argent, cela fait partie du package de s’occuper de comment marche son business.
Qu’est-ce qui relève de votre envie personnelle de maîtriser le business autour de votre art, et qu’est-ce qui relève d’injonctions extérieures ?
Je n’ai jamais été dans le cas de figure où l’on m’a demandé des trucs : vu mon parcours, j’ai tout de suite pris les rênes. Il n’y a qu’avec les éditions que je n’ai pas pu faire à ma manière directement. Mais aujourd’hui, je suis libérée au maximum de mes engagements sur les précédents albums, j’ai récupéré ma liberté éditoriale.
Quels sont les avantages et, à l’inverse, les difficultés et obstacles de faire soi-même ?
Le point vraiment positif pour moi dans tout cela, c’est que je n’ai pas changé de système : c’est parti du DIY et ça l’est encore. C’est juste que, l’expérience pesant, nous avons tous et toutes progressé énormément, nous avons tous et toutes appris. Du coup, le DIY est devenu professionnel : aujourd’hui, nous savons nous battre avec les armes de la profession.
Ce que j’en retire, c’est d’avoir appris tout ça et d’avoir appris avec des partenaires qui ont appris en même temps que moi. Nous nous sommes tous et toutes formés en même temps et je trouve ça assez beau : nous sommes devenus des formes améliorées de nous-mêmes. Aujourd’hui nous avons des conseillères et des conseillers, nous avons des avocates et des avocats, nous avons eu parfois des contentieux, nous avons fait des erreurs qu’un professionnel ou une professionnelle n’aurait pas faites, mais nous avons fait nos armes et je trouve cela génial de faire son chemin dans la vie. Artistiquement, cela m’a permis d’aller exactement dans la direction artistique que je souhaitais. Ce sont des points hyper positifs. On se construit aussi en faisant « de la merde ».
Le temps passé à devoir faire plus et par soi-même est-il aux dépens des temps de création ?
Non, plus je comprends le système dans lequel je vis, plus je fais les choses à 360°, et plus c’est satisfaisant et rapide de créer. Donc le fait que je comprenne tous les tenants et aboutissants, cela m’aide à composer, c’est plus efficace. Cela me prend certes du temps, qui aurait pu être du temps créatif. Mais quand je me mets à créer, je m’adresse à une communauté que je connais bien, dont je cerne les contours, j’arrive à mieux cibler ce que je veux faire puisque je sais où et à qui je m’adresse. C’est peut-être aussi parce que j’ai mûri et que je réussis mieux à consacrer du temps pour chaque chose.
Les méthodes DIY m’ont forgé un certain caractère et aussi une certaine rigueur. Le fait de faire toute seule, cela permet de vraiment s’organiser et de mettre des rites en place. Et j’adore faire ça. Je trouve que tout est intéressant, que ce soit la création ou l’administra- tif. À la base, je ne faisais pas du tout les calculs, les tableaux Excel, je m’intéressais peu à l’administratif, la Sacem, l’Adami, le CNM, etc. J’ai appris petit à petit, et aujourd’hui je trouve cela assez cool de faire ces trucs-là. Comme je le disais, l’artiste doit vraiment être au courant de comment marchent les mécanismes de la société. Du coup, cette partie-là m’aide aussi à com- prendre comment marche le système. Et même si je ne n’apprécie pas ce système capitaliste dans lequel nous vivons, pour autant je ne peux pas habiter dans une grotte. J’analyse donc mon écosystème pour essayer d’en tirer parti. Je crée mes structures, etc.
À quand remonte cette envie ?
C’est Vitalic, avec qui j’ai le groupe Kompromat, qui le premier m’a encouragée à faire tout ça. Il a sa propre boîte, son label Citizen, depuis très longtemps. Et quand on a sorti le premier Kompromat, naturellement il a dit :
« Si tu veux, je sors ce disque chez moi. » Donc je l’ai regardé faire, j’ai observé comment il avait avancé dans la vie avec ces deux casquettes. Il m’a un peu transmis cet amour de faire, il m’a appris beaucoup de choses.
Quand en êtes-vous venue à créer votre propre structure ?
Le confinement a été un moment pendant lequel j’ai eu plus de temps pour réfléchir à ce que je voulais et à ce que cela voulait dire de sortir ses propres disques. C’est pendant cette période que j’ai commencé à me dire que je connaissais les bons partenaires et que ça pouvait être intéressant pour moi de sortir le disque de Mansfield.TYA.
Au début, nous avons monté une association pour faire ça. Dernièrement, on est passé en SAS juste avec Maud, mon agente, parce que la forme associative était trop précaire. Une certitude, pour travailler sereinement et sérieusement : savoir s’entourer d’une équipe solide et de partenaires fiables.
Qui travaille autour de vous aujourd’hui ?
D’abord Maud, qui est mon agente et qui tient la boîte. On travaille avec Élodie Haddad, qui travaillait aussi chez Pan European, elle est cheffe de projet quand il faut sortir un disque. Il n’y a que Maud et moi qui sommes dans la boîte, les autres sont des électrons libres. Nous avons une comptable. Nous travaillons aussi avec Manon qui m’assiste à la direction artistique (vidéo, photos, pochettes de disque…). Nous avons aussi une personne qui s’occupe du marketing digital, parce que nous avons compris que c’était le nerf de la guerre. Mais aussi une avocate et une assistante épaulent Maud. Nous travaillons avec une autre personne pour les tâches administratives. Lise s’occupe de la régie pour les tournées. Nous rappelons régulièrement les mêmes gens, c’est une équipe de base.
Donc l’équipe entière n’est constituée que de femmes et c’est une équipe soudée. On essaie d’être au maximum une boîte queer et féministe. Il y a des mecs qui vont et qui viennent, et ce n’est jamais un problème. Mais c’est vrai que nous voulons mettre en avant des femmes queers, surtout dans notre catégorie de musique cold wave-new wave, où c’est encore très masculin. Nous avons créé cette boîte aussi pour montrer qu’il pouvait y avoir à la fois des femmes à la tête des boîtes, à la gérance, et dans des catégories de musique où on ne les attend pas.
Pour le live, vous passez toujours par Wart ou, là aussi, vous avez pris plus de responsabilités ?
Non, c’est Wart qui gère le tour. Nous avons essayé tout de même pour voir, avec les soirées Warrior Amor à mort, mais nous en sommes revenues, c’était trop compliqué pour nous. Les soirées ont vraiment bien marché, mais la quantité de travail était monstrueuse. Et puis Wart est mon partenaire depuis 20 ans donc c’est très agréable de travailler entre proches et gens de confiance. Ce modèle me convient. Quand je tourne avec Kompromat par exemple, c’est à moitié Wart et à moitié Uni-T – le tourneur de Vitalic. Et, avec le label Warriorecords, nous essayons de coproduire les soirées parfois et, si nous ne pouvons pas, ils le font seuls. C’est une entente à l’amiable.
Il y a aussi l’intention de produire d’autres artistes ?
Oui, les tournées RainboWarriors et Warrior Amor à mort étaient issues de sorties du label. Pour moi, c’était important de faire en sorte que la partie disque devienne concrète et que les gens se rencontrent. Parce que maintenant tu peux faire des morceaux de chez toi, les envoyer par le Web et ne pas forcément rencontrer les gens. Et cela, pour le coup, ne me passionne pas. Donc l’idée c’était aussi de pouvoir rencontrer untel qui habite en Géorgie, aller là-bas, et faire des incartades dans tous les milieux queers et indés du monde qui aiment la new wave.
Avez-vous aussi des gens dédiés à l’édition et la recherche de financements ?
Oui, la personne qui s’occupe de la partie administrative. Elle nous aide aussi pour la recherche de financements. Les éditions c’est le prochain dossier brûlant, nous allons bientôt créer une société d’édi- tion, mais pour l’instant nous nous concentrons sur la partie production et sur la récupération de tous nos droits. Cela prend du temps, mais, grâce à ce travail, nous avons pu récupérer des royautés qui n’étaient pas versées depuis très longtemps, par exemple.
Quel est votre rapport au numérique, aux réseaux sociaux, aux plateformes ?
Les réseaux sociaux ont fait ce que je suis. Cela nous a permis de prendre notre envol et notre indépendance. C’est beaucoup à gérer, c’est beaucoup de temps, mais cela permet une grande autonomie. Même si ma communauté n’est pas très grande, ce sont des personnes fidèles, et cela permet d’avoir un système pérenne. Quand je fais une date, je préviens sur les réseaux et puis, hop, la salle se remplit, les disques se vendent. Donc il y a évidemment des côtés négatifs, c’est chronophage, mais en tant qu’artiste, quand même, cela facilite certaines choses.
Comment voyez-vous l’avenir des artistes ? Que faut-il encourager et mettre en place ?
Pour moi, aujourd’hui, c’est essentiel d’être sa propre boîte. Mais quand tu arrives dans le game et que tu n’as pas forcément tout de suite les épaules pour créer une SAS et pour être accompagné, ce qui est compliqué dans le système actuel c’est que tu ne peux pas être à la fois intermittent et posséder une société. Or, si ce n’est pas possible que les artistes soient à la fois intermittents et propriétaires de leurs œuvres, ils ne peuvent pas se lancer. Cela donne des choses complètement folles, comme commencer par être intermittent, puis mettre un ami ou une amie, ou un ou une membre de sa famille, à la tête de sa boîte pour la piloter. Il faudrait que cela change. Il y a de plus en plus de dispositifs qui aident quand même à aller dans ce sens, à accompagner les artistes. Par exemple, j’avais obtenu le prix du Fair qui m’avait donné une formation. Le CNM ou la Sacem accompagnent aussi les artistes dans ce sens, etc. C’est essentiel. Il faudrait davantage aider les artistes à devenir autonomes et entrepreneurs.
En l’espèce, comment conciliez-vous direction d’une SAS et intermittence ?
On tricote, mais je trouve cela aberrant. Cela m’a même porté préjudice, parce que lorsque j’ai créé l’association, c’était pour ne pas avoir à monter une boîte. Je me disais qu’avec une association, il n’y aurait pas de problème. Mais, avec une asso, ta musique ne t’appartient pas, elle devient le patrimoine de l’association. Il y a de nombreux aspects compliqués administrativement et comptablement. J’ai eu l’impression de me tirer une balle dans le pied. Donc l’urgence c’est de permettre aux artistes intermittents d’être entrepreneurs, en faisant par exemple des barèmes ou encore en com- pensant ce qu’ils touchent avec leur société par une réduction de leur allocation d’intermittence. La défense du salariat est hyper légitime. Mais, le statut d’artiste étant vraiment trop particulier, il faut l’adapter.
Quels conseils donneriez-vous à l’artiste féminine de demain ?
Il y a le MEWEM [Mentoring Program for Women Entrepreneurs in Music Industry], un programme de mentorat exclusivement féminin que je trouve très bien. Pour tourner avec des techniciennes et se for- mer avec des femmes, More Women On Stage, de la géniale Lola Frichet, est un très bon dispositif. Il y a des femmes qui m’ont beaucoup aidée, et j’essaie de redonner la pareille. Il faut vraiment multiplier les entraides dans notre milieu, pour avoir plus de visibilité et d’égalité sur les affiches par exemple, afin que les femmes soient les têtes d’affiche et non plus les plus petits groupes. Même chose dans les entreprises, c’est aux postes clés que nous manquons de puissantes. Seulement 7 % de femmes parmi les compositeurs et compositrices de musique de film… et un chiffre quasi identique pour le nombre de femmes Sacem pro (c’est- à-dire avec des gros revenus).
Propos recueillis par Robin Charbonnier et Céline Lugué