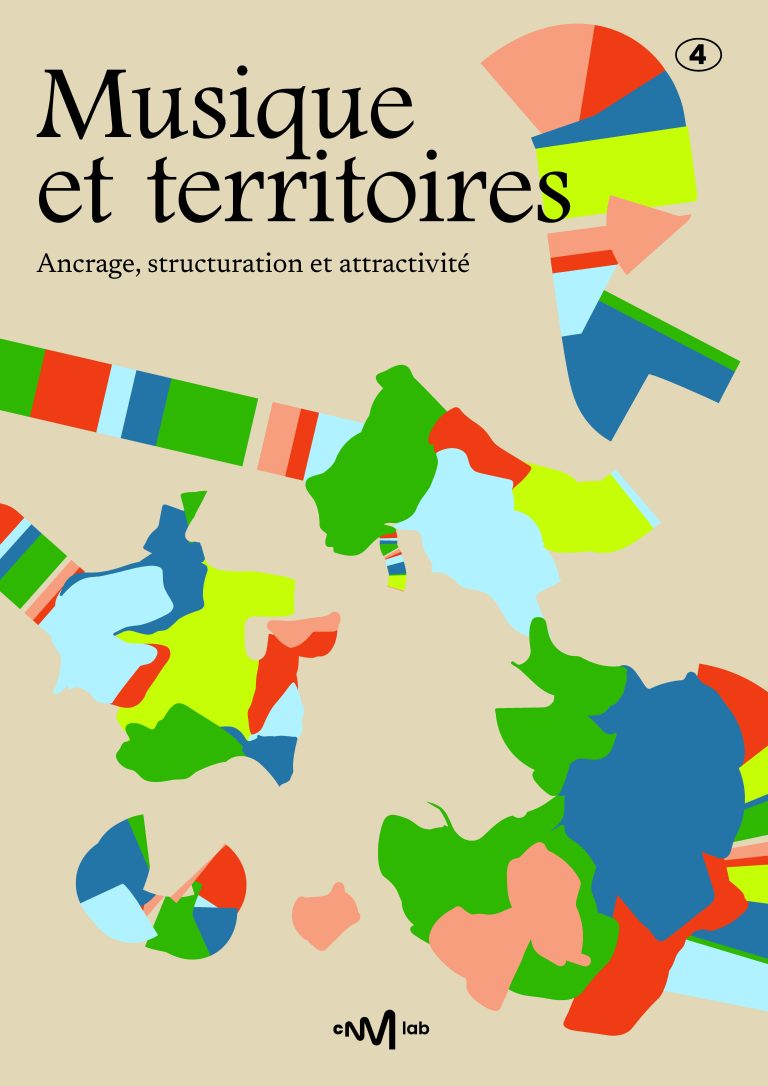Éditorial
Des lieux de répétition aux salles de concert, la musique réinvente nos manières d’habiter les territoires. Elle fait exister des espaces où se tissent sociabilités, usages et imaginaires communs. La musique n’est jamais seulement un art ou une industrie : elle est aussi un fait territorial. Elle révèle des circulations — artistes, publics, influences — tout en s’ancrant dans des lieux, des scènes et des identités locales.
Dans son précédent recueil, Artistes et entrepreneuriat, le CNMlab a montré que si la chaîne de valeur s’est recentrée autour d’un artiste devenu entrepreneur de sa carrière, les intermédiaires demeurent essentiels. Ces transformations sont toujours ancrées dans des territoires variés. Dans ce quatrième recueil, nous nous intéressons au territoire comme espace d’expérimentation sociale. Comment la présence d’acteurs, d’initiatives ou d’infrastructures musicales change-t-elle un lieu ? Comment les politiques publiques accompagnent-elles l’écosystème musical ? Comment penser l’avenir des territoires de la musique ?
Ces questions sont au cœur de la mission du Centre national de la musique. Établissement public créé pour soutenir l’ensemble de la filière musicale, le CNM accompagne les acteurs sur tout le territoire national, des métropoles aux zones rurales et ultramarines. Son action vise à garantir l’équité d’accès à la création et à la diffusion musicale, tout en renforçant les dynamiques locales. À travers ses dispositifs de soutien et ses travaux de recherche, le CNM contribue à faire des territoires de véritables leviers de développement pour l’écosystème musical français.
En 2021, 82 % des Français considéraient la musique essentielle au dynamisme de leur territoire. Pourtant, les inégalités d’accès à la culture persistent entre métropoles et territoires ruraux ou ultramarins. Ce paradoxe pose une question centrale : comment s’articulent, dans la filière musicale, logiques de rayonnement culturel et cohésion territoriale ? L’attractivité repose sur la visibilité et la capacité à capter des flux ; la cohésion vise l’équité d’accès, notamment dans les espaces moins dotés. Ces tensions interrogent aussi les modes d’évaluation des politiques culturelles, au-delà des seuls indicateurs économiques.
Pour éclairer ces questions, ce recueil réunit des contributions qui, de l’échelle des festivals à celle des quartiers, interrogent les modes de fabrication des territoires musicaux. Les festivals en constituent un observatoire privilégié : Julien Audemard, Aurélien Djakouane, Stéphane Laurent et Emmanuel Négrier examinent les mérites et limites de l’évaluation des retombées économiques locales, à partir du cas des Eurockéennes de Belfort. Lise Bodin, Corentin Charbonnier et Emilie Ruiz étudient l’attractivité du Hellfest Open Air et montrent comment celle-ci se construit dans la durée, au fil d’un dialogue constant entre organisateurs et acteurs locaux.
Au-delà des temps festivaliers, c’est la fabrique quotidienne des scènes locales qui structure durablement les identités musicales des territoires. Gérôme Guibert explore cette notion à travers le cas du rock alternatif à Angers, étudiant la construction d’une marque artistique territoriale. Myriam Boualami met en évidence, via une étude statistique de données Deezer, la persistance de la centralité parisienne dans les trajectoires des artistes de rap, malgré la dématérialisation. Thibault Jeandemange nous emmène à Lyon pour comprendre comment les disquaires indépendants façonnent un territoire sonore à l’échelle de la ville. Florabelle Spielmann propose un diagnostic de la filière musicale en Guadeloupe, territoire peu étudié malgré la richesse de sa vie créative.
Ces mouvements s’appuient aussi sur des dispositifs d’intervention publique dont l’efficacité mérite d’être interrogée. Michaël Spanu examine les liens entre crédits d’impôt et développement territorial, grâce à une comparaison internationale (Islande, France, Louisiane). L’équipe de recherche Dédale présente L’Estafette, un dispositif de concerts gratuits et itinérants ancré dans le Ségala rural, interrogeant les conditions de réussite d’une politique culturelle décentralisée.
Plusieurs contributions explorent également les expérimentations qui renouvellent les formes musicales en territoire. Basile Michel pose les défis écologiques du secteur musical en France et s’arrête sur deux initiatives — le groupe Aïla en Gironde et le festival La P’art Belle dans le Morbihan — qui œuvrent à la mise en place de nouvelles approches. Julie Oleksiak décrypte le projet Super Tapages, qui valorise l’écoute musicale comme outil de lien social à Francheville.
Enfin, deux entretiens approfondis complètent cette réflexion. Michaël Dian, directeur artistique du Festival de Chaillol, conçoit la musique comme un artisanat d’excellence et un levier de création de communautés. Gisèle Magnan, fondatrice des Concerts de Poche, inscrit son projet dans une démarche d’émancipation en démocratisant l’accès à la musique.
L’ensemble de ces contributions rappelle que la fabrique des politiques musicales ne peut être pensée indépendamment des réalités locales et des contraintes structurelles propres à chaque contexte. Ce recueil offre un panorama des multiples façons dont se façonnent aujourd’hui les territoires de la musique, esquissant le portrait d’un paysage en mouvement où se redéfinissent les équilibres entre ancrages locaux et circulations globales.
Jean-Baptiste Gourdin, président du Centre national de la musique