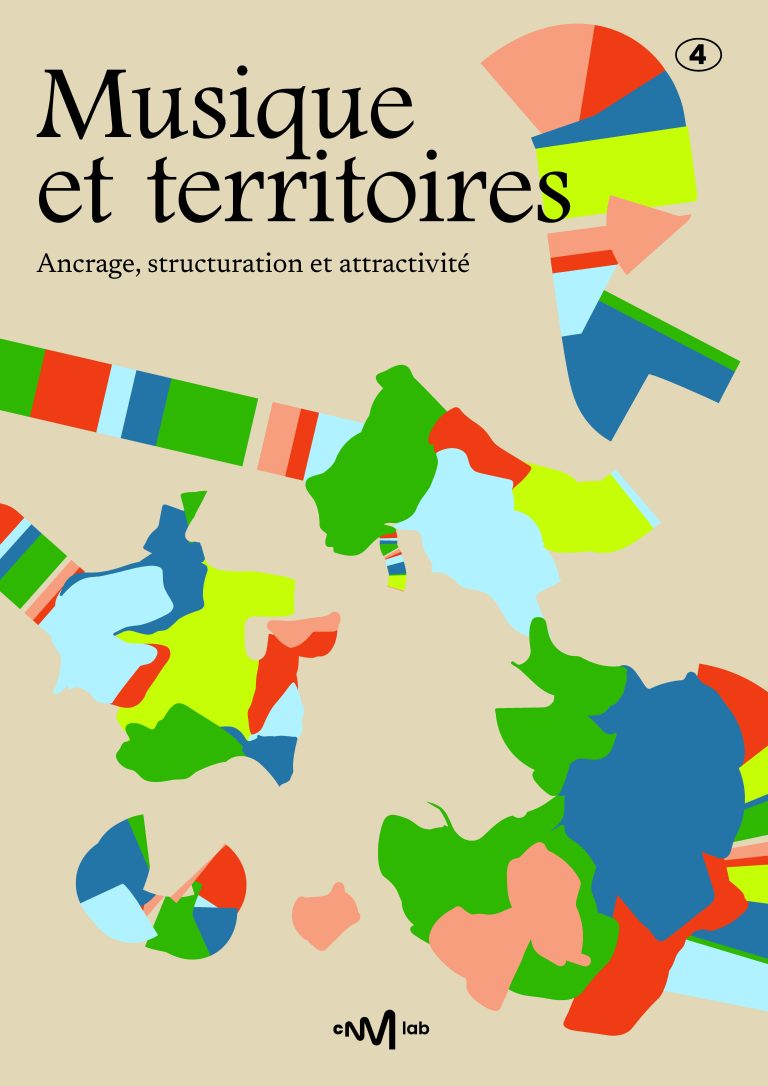Michaël Dian – Entretien
Espace culturel de Chaillol
Créé en 1998, l’Espace culturel de Chaillol est un outil de coopération culturelle des Hautes-Alpes. Il associe une saison de concerts itinérante à un programme d’action culturelle, ainsi qu’à une politique de commande d’œuvres et de résidence de création. Labellisé « Scène conventionnée d’intérêt national — Art en territoire » en 2019, il affirme son attachement aux musiques de création et se veut un outil complet au service de la création musicale et de celles et ceux qui la portent.
Pour vous, qu’est-ce qu’un territoire ?
Le territoire n’est sûrement pas qu’une carte, ou une réalité administrative ou politique, c’est une réalité complexe, avec une épaisseur humaine, anthropologique. C’est également un lieu imaginé, métaphorique. Il y a le territoire tel qu’on peut le vivre au quotidien, qu’on peut décrire, et dans lequel on circule, et il y a la manière dont le festival de Chaillol a façonné un imaginaire, comme une cartographie singulière, une manière de percevoir et d’habiter ce territoire, redessiné par le souffle de la musique. C’est d’ailleurs un sujet de conversation avec les habitants qui sont fidélisés autour du projet ou qui s’y impliquent avec les élus. Le territoire du festival de Chaillol n’est pas seulement cette réalité première des Hautes-Alpes, il y a comme un autre niveau de réalité, au-dessus de la réalité charnelle du territoire haut-alpin. C’est cet écart-là qui m’intéresse beaucoup. Il n’y a pas une identité parfaite entre les Hautes-Alpes, la géographie humaine, l’anthropologie ou l’histoire, et le territoire du festival de Chaillol. C’est cette question d’un écart fondateur que je travaille depuis 30 ans.
Quels sont vos liens personnels avec ce territoire ? Et comment est née la toute première édition du festival de Chaillol ?
Je suis né à Marseille de parents immigrés ; fraichement arrivés de Tunisie, mes parents ont connu les Alpes pour des raisons familiales et sont tombés amoureux de ce territoire qu’ils n’ont cessé de retrouver, en vacances, été comme hiver, avec cette idée très citadine d’y aller « prendre le bon air », c’était leur formule, entendue toute mon enfance.
Quand j’étais jeune musicien au conservatoire de Marseille, mes parents ont commencé à nous inscrire, ma sœur flûtiste et moi, à des stages d’été de musique, qu’on trouve un peu partout en France. Et moi qui commençais à envisager la musique de manière professionnelle, j’ai été inscrit à des stages très importants, des passages obligés pour préparer l’entrée aux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de Lyon. Mes parents, jeunes profs, avaient été choqués par le coût de ces stages, mais surtout par l’absence totale d’encadrement et de prise en charge de l’enfant — et pas simplement du jeune musicien. Ils se sont dit « Bon, nous, on n’est pas des musiciens mais on est profs, la transmission, on sait ce que c’est alors on va monter un stage de musique ». Mes parents créent donc un stage de musique à Chaillol, avec des professeurs du conservatoire, une proposition construite autour de l’enfant et de ses besoins, avec des cours d’instruments, bien sûr, mais aussi du sport, la découverte de la nature, des balades. Ce stage, qui a existé pendant vingt-neuf ans, a connu sa dernière édition juste avant le Covid. Au plus haut de son intensité, il accueillait près de deux cents familles, en deux sessions de dix jours avec dix classes d’instruments, de la musique de chambre, des classes d’orchestre. Un très bel événement, une ambiance familiale et très chaleureuse comme l’avaient voulu mes parents, portée de manière bénévole à l’exception des professeurs et des animateurs qui encadraient les enfants. J’entre au CNSDP en 1990, dans la même promotion que Renaud Capuçon avec lequel j’ai passé mon prix de musique de chambre. Sur un coin de table de la cafeteria du Conservatoire, on dresse ensemble la liste des œuvres qu’on rêve de jouer. On appelle quelques copains, et mon père demande au maire de Chaillol s’il est d’accord pour payer les billets de train et l’hébergement. C’est comme cela que le festival de Chaillol est né. La même année, Renaud a organisé la première édition de son premier festival, à Chambéry. On est vraiment dans quelque chose de très spontané, très joyeux, qui n’est presque pas pensé, une initiative un peu brouillonne, adolescente et fougueuse. Et ça marche, les concerts sont pris d’assaut dès la première édition. La salle est immédiatement trop petite, le maire enthousiaste. Il est toujours maire trente ans plus tard, et il se rappelle cette bande de jeunes gens qui débarquent de Paris, de Lyon, d’Allemagne, et qui donnaient des concerts tous les soirs. Au début, on faisait passer le chapeau et, en quelques années, la chose a grandi, sans contrainte, portée par l’élan d’une bande de musiciens.
Quelles ont été les grandes étapes d’évolution du projet ?
Elles sont liées à des prises de conscience, progressives, sur le sens de ce que nous avions fait d’abord très spontanément, puis de manière plus réfléchie, avec les années. Je me rendais compte que ces paysages de mon enfance résonnaient autrement, par la musique que mes amis et moi y produisions. Il était évident que nos propositions, portées par les citadins que nous étions tous, créaient une étrangeté, un déplacement, et cette question, éminemment politique, m’a passionné.
Pour la deuxième année du festival, on crée une association qui s’appelle « Espace culturel de Chaillol ». Le premier président de l’association, Marc Lourdaux, travaillait alors à l’Office du tourisme de Chaillol — petite station de 300 habitants, il nous aidait à la logistique. Il s’était pris d’affection pour mes parents et cette bande de jeunes un peu originaux. C’est un homme qui, formé comme forestier, connaissait très bien le territoire. Peu après, en tant que directeur de l’Office de tourisme intercommunal, il impulse la dimension territoriale du projet, porté par les contacts qu’il noue avec tous les maires de la vallée — soit à peu près une vingtaine de communes. Marc me rapporte que des maires aimeraient pouvoir accueillir un concert dans leur commune. Je me dis alors qu’il faut qu’on s’organise pour pouvoir répondre à cette demande. Faire deux concerts par soir, un concert à Chaillol, puis un concert en dehors. On a fait ça pendant quelques années, en redéfinissant les équipes. C’était beaucoup de musique de chambre au départ.
Et, petit à petit, cela nous a obligés à redéfinir le projet. D’autant que, très rapidement, un maire important des Hautes-Alpes qui est aujourd’hui sénateur, Jean-Michel Arnaud, maire de la commune de Tallard (de l’autre côté de Gap, c’est-à-dire assez loin), dispose d’un château exceptionnel dans sa commune. Il vient me voir et me demande trois concerts du festival de Chaillol. À ce moment-là, on a commencé à comprendre que le festival de Chaillol était devenu une garantie de qualité, comme un label. On est passé d’une demande qui venait du territoire à un travail régulier, approfondi, auprès des habitants pour accompagner cette demande. Marc parlait aux maires pour convenir des conditions, et moi, je les appelais après lui pour parler du projet artistique. J’expliquais la nature de nos répertoires, la résonance avec les paysages de montagne, avec l’esprit des lieux. Pour beaucoup, la musique que nous jouions n’était pas attendue, souvent elle n’avait jamais été entendue non plus.
En 2003, la crise des intermittents a été pour beaucoup un électrochoc, et pour moi l’accélérateur d’une prise de conscience, puisque notre petit festival ne devait son existence qu’à ce régime d’indemnisation qui permettait à des artistes, la plupart intermittents, de consacrer du temps à faire naître un projet. Ce festival pouvait exister grâce à un système qui se trouvait attaqué de manière brutale. On a donc décidé de ne pas annuler l’événement, mais d’expliquer comment il pouvait exister. Ce furent donc des étapes de mûrissement. On est aussi sortis du temps estival pour organiser des concerts tout au long de l’année, pour rencontrer les habitants de manière plus intime que pendant la haute saison touristique. Nous avons développé les volets sociaux et éducatifs qu’on appelle aujourd’hui « éducation artistique et culturelle » (EAC). Plus récemment encore, grâce au conventionnement avec l’État en tant que Scène conventionnée d’intérêt national, nous avons pu soutenir plus nettement la production de la création, c’est-à-dire des résidences d’artistes, avec le soutien de la Sacem, du CNM et de toutes les sociétés civiles qui concourent à la qualité et à la qualification du geste musical.
Comment est née l’idée de faire circuler la musique sur différents territoires ? Comment avez-vous défini le périmètre du festival autour du Pays gapençais ?
L’idée de circulation est venue très tôt : « circulation dans les répertoires, circulation dans les territoires ». On disait ça comme ça. Mais comment faire, et à quelle échelle territoriale ? À l’époque, nous ne sommes qu’une petite association de bénévoles, sans aucun salarié. Il y a eu une rencontre déterminante avec Julien Saint-Aman, alors directeur du Pays gapençais — une instance administrative de développement territorial à l’échelle d’un bassin de vie, créée par les lois Pasqua (1995) puis Voynet (1999). C’est une instance qui accompagne des projets qui concourent à la cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’emploi. Pendant une dizaine d’années, Julien Saint-Aman, aujourd’hui président de l’Espace culturel de Chaillol, accompagne la montée en puissance des concerts en dehors de l’été, avec des moyens issus de fonds européens et de la Région PACA. On a commencé avec un concert par mois dans une commune, puis deux, puis trois l’année suivante, etc. On avait donc quasiment une autre saison de janvier à juin, financée par le Pays gapençais via des fonds FEDER européens, des fonds régionaux et des fonds d’initiatives locales.
Le projet s’est finalement stabilisé autour du périmètre du Pays gapençais qui recoupe les quatre vallées qui font le tour de Gap. C’est un bassin de vie cohérent, parce que les gens qui habitent dans les vallées à Chaillol travaillent souvent à Gap, un peu comme les dynamiques qui peuvent exister entre Paris et les communes de la petite couronne. Il y a des circulations de la périphérie vers le centre. Mais les gens ne se déplacent que rarement d’une vallée à l’autre, à l’exception des marcheurs passionnés. Des gens venus pour un concert nous disaient très fréquemment : « ah, c’est incroyable, on est allé à Châteauvieux » alors qu’ils habitaient la vallée d’en face, ou « on n’était jamais rentré dans cette commune, elle est absolument magnifique, on a mangé au restaurant du coin ». C’est un argumentaire qu’on a travaillé, j’ai beaucoup écrit sur tout ça aux élus ou à la presse. On a conceptualisé ensuite ces deux moteurs que sont la circulation dans les territoires et la circulation dans les répertoires, avec cette intuition qu’à l’échelle d’un bassin de vie, on peut trouver une offre culturelle musicale adaptée à la démographie d’un territoire de montagne qui permet de créer aussi une communauté d’attention à la question de la création musicale.
Comment la programmation musicale a-t-elle évolué depuis les débuts du festival ? Comment le festival aborde-t-il l’hybridité entre musique savante, populaire et expérimentale ?
Partant d’une programmation qui était celle de jeunes gens passionnés par la musique de chambre savante européenne (Brahms, Schuman, Beethoven, on ne jouait que ça nous, à cette époque !), la programmation s’est rapidement ouverte au jazz et aux nouvelles musiques du monde, aux musiques issues des oralités traditionnelles, aux musiques de terroir, d’Europe et d’ailleurs. Moi qui étais un pur produit du conservatoire, j’ai eu envie de proposer tout ce que ma curiosité me poussait à découvrir. Nous nous vivions comme un opérateur de service public, portant des missions d’animation du territoire qui exigeaient une réflexion sur les répertoires.
Quand j’avais vingt ans, il fallait aller à la Médiathèque musicale de la ville de Paris pour découvrir de la musique : on avait le droit à trois 33 tours et une cabine pendant deux heures. Aujourd’hui, les musiciens qui sont formés dans les conservatoires sont nourris de tant de répertoires différents, spontanément ouverts au dialogue interculturel et très à l’aise avec les outils de compositions numériques. Ce que j’ai appelé « le retour du refoulé », ce sont toutes les mémoires traditionnelles et populaires qui sont enfouies dans les territoires et qui percolent de manière de plus en plus nette dans le travail des musiciens et compositeurs. Aujourd’hui, le paysage musical de l’Espace culturel de Chaillol témoigne de l’amplification de l’élargissement du périmètre d’attention aux musiques d’aujourd’hui. C’est vraiment une approche d’hybridation, de redéploiement des mémoires collectives.
Comment différenciez-vous les publics de l’été et ceux du reste de l’année ? Quelles stratégies avez-vous mises en place pour fidéliser les habitants du territoire ?
Tout au début, le festival était essentiellement fréquenté par les résidents secondaires et les touristes. On n’avait que peu de locaux. On les avait marginalement, mais ils se disaient que c’était pour les Marseillais, pour les Parisiens, pas pour eux. En développant une saison tout au long de l’année, nous voulions aller à la rencontre des habitants, puisqu’il y a peu de touristes à cette époque. Concert après concert, on arrive à attraper les gens, à leur faire sentir qu’ils sont chez eux puisqu’on joue dans leurs églises, dans leurs salles des fêtes, et même parfois dans des salles de conseils municipaux. Ce qui est très intéressant, c’est que la proportion d’habitants dans le festival annuel s’est évidemment répercutée dans le festival d’été : on n’avait pas moins de touristes, mais on avait plus d’habitants. On a aujourd’hui une programmation estivale dont je suis très heureux. Je me retourne et je vois des gens dont je sais qu’ils sont des résidents secondaires très fidélisés, et puis on a tous ceux qu’on croise dans l’année et qui se sentent tout à fait à leur place, fidélisés par le travail que nous avons développé avec les écoles, les centres sociaux, les associations du territoire, etc.
J’ai l’impression, après 30 ans d’activités, que nous faisons partie du paysage. J’ai le souvenir d’un groupe de personnes, que j’ai vu vieillir parce qu’elles avaient cinquante ans quand j’ai commencé il y a trente ans, qui jouent toujours aux boules à côté d’endroits où on fait les concerts, et qui ne sont jamais venues. Je les ai invitées des dizaines de fois, en leur disant « ce soir, c’est du jazz » ou « demain, c’est de la chanson française, ça va vous plaire ! ». J’ai finalement arrêté d’essayer de les convaincre quand je me suis rendu compte qu’elles étaient très fières que le festival existe. Chaque fois que je les croise, elles me disent : « ça va le festival ? Ça tient ? Tu as toujours tes subventions ? Bon, c’est super ! ». Elles y sont très sincèrement attachées alors qu’elles ne sont jamais venues, même une fois, c’est incroyable.
À travers cette expérience, qu’avez-vous appris sur la manière d’écouter de la musique ? Comment est-elle partagée ? Quels sont les freins à venir écouter de la musique ?
J’avais des représentations un peu classiques, je me disais « il faut donner l’accès aux gens ». Alors, je faisais des petites levées de rideau avec des explications pédagogiques et musicologiques. J’ai arrêté de le faire parce que je me suis rendu compte que ce n’était pas du tout ce qui manquait.
La musique est un art de la relation, essentiellement. Ce qui m’intéresse dans la musique aujourd’hui, ce n’est absolument pas le prestige qui l’entoure, ni les valeurs esthétiques au sens du plaisir individuel qu’on en retire comme auditeur (qui relève de l’intime), mais ce qui me fascine, c’est la capacité qu’a la musique de générer des communautés d’attention, de la communion. Par ailleurs, on est dans un territoire qui invite à cela parce que ce sont des petites collectivités où les gens se connaissent. La vallée du Champsaur compte 11 000 habitants. Si vous allez au marché du Pont du Fossé ou à celui de Saint-Bonnet, tout le monde se connait et se parle. Quand vous produisez une offre culturelle qui prend les gens au sérieux, cela génère une qualité de relation qui fait que des artistes qui jouent dans des festivals parfois très prestigieux, sortent de scène et me disent tous : « le public du festival de Chaillol est incroyable, il y a une écoute rare, presque fervente ».
Je parle beaucoup de la nature du travail des artistes au public, lors de rencontres, d’émissions de radio, ou de moments plus informels. Le geste musical est un geste d’excellence. Jouer du violon, du piano, du n’goni ou de n’importe quel instrument qui existe sur la planète, demande une maîtrise qui s’apparente à un artisanat d’art, le fruit d’une vie de travail, sur soi et avec son instrument. Il y a un art de faire musical comme il existe d’autres arts de faire dans un territoire. Par exemple, lors d’une balade musicale, où on va rencontrer un berger qui conduit son troupeau, on se rend compte qu’on utilise les mêmes mots pour parler de son savoir-faire, de sa conduite du troupeau. C’est très musical aussi, l’art du berger.
Je peux vous parler d’un autre souvenir qui a été une belle leçon d’humilité. Il y a environ quinze ans de cela, j’avais programmé le quatuor Béla, un des grands quatuors français qui se dédie à la création contemporaine. L’équipe me dit : « on a programmé ça à Bénévent », un petit village au-dessus de Saint-Bonnet, de quelques dizaines d’habitants. Je programme les artistes, et après, je transmets à l’équipe qui effectue ce travail très fin de couture pour ventiler sur le territoire. Il y avait des raisons acoustiques et de calendrier, mais tout de même, vingt-cinq habitants, et un quatuor avec des répertoires hongrois du XXe siècle, de Bartok à Ligeti… Et bien le concert était plein. Il n’y a pas de parking dans les petites communes de vallée, donc les gens se garent où ils peuvent, il y avait un embouteillage. Je suis au premier rang, je présente le concert et dis deux mots de remerciements pour l’accueil du maire et de la paroisse. Je passe à la fois un bon concert, c’était exceptionnel, mais je me demande bien comment cela se passe pour le public. Je me dis que c’est peut-être un répertoire trop exigeant. Quand j’ai vu tout le monde se lever et applaudir, être emporté par la vérité et la force du geste artistique, j’ai été un peu honteux de ce que j’avais pensé. J’ai vraiment pris une leçon que je n’ai jamais oubliée, et de ce fait, je sais que les gens peuvent tout écouter. Cependant, il faut les accueillir en disant que la musique est en réalité un geste de composition, d’élaboration de grande honnêteté, et que chacun conserve la liberté d’y réagir à sa façon. Toutes les émotions, y compris l’incompréhension ou l’agacement face à une œuvre qu’on ne saisit pas, sont acceptables.
Intégrez-vous les habitants dans certaines de vos créations artistiques ? Les transformations que vous proposez encouragent-elles une plus grande pratique musicale de leur part ?
Il faut lever une ambiguïté sur cette notion de participation. Je l’entends au sens où elle est définie dans le cadre des droits culturels. Il faut commencer par reconnaitre à toute personne des ressources culturelles dignes d’être mobilisées. Ces ressources me permettent de dire que chacun est prédisposé à la curiosité musicale. Quand on est spectateur ou bénévole, n’est-on pas déjà dans la participation, dans le fait de contribuer, à la réalisation d’un événement artistique ? Il faut donner une dimension extensive à cette notion de participation et ne pas la réduire à la participation au geste artistique. Car si vous donnez un violon à quelqu’un qui n’en a jamais joué, il n’en fera rien. Donc, si la participation est une dimension essentielle du projet de l’éducation artistique et culturelle (EAC), elle est entendue de manière ouverte, qui permet aux personnes de contribuer de manière significative pour elles.
Pensez-vous que le modèle de Chaillol puisse être reproduit ailleurs ? Comment concevez-vous la coopération à l’échelle régionale, nationale ou européenne ?
Le projet est stabilisé depuis une dizaine d’années et maintenant on réfléchit, pour revenir à la question du territoire, à des échelles de coopération un peu élargies au niveau régional et national. C’est un peu naturel pour une scène conventionnée. Mais là, on a mis au travail depuis cet été une intuition, celle d’imaginer des coopérations avec d’autres villes ou villages de l’arc alpin en Europe qui ont des projets de cette nature-là, avec un lien territorial très fort. On a l’idée de déposer un projet européen l’année prochaine, qui mettrait en relation des projets un peu cousins de l’espace culturel de Chaillol, mais dans des communes rurales ou rurales de montagne de l’arc alpin. Parce que l’arc alpin, c’est une chose considérable, qui traverse toute l’Europe depuis Monaco, remonte ensuite jusqu’à l’Italie, l’Autriche, etc. C’est pour cela que la question du territoire est, pour moi, au cœur de tout, avec la notion de territoire appliquée au territoire de la création. Il y a aussi un enjeu de définir, par la notion de territoire, le paysage de la création musicale aujourd’hui en France et en Europe.
Pendant des années, j’étais concentré dans mon champ que je labourais dans tous les sens. J’ai été sollicité pour des postes très prestigieux parce que l’expérience de Chaillol a conduit à ce que l’on repère mon travail. On a développé des manières de faire extrêmement qualitatives, très appréciées par les artistes, dans la manière de conduire une production, de les accompagner, de développer une écoute de leur intention profonde, de les conduire dans l’épanouissement de ce qu’ils portent. J’ai toujours refusé d’étendre le projet, de suivre l’idée que si cela fonctionne ici, cela fonctionnera ailleurs. Il y a pour moi la conviction que la qualité tient au choix de l’échelle, parce qu’on est dans un rapport de résonance humaine avec ceux avec lesquels on travaille. Mais on affine des manières de faire qui sont modélisables, et qui sont une partie des réponses recherchées dans pas mal d’endroits. C’est une forme de contradiction, je pense qu’il faut faire la promotion d’une manière de faire, mais je ne pense pas qu’il faille le faire à grande échelle. Il n’y a pas de turn over dans notre équipe, les gens sont là depuis quinze ans, ils ont construit une vie ici. Et en même temps, on ne peut pas totalement se détacher de la question de comment cela peut inspirer ailleurs. Les musiciens nous disent que ce qu’on leur offre ici n’existe pas ailleurs. Finalement, le cœur du projet, c’est la coopération. Nous n’avons pas d’équipement, donc tout ce que nous faisons est en coopération avec une commune, une paroisse, une communauté, etc. Cette co-construction permanente est un savoir-faire, avec des compétences techniques et relationnelles qui permettent de mettre en œuvre ce projet.
Depuis quelques années, quand on produit quelque chose qui a de la valeur, on essaie de le faire circuler dans d’autres territoires. Et finalement, on s’est dit qu’on pouvait peut-être coopérer au niveau de la production. On est accompagné par le ministère de la Culture depuis deux ans sur le fonds « Mieux produire, mieux diffuser », donc on a naturellement transféré à l’échelle régionale ou interrégionale ce qu’on faisait à l’échelle communale. Je pense qu’on peut articuler des échelles équivalentes au niveau européen. Je suis très lucide sur l’instabilité de la situation budgétaire en France, et sur les contraintes qui vont peser sur les acteurs. Nous devons réfléchir dès maintenant à la manière dont on peut garantir ces espaces de réalisation qui sont les nôtres. Et pour cela, je pense qu’il faut les articuler à d’autres lieux à l’échelle européenne.
Propos recueillis par Anna Cuomo et Céline Lugué