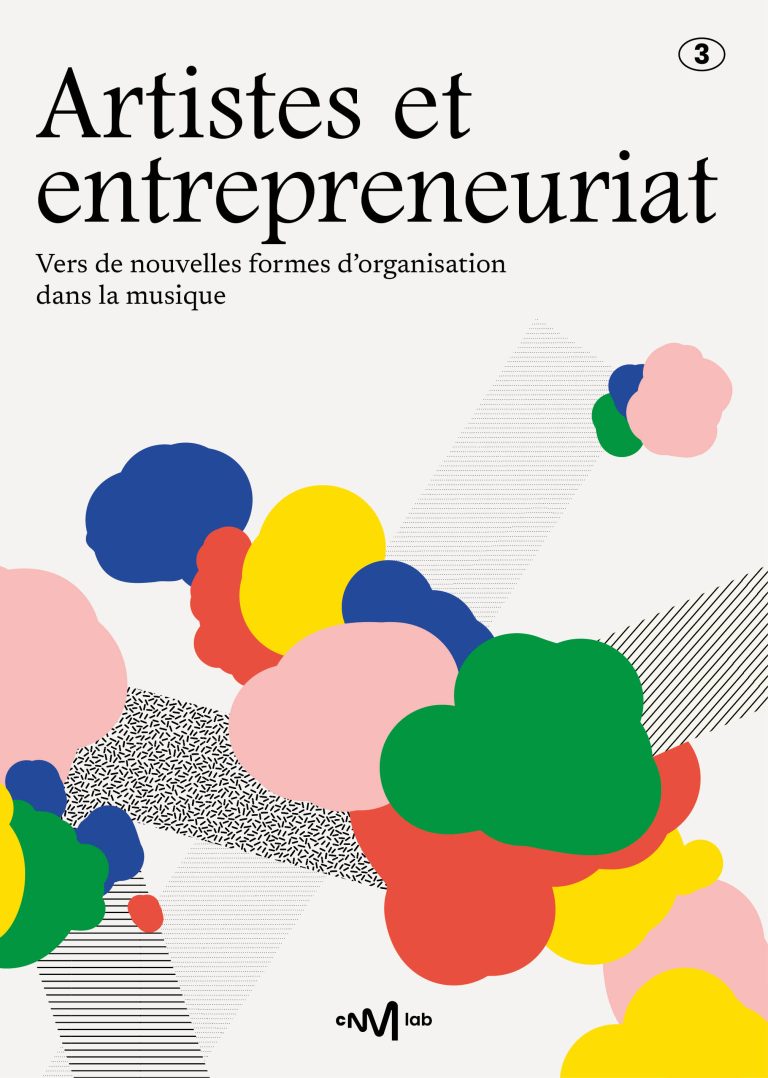A’Salfo – Entretien
Que vous évoque la notion d’artiste entrepreneur ?
L’artiste entrepreneur est une personne qui s’engage avec une vision. Souvent, la vision peut être à but lucratif, du business et c’est tout. Et puis, il y a une vision où l’on s’engage parce que l’on mène un combat. Un combat pour faire bouger les choses, pour améliorer les conditions de vie de tous ceux qui travaillent dans l’écosystème de l’entrepreneuriat culturel. Il a souvent été dit que Magic System fait de la musique commerciale parce que tout le monde danse autour. Mais le Magic System que les gens connaissent en France n’est pas le même que l’on connaît en Afrique. Magic System en Afrique, c’est le groupe qui construit des hôpitaux, des écoles et qui est engagé socialement, qui aide les gens à évoluer, aussi dans le secteur de la musique. Différent du Magic System que l’on connaît en France, auquel on assimile fête et danse.
Je m’inscris dans cette catégorie de l’artiste entrepreneur qui vient changer les choses. Je suis un artiste engagé avant même d’être un entrepreneur culturel.
À quand remontent les premiers moments de votre carrière où vous avez dû faire par vous-même ?
Cela part d’un petit truc : on est arrivés en France au début des années 2000, j’ai eu trois ans pour faire un benchmark, j’ai vu à peu près comment l’écosystème était mis en place. Ici, l’environnement est carrément opposé à l’environnement dans lequel on était. Le métier de manager n’existait pas en tant que tel en Afrique, on avait des coursiers, pas des managers.
Souvent, des promoteurs ou des festivals envoyaient des mails pour des sollicitations et attendaient des mois pour avoir un retour. La majorité des artistes africains n’avaient pas d’adresse e-mail, et certains managers mettaient deux à trois semaines avant de répondre. Là, vous vous dites que quelque chose ne va pas. Vous avez envie de prendre les initiatives vous-même parce qu’il fallait changer les choses. Tout de suite, j’ai compris que pour avoir les clés des majors, il fallait pouvoir leur parler par voie dématérialisée. C’est à partir de là que je prends conscience qu’il faut que je m’engage moi-même pour mon groupe et que j’essaie de rendre les procédures plus fluides pour Magic System.
C’est vrai que l’on était très en vogue, mais beaucoup de personnes se plaignaient à cause de notre lenteur à réagir. Dès le départ, j’ai eu cette fibre d’entrepreneur, je me suis essayé et j’ai vu que ce n’était pas aussi compliqué que cela, il fallait simplement avoir la bonne structuration et trouver des partenaires. C’est comme cela qu’en 2006, je mets en place Gaou Productions pour mener de manière transversale des activités dans le domaine que je maîtrise le mieux : la musique.
Comment s’est organisée Gaou Productions ?
Chacun avait sa spécificité, des gens contactaient la presse, d’autres organisaient nos interviews sur place, d’autres encore organisaient nos voyages. Il fallait avoir des attachés de presse, chargés de la radio, de la presse écrite, des médias en ligne, il fallait avoir quelqu’un qui signait le contrat pour le festival, quelqu’un pour gérer la logistique, les voyages, les copies de passeport, etc. Les choses se sont déroulées comme il fallait, tout le monde trouvait le groupe professionnel, tout était organisé. Il n’y a que le côté juridique qui est resté en France, on a mis en place des avocats qui s’occupaient des plus gros contrats avec les majors et vous savez, pour les termes juridiques, seuls les juristes les connaissent, je ne peux pas être mon propre avocat. Pour les droits d’auteur, dès 2001, nous avons été déclarés à la Sacem pour le monde entier, sauf l’Afrique, puisque c’est le bureau ivoirien du droit d’auteur qui est notre organisme de gestion collective sur le continent africain.
Dans ces années-là, on a quand même eu la chance d’être l’un des groupes les plus connus d’Afrique, les portes nous étaient presque ouvertes, avec des conseils et des contacts. Tout le monde voulait bosser avec nous, et c’était plus facile parce que l’on considérait déjà Magic System comme un groupe sérieux avant même que l’on se structure. Pour nous, il fallait toucher les bonnes personnes, mais aussi former certains jeunes qui n’avaient pas les prérequis pour travailler dans ce domaine du showbiz. Ces jeunes-là, on les a formés nous-mêmes. Et aujourd’hui, ce sont des patrons dans ce domaine.
Gaou Productions gérait la carrière de Magic System côté événementiel et spectacle vivant. Mais on était partagés en deux, on n’a pas tout de suite quitté les majors, EMI (qui est devenue Warner Chappell) gérait le côté artistique. On a su dissocier les deux. On travaille avec RnB Production aussi, qui est notre tour-manager depuis 2005. On a su partager les rôles. Je dis souvent que l’on avance mieux quand la vision prime sur le gain, parce que si nous avions pensé au gain, nous aurions centralisé toutes ces activités-là autour de ma seule personne. Et cela aurait pu peser lourd. On ne peut pas disposer du temps pour signer des contrats, gérer les relations avec des médias, etc., et avoir du temps pour créer, pour répéter, pour aller en spectacle, c’est lourd. Donc il a fallu déléguer, cela m’a aidé de déléguer.
Comment est structurée Gaou Productions aujourd’hui ?
Depuis plus de quinze ans, vingt-quatre personnes travaillent avec moi au sein de Gaou Productions, tous les jours. Elles gèrent l’administration financière ou juridique, le montage de projets, le management des artistes. Aujourd’hui, nous ne sommes plus liés aux majors, donc à travers Gaou Productions et Fifteen Productions, nous faisons de l’autoproduction et nous faisons aussi de l’édition. En fait, Gaou Productions est éditeur, producteur phonographique et coproducteur de nos spectacles, partout dans le monde. Dernièrement, j’ai aussi créé une structure en France, elle sera l’interface entre la musique africaine et tout l’écosystème ici en France.
Au sein de Gaou Productions, il y a le marketing opérationnel pour les entreprises, le marketing institutionnel pour le lobbying. Le lobbying, c’est quoi ? C’est pouvoir transmettre des attentes au plus haut, et encourager la prise de décision. Par exemple, des artistes trouvent que l’on est mal gérés au niveau du droit d’auteur : c’est à nous de trouver des solutions idoines à travers nos connexions.
Quel est votre rôle dans cette organisation ?
Je suis gérant. Je donne l’autonomie aux gens. J’ai la chance de jouir d’une certaine crédibilité auprès des partenaires et j’arrive à lever les fonds. Par exemple, pour notre festival au départ, nous avions besoin de quelques dizaines de milliers d’euros, et c’est avec mes droits d’auteur que nous avions fait les trois premières éditions. C’est pour cela que je parle de vision. Ce n’est pas du business, c’est de la vision. Nous voulions avoir quelque chose qui marque, quelque chose de pérenne, quelque chose qui pour moi change le cours de l’histoire. Nous voulions avoir le premier festival gratuit qui permette aux plus démunis de voir des artistes qu’ils ne rêvaient même pas de voir. Quand tu dis à un jeune que Soprano et Maître Gims vont venir chanter dans un petit ghetto, ils te disent : « C’est faux ! », et toi tu réalises leur rêve.
C’était ça mon rêve, parce que nous sommes issus de ces masses-là. Nous voulions avoir le premier festival à caractère social, gratuit. J’ai pu le mettre en place et tout financer. Puis, on a gagné en crédibilité et notre budget est passé de 55 000 euros à des centaines de milliers d’euros aujourd’hui. Et avec ça, on développe un volet social, puisque chaque année nous arrivons à construire une école Magic System pour 200 enfants avec les retombées de ce festival.
Comment travaillez-vous l’univers des plateformes et des réseaux sociaux ?
Justement, on est arrivés à un stade où l’on va bientôt avoir toutes les clés. C’est d’ailleurs pour cela que je suis venu au CNM il y a deux mois, pour me former sur le digital. C’était un enjeu très important, mais il y en a un qui est encore plus important, c’est l’identification des œuvres. Bientôt, on va créer une plateforme dédiée aux futurs albums de Magic System. On va aussi produire nos propres spectacles en Europe sans passer par des intermédiaires. Je viens de soumettre la demande pour la licence d’entrepreneur du spectacle. Voilà, on monte crescendo.
Gaou Productions s’appuie-t-elle aussi sur des subventions ?
Oui, encore aujourd’hui. Tout est une question d’approche. Si je vais voir l’Union européenne pour lui dire que je veux, à travers la musique, battre la campagne sur la protection de l’environnement ou sur la scolarisation de la jeune fille en Afrique, sur la lutte contre les violences basées sur le genre, c’est une activité culturelle, mais avec un fort message institutionnel. Donc je ne vois pas pourquoi je ne vais pas solliciter un appui institutionnel. Sur mes affiches, il y a les logos de l’Union européenne, de l’Unesco, de l’Unicef, de l’État de Côte d’Ivoire, de l’Institut français. Je ne fais pas des événements pour amuser la galerie, je fais des événements qui ont un fort impact sur les populations. Chaque édition de mon festival a un thème sur la base duquel je lève des fonds.
Comment vous êtes-vous formé à la production phonographique, au développement du live, au management ?
Vous savez, l’une des meilleures formations, c’est le terrain. Je me suis vraiment décarcassé et c’est là que j’ai compris que j’étais en train de devenir entrepreneur. Je suis né peut-être entrepreneur dans l’âme mais je ne le savais pas. Il fallait être confronté à certaines situations pour sentir l’entrepreneur enfoui en moi. J’ai compris que le management était mon truc et que l’artistique était un tremplin pour me sortir de là. Dans le management, il y a un volet humain qui est important, il faut certaines valeurs pour pouvoir gérer les hommes. Il faut faire la jonction entre les deux, le business et la valeur humaine. Pour encadrer toute une équipe, il faut être un leader, qui tire, fédère, avance avec une vision. Si tu ne comprends pas cela, cela peut être un peu compliqué de gérer 500 personnes. Aujourd’hui, on travaille avec entre 1 200 et 1 300 personnes qui ont chacune leurs prérogatives et leur mission. Je crois que l’expérience de Magic System en France a beaucoup aidé pour mon évolution dans l’entrepreneuriat culturel en Afrique. Ensuite, cela a eu un impact parce que beaucoup de promoteurs culturels en Afrique sont aujourd’hui des artistes. Les gens ont compris qu’un artiste pouvait ne pas être seulement l’acteur qui participe à un événement, mais qu’il pouvait concevoir un événement du début à la fin, et l’organiser.
L’environnement de l’esthétique musicale dans laquelle vous avez évolué a-t-il été un levier ?
La musique, c’est la musique avec un M majuscule. C’est vrai que quand tu regardes au niveau du streaming, le jazz ne va pas avoir les mêmes droits d’auteur que la musique pop ou urbaine. Mais il n’y a pas de catégorie pour être engagé. Je crois que c’est relatif par rapport à ce que chacun peut dégager comme idée, comme initiative. Que l’on fasse du jazz ou de l’urbain, quand on a envie de s’engager dans l’entrepreneuriat, on le fait ! On ne le fait pas parce que cela va marcher, on le fait pour changer les choses.
Comment avez-vous concilié le temps de la création avec celui du management, de l’événementiel, ou même des relations avec EMI ?
Pas besoin de sacrifier l’artistique. Tout est une question de planification. On sort les albums tous les deux ans, donc on a forcément une année sabbatique où l’on se pose pour essayer d’organiser un événement. Puis, j’ai délégué les rôles, et tout n’était pas autour de moi. Aujourd’hui, avec la technologie, je peux être en tournée et donner des directives par e-mail. Je n’ai pas besoin d’être à Abidjan pour assister à une réunion.
Hier, par exemple, j’ai pu faire l’une des plus grosses réunions du festival, alors que j’étais à Paris. Les réunions en présentiel ne servent plus à rien.
Pour moi, il y a un temps pour organiser le spectacle et un temps pour créer. Avec les managers, on a un calendrier commun, dans lequel les périodes sont définies, un rétroplanning est mis en place. C’est rare que l’on sorte de la feuille de route. Par exemple, pour la Coupe d’Afrique des Nations [CAN], je savais que j’avais un grand rôle à jouer puisque le volet culturel de la CAN avait été confié à Gaou Productions, il fallait mettre en place cinq fan zones et organiser la programmation artistique. J’ai dit au manager : « De septembre 2023 à mai 2024, il faut tout arrêter, pas de tournée, pas de spectacle, je vais dédier ce temps à la Coupe d’Afrique des Nations et au festival Femua qui vient juste après. » On a bloqué huit mois pour le faire. La planification est vraiment importante, on ne peut pas travailler en improvisant, sinon c’est tellement lourd…
Est-ce parfois trop lourd de faire tout ça ?
C’est même plus que lourd. Mais je ne sais pas si la passion transforme cette lourdeur-là en adrénaline. Le fait de savoir que tout le monde attend cela, il y a de l’extase.
Comment arrivez-vous à faire des choix parmi toutes les sollicitations ?
Il ne faut pas accepter tous les projets. Vous savez, tout le monde propose des projets, mais souvent, il faut prendre du recul. J’ai des collaborateurs qui analysent les propositions et font du tri avant de me dire sur quels projets il faut aller, sur quoi il faut lever le pied. J’ai une équipe qui travaille avec moi, en laquelle j’ai une confiance aveugle : il arrive même souvent que des projets arrivent à ma table et que je les signe directement.
Comment voyez-vous l’avenir des artistes ?
L’artiste de demain doit être celui qui a tout son écosystème à portée, celui qui prend une décision. Ce que je veux, c’est l’autonomie de l’artiste. On nous a trop dicté comment fonctionner, ce que l’on doit faire, ce que l’on ne doit pas faire, alors que la création devrait s’inscrire dans la continuité d’une vision. Je veux être un artiste qui, même s’il externalise, voit ce qu’il se passe. Quand j’internalise, j’ai plus de force pour organiser les choses. Donc je veux avoir un écosystème à 360° autour de moi, même s’il faut déléguer, parce que ce n’est pas moi qui vais tout faire.
Pensez-vous que les artistes des nouvelles générations, notamment sur le continent africain, sont aussi dans cette voie ?
Oui, ils sont dans cette dynamique. On ne mène pas un combat pour soi-même. La plupart de ceux qui ont mené des combats, c’est après eux que ces combats ont porté leurs fruits. Nous menons un combat pour les générations futures. Si l’on ne fait rien maintenant, cela va être toujours la même chose. Des gens vont faire des Disque de diamant ici, et nous on va faire des disques de pacotille de l’autre côté. Il n’y a pas de certifications pour les disques en Afrique, parce qu’il n’y a pas de données sur nos disques, ni aucune structure pour coordonner. Comment voulez-vous que l’on soit rémunéré si l’on n’a pas de données ? Il faut mettre tout cela en place, je le fais à mon échelle, et quand cet écosystème sera bien monté, il pourra être un modèle pour tous ceux qui se lancent dans la musique.
Que reste-t-il à mettre en place pour que l’artiste soit plus autonome ?
L’artiste d’avant était un artiste passionné. Et souvent, votre passion vous détourne des réalités. Donc, l’artiste d’aujourd’hui doit prendre conscience que c’est un métier. Les artistes doivent comprendre qu’il faut se rassembler pour être encore plus forts. Aujourd’hui, la plus grosse fortune des artistes vient du téléchargement, or on ne télécharge pas en Afrique parce que l’on n’a pas de carte bleue, c’est un luxe. Il y a tellement de réglementations à mettre en place. Mais si l’on ne se réunit pas entre nous pour sortir des projets, des propositions de lois ou de décrets qui nous aident, on ne va pas avancer.
Il faut une prise de conscience, une connaissance approfondie du métier, et une formation en continu. Aujourd’hui, la musique, c’est devenu un métier comme un autre, ce n’est pas seulement la passion de faire danser. La musique, c’est un tout. Tant que l’on n’aura pas des centres nationaux de la musique partout en Afrique, le combat sera dur. Avant, il n’y avait pas de formation pour les artistes. Même en Côte d’Ivoire, le statut d’artiste n’est reconnu que depuis deux ans.
Il manque beaucoup de choses, la connaissance même de l’écosystème par l’artiste. Mon rêve absolu, c’est de créer un centre de formation pour les métiers des arts vivants à Abidjan.
Quels conseils donnez-vous aux artistes de demain ?
J’ai envie de dire aux artistes que la vraie autonomie commence par la maîtrise de son environnement. Quand on maîtrise son écosystème, on peut en faire ce qu’on veut. Si on veut, on prend les rênes et on trouve la bonne équipe. Si on externalise tout, à un moment donné, on ne maîtrise pas son affaire. Pour moi, chaque artiste doit se dire : « Même si je ne suis pas entrepreneur dans l’âme, je peux me structurer avec des personnes compétentes que je vais manager. » L’artiste ne devrait pas s’abandonner en disant : « Prends tes 20 % et donne-moi le reste. » Il faut faire de l’entrepreneuriat, mais il faut aussi former les artistes. C’est vrai que tout le monde n’est pas né pour être entrepreneur, mais il faut aussi essayer de s’organiser, même quand on ne sait pas le faire. Je n’ai pas fait de formation au management, ou pour être un administrateur d’entreprise, rien. Ma volonté et toutes les frustrations que j’avais en moi ont créé la révolution.
L’artiste entrepreneur a plus de chances de prospérer que celui qui ne l’est pas et qui peut voir sa carrière s’arrêter. La carrière d’un artiste entrepreneur culturel ne peut pas s’arrêter. Ce n’est pas possible parce que, même si sur le plan musical il ne produit des albums que tous les cinq ans, il fait un métier qui lui permet d’être toujours dans la musique, d’être toujours utile dans un domaine, de produire d’autres artistes, de produire des spectacles, il devient même un pilier. Je connais des artistes avec qui j’ai commencé et qui ont disparu. Mais on me parle toujours de Magic System, même quand il n’y a pas d’album. À quoi est-ce dû ? Aux actions que nous menons. Nous construisons une école et nous menons des activités dont tout le monde parle toute l’année. Aujourd’hui aussi, en tant qu’entrepreneur, je monnaie mon partage d’expérience en donnant des cours dans des universités, en donnant des conférences dans des entreprises, en faisant du team building.
J’ose aussi faire d’autres choses, en ce moment je cherche comment allier le métier d’artiste à la protection de l’environnement. Je suis allé à la COP 28 à Dubaï pour essayer d’y travailler, de voir comment je pourrais donner le premier concert 100 % énergies renouvelables au monde. J’espère que cette expérimentation fonctionnera, parce qu’il est temps que l’on dise que la musique a une responsabilité sociétale et environnementale.
Nous voyageons toute l’année en avion : quand Air France m’envoie mes kilomètres de voyage, j’ai peur. On voyage beaucoup et quand on atterrit, on est encore branchés sur de l’énergie. Qu’est-ce que nous apportons à l’environnement en tant qu’artistes ? Il faudrait déjà que l’on explore comment faire nos concerts sans polluer.
Propos recueillis par Robin Charbonnier et Valentine Hassoun