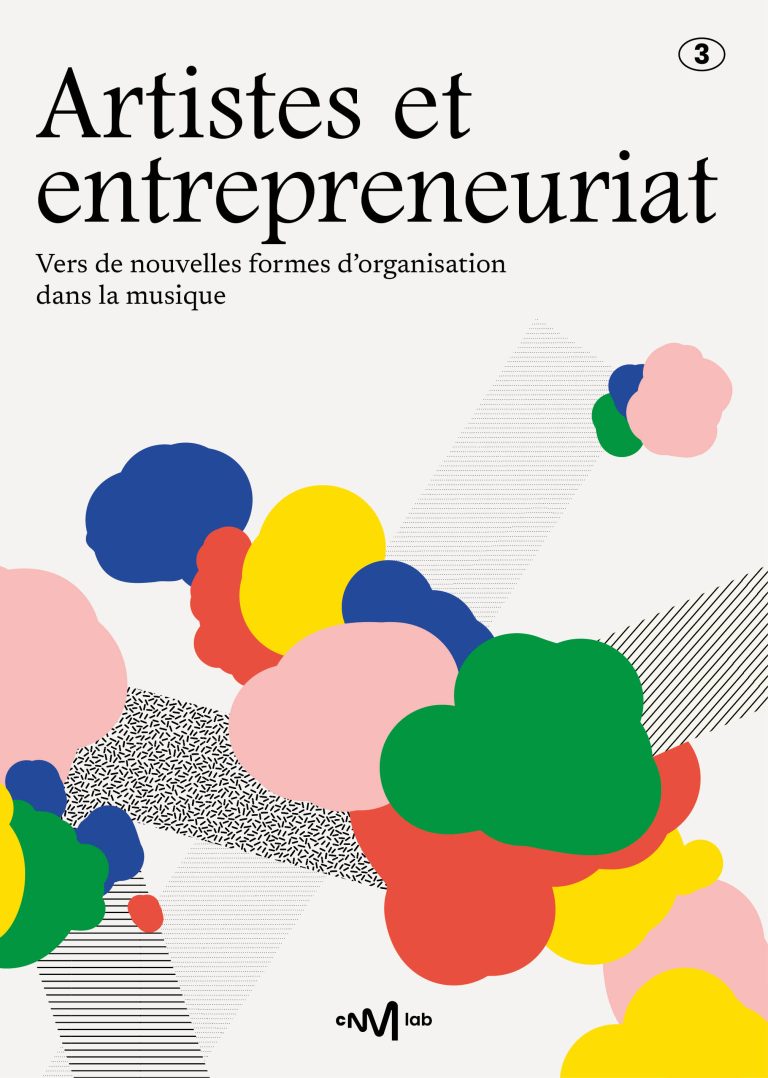Fianso – Entretien
Que vous évoque la notion d’artiste entrepreneur ?
Un artiste entrepreneur, c’est un artiste qui s’affranchit du carcan et des règles imposés par l’industrie de la musique en termes de production, d’organisation, de promotion, de vente et même de communication.
C’est quelqu’un qui a décidé de sortir du cycle du contrat d’artiste classique, des imprésarios et de l’héritage culturel des années 1980-1990, pour gérer sa musique d’une manière différente. Il y a des artistes qui ont besoin d’ouvrir le capot, de regarder comment la voiture fonctionne et qui ont des sensations différentes quand ils conduisent. Pour certains c’est une histoire de caractère, pour certains c’est maladif, pour certains c’est parce qu’ils ont été obligés de le faire.
Il y a aussi le rapport employé-patron : si en tant qu’artiste on ne supporte pas les contraintes de temporalité, les contraintes de production, les contraintes artistiques, eh bien on « saute » le boss. C’est s’affranchir de tous les intermédiaires entre soi et son public.
L’artiste entrepreneur, c’est celui qui va créer ses propres boîtes pour couvrir par lui-même des parties de production exécutive qui sont habituellement cou- vertes par la maison de disques ou par un tiers, tout en externalisant au maximum les coûts de cette production (le mixage, le pressage, etc.), de manière à être le plus indépendant possible de la maison de disques. Ma conception de l’entrepreneuriat, c’est de faire un 360 autour de l’activité artistique : prendre certains points de ce 360 et combler les manques en montant des boîtes dont on peut utiliser les services pour soi-même, pour les artistes que l’on produit, voire pour d’autres personnes à qui l’on vend ces services.
Au plus loin que vous vous souvenez, à quand remontent les premiers moments de votre carrière où vous avez dû faire par vous-même ?
Le premier souvenir, c’est à 17 ans, dans ma cité, j’écris mais personne ne veut me donner d’instrus. Donc je prends un logiciel pour faire moi-même dix instrus, et, même si je n’ai jamais mis un pied dans un studio, je trouve le moyen d’avoir le numéro de quelqu’un à Aubervilliers qui a un home studio, je m’arrange pour payer moi-même la séance de studio 100 euros et j’en- registre les dix titres le même jour. En tant qu’artiste, la première contrainte que j’ai dû prendre à bras-le-corps, c’est ça : devoir me débrouiller tout seul pour avoir mon propre matériel et m’enregistrer.
Mais, en réalité, on était trois, trois frères historiques, on s’appelait Les Affranchis, on avait 11 ans, on faisait du rap à Blanc-Mesnil, à Aulnay-sous-Bois, à Sevran. Je deviens le rappeur, un autre va faire des prods et un autre devient un peu plus manager, on essaye de com- prendre le futur. Moi, je m’accroche plus au rap qu’eux, les aléas de la vie font que l’on se sépare un peu à un moment, parce que chacun a des envies différentes.
Puis, j’ai eu des enfants jeunes, il fallait manger, il a fallu vivre de la musique avant que ma musique paie. Du coup, j’ai monté des studios, je me suis mis à récupérer des compositeurs, j’ai commencé à essayer de placer des prods, etc. Je rappelle mes deux copains pour que l’on monte ensemble des studios à Ivry, à Boulogne, un peu partout. En réalité, ma première tentative d’entre- preneur, ça a été de vouloir créer la première franchise de studios en France, de faire une configuration type et de vendre des studios clés en main, comme un Food Corner, un O’Tacos ou un McDonald’s. Mais je n’ai pas réussi, cela demeure un rêve inassouvi. En revanche, l’amitié est restée, une amitié de 30 ans, et aujourd’hui on est Affranchis musique.
Par la suite, comment êtes-vous devenu producteur ?
J’ai longtemps essayé de trouver un moyen de vivre de la musique, en attendant que le nom Sofiane vaille quelque chose et me fasse vivre. Et dans ce parcours du combattant pour me faire connaître, j’ai joué à tous les postes, sauf celui d’ingénieur du son. Et je suis tombé amoureux de la fabrication. Aujourd’hui, je préfère presque mes actes de producteur à mes actes d’artistes, parce que c’est parfois plus gratifiant et il y a moins d’enjeux.
En tant qu’artiste producteur, le premier défi a été de défendre la musique d’autres personnes et de les protéger d’elles-mêmes, de leur public et de l’industrie. Il y a ce fameux contrat qui a fait son arrivée il y a quelques années, le contrat de distribution, qui est un peu devenu le contrat chouchou des artistes parce qu’ils ont l’impression de récupérer un max de thunes. La vérité, c’est que si on ne sait pas constituer une équipe autour de soi, si on n’est entouré que de ses potes, cela peut mal finir. Il faut savoir séparer les choses, il faut savoir confier sa carrière à quelqu’un pour pouvoir consacrer son temps à une autre carrière, j’ai dissocié Sofiane l’artiste de Sofiane le producteur et de Sofiane l’éditeur.
Un gamin qui devient une star, il va passer par des ascenseurs émotionnels extraordinaires, il va se retrouver à faire des placements de produits louches pour un gel aphrodisiaque ou un stylo, ou pire, il va perdre ses amis, il aura des conflits dans sa famille. Avec un comptable, un fiscaliste un peu sérieux, un manager, un avocat d’affaires intelligent, cela permet d’optimiser et de multiplier les sources de revenus. La vérité, c’est que 90 % des artistes (et pas que dans l’urbain) ne connaissent ni leur taux de revenu digital, ni leur taux de royautés physiques, ni leur taux sur YouTube, ni les avances, ni les dividendes. Je ne les blâme pas : c’est déjà tellement dur d’en arriver là. Mais l’enjeu, en particulier pour les organismes comme le CNM, la Sacem ou la SPPF, c’est de former les gosses. En particulier, la formation fiscale doit faire partie de la formation des artistes. Il y a une non-communication au niveau des droits et des devoirs des artistes.
Comment vous êtes-vous emparé de ces sujets alors que 90 % des artistes ne le font pas ? D’où vient cet intérêt pour la création d’entreprise et la maîtrise de votre environnement ?
Je ne m’amuse pas vraiment quand je ne comprends pas les règles du jeu. Gagner la Ligue des champions par accident, cela ne m’intéresse pas, j’ai besoin de comprendre. En plus, si on ne comprend pas ce jeu, on fait la part belle à l’industrie, aux maisons de disques, aux organismes de collecte, aux organismes privés et publics, qui ne sont pas des ennemis, mais qui sont en plein déni de responsabilité – à l’image des Victoires de la musique qui tirent ce fameux tiroir de « l’urbain », le tiroir dans lequel on met les Noirs et les Arabes.
On est dans un contexte de racisme social ambiant, de mépris sociétal, de fossés communautaires, religieux, sociaux, qui se creusent dans la société. Et au lieu de nous rassembler, la musique nous a divisés. Au début des années 2000, voir 113 Clan arriver en 504 break chanter « Tonton du bled » sur la scène des Victoires de la musique, ou voir IAM chanter « Independenza » avec des drapeaux marseillais, cela me faisait rêver.
Est-ce que ce fossé culturel, notamment les discriminations ethnoraciales présentes dans la musique, est un moteur pour faire par soi-même et être entrepreneur ?
Évidemment ! À la base, on fait tout cela parce que l’on n’a pas le choix. On voulait juste chanter des chansons, être des stars et monter sur des scènes. On n’avait pas envie de se prendre la tête avec des comptables ou avec des clients. On a été obligés de le faire. J’en veux pour preuve que les deux gros mouvements indépendants de la musique en France sont l’electro et le rap, soit ceux qui possèdent le moins de canaux de diffusion en termes de radio, qui ont le moins de presse et qui sont le moins représentés dans les organismes de collecte et de subventions.
Toute ma vie, j’ai travaillé avec des gens qui ne sont pas de ma condition sociale, et ce qui fait très mal, c’est la condescendance. Au début, c’était la théorie du chien qui parle. C’est impressionnant un chien qui parle.
J’allais dans les médias et j’arrivais à aligner de jolies phrases avec des mots de trois syllabes et des théories à peu près concrètes et intelligibles sur lesquelles on pouvait débattre. J’ai joué le jeu pendant quelques années même si je n’avais ni les codes ni le cursus scolaire.
Au début j’ai presque cru que l’on allait être fier de moi, parce que je revenais des ténèbres. Je viens de Seine– Saint-Denis, j’enterre des amis depuis que j’ai 16 ans, la guerre on sait ce que c’est. Le but n’est pas d’appartenir au monde des autres, c’est d’être considéré.
Mais attention, je ne méprise pas l’industrie, et les labels ne sont pas mes ennemis. L’industrie ne dit pas tout aux artistes, mais les artistes ne posent pas toutes les questions non plus. Le but de certains, c’est de fumer des chichas et qu’on les laisse tranquilles. Mais quand ils se rendront compte à 45 ans qu’ils n’ont aucune propriété intellectuelle, qu’ils n’ont pas capitalisé, ça va piquer. Pourtant, on est dans le pays de la propriété intellectuelle ! La propriété intellectuelle, c’est ton fonds de commerce, et quand tu achètes un fonds de commerce, il y a une clientèle, une adresse. Aujourd’hui, dans le rap comme dans l’electro d’ail- leurs, une carrière ce n’est plus vingt ans : un artiste qui dépasse les cinq ans, c’est déjà énorme, donc il faut capitaliser, bien investir son argent.
Quel est l’entourage d’un artiste entrepreneur dans le rap ?
Avocat, comptable, fiscaliste et/ou apporteur d’affaires, avocat d’affaires pour les investissements, cabinet administratif pour les subventions et la surveillance des catalogues. Pour la partie administrative, j’ai la chance d’avoir un associé qui s’en est plus ou moins chargé. Par ailleurs, on fait gérer une partie du catalogue éditorial par Because, on fait tracker une partie de ce catalogue par un indépendant, on fait monter les dossiers de subvention par des cabinets (indépendants eux aussi), il arrive que l’on s’adosse à des responsables juridiques de maisons de disques, par exemple dans le cadre d’une licence « label deal » avec Universal pendant trois ans. Je me sers de cette compétence juridique uniquement quand j’en ai besoin. Mais c’est vrai que le juridique est un des seuls aspects de la maison de disques qui est encore utile pour les indépendants, et encore : énormément de cabinets se sont maintenant développés dans ce sens. Pour la négociation des contrats avec les majors ou autres, on fait appel à des avocats d’affaires. Ils ne sont pas nombreux, donc l’important c’est de tourner, parce qu’ils s’arrangent avec les personnes avec qui tu négocies et avec qui ils font plein d’autres deals.
Le reste de l’entourage, ce sont ceux qui fabriquent : les ingénieurs du son, les clippers. Ce n’est pas plus dur que ça. On a beau se raconter ce que l’on veut, la musique c’est trois personnes autour d’une table, il y en a une qui fait une chanson, une qui fait des images et une qui met en vente. C’est tout, il n’y a pas de tour de magie. Moi, j’aime ce truc de fabriquer, l’humilité que cela impose : à partir de rien tu dois fabriquer un objet et en faire quelque chose.
Vous parlez essentiellement de production phonographique, quel est votre point de vue sur le live ?
Le live est un des derniers si ce n’est le dernier pan de production ou de fabrication qui n’a pas été réformé par un nouveau système. Au début des années 2000, faire un clip coûtait 100 000 euros, aujourd’hui cela coûte 500 euros. Les outils pour fabriquer et communiquer sont accessibles, ça s’est démocratisé. Pour un album qui coûtait 500 000 euros au début des années 2000, aujourd’hui si on dépasse les 50 000 euros, ce n’est pas bon. Le live est le seul domaine qui n’est pas encore réformé dans le sens où le matériel n’a pas encore été réformé. On ne fait pas Bercy avec des LED, ce n’est pas vrai. Même chose avec les techniciens qui ont été formés sur ces machines, le live c’est le pan de production dans lequel se trouvent généralement les mecs les plus âgés et les plus aguerris.
En plus, le live n’a pas de confession : un tourneur peut faire tourner un rockeur, un rappeur, un mec de l’electro dans la même semaine sans que cela pose de problème. Pour un label, c’est beaucoup plus compliqué. Un live, c’est beaucoup plus 360, parce qu’il s’adresse à tout le monde.
En revanche, c’est très compliqué de faire de l’argent avec le live parce que c’est très coûteux, et requiert des frais incompressibles (coûts du plateau, frais d’assurance, de production, etc.) qu’il est difficile de rationaliser pour une tournée complète. Monter un studio coûte 5 000 euros, faire un clip coûte 2 000 euros, monter un concert ne coûte pas 2 000 euros.
Heureusement que les festivals existent pour équilibrer les économies de tournées, mais même ainsi, énormément de tournées sont annulées. Il y a des artistes qui sont Disque de platine et qui ne rem- plissent pas La Cigale. À l’inverse, il y a des artistes qui vendent 5 000 albums et qui remplissent Bercy. On ne peut pas bricoler avec le live, c’est une expertise plus fastidieuse à emmagasiner que le reste.
Et, dernière chose, le live a une particularité que les autres pans de fabrication et d’exploitation n’ont pas : il accueille du public, ce qui entraîne des responsabilités complètement différentes. Dans le live, on ne réalise pas le rêve de l’artiste, on réalise le rêve des gens qui viennent voir l’artiste. Or, il faut sécuriser tous ces gens, que tout soit aux normes. Et quand tu as les traumas sécuritaires qu’ont connus les lieux de spectacles lors des dernières années, je préfère parler à un professionnel qui connaît son boulot. Accueillir cinq mecs dans un studio c’est quelque chose, accueillir 5 000 per- sonnes dans une salle c’en est une autre. Accueillir du public et en avoir la responsabilité, c’est un métier. Et je ne maîtrise pas ce métier.
La distribution n’est-elle pas un autre pan d’activité qui échappe à l’artiste entrepreneur ?
La distribution, c’est un super enjeu. À l’époque, il fallait déjà comprendre ce qu’était la SDRM [Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique]. Peu d’artistes aujourd’hui savent ce que c’est, pourtant ils paient la taxe. Aujourd’hui, la distribution est majoritairement digitale, on a tous les outils à disposition pour mettre notre musique en ligne en évitant une déperdition des royautés.
Il y a quelque chose que l’on ne fait pas, parce que les gens ne sont pas malins, c’est la distribution ciblée. La Fnac n’est pas mon ennemie, mais le monopole de la centrale Fnac, l’enjeu des têtes de gondole et des mises en avant en magasin, je connais très bien. La distribution ciblée, c’est aller vers des centres d’intérêt différents. Les plateformes commencent un peu à le faire (les playlists pour faire du sport, etc.). Par exemple, si demain tu prends un artiste, tu t’intéresses à la cible, c’est-à-dire à l’auditeur lambda de cet artiste : il faut savoir où il mange, comment il s’habille, pour prévoir par exemple des systèmes de dépôt-vente dans les commerces qu’il fréquente. Les centrales de préachat, c’est un pan commercial important de la maison de disques, qui rentre en compte dans les chiffres de vente de la première semaine. Au niveau du digital, tous les outils existent déjà.
Quels sont les avantages et les difficultés de diriger des entreprises et des gens ?
Ce sont les mêmes difficultés qu’un patron de restaurant : il arrive avant les autres, il part après les autres. Tous les jours, tu peux tout perdre, il y a des enjeux à tous les niveaux. L’avantage, c’est que personne ne peut t’imposer d’arriver à une certaine heure, te gronder ou te parler bizarrement. J’ai une activité, je crée du flux, ça rentre, ça sort, et donc cela m’apporte aussi le fait de pouvoir capitaliser, valoriser mes boîtes et mes catalogues, dans un contexte où les fonds rachètent les cata- logues et les indépendants.
Les artistes doivent faire un pas vers l’industrie, l’industrie doit faire un pas vers les artistes, mais surtout les organismes d’État et l’argent public doivent bouger.
Je siège à la commission d’avance sur recettes du CNC et quand je donne l’avance sur recette à un film, c’est l’argent de nos impôts, c’est l’argent de tout le monde. Et ça, les artistes ne le savent pas. Le rappeur, en règle générale, voit tout le monde comme son ennemi : l’industrie, l’école, la police. Parce qu’il y a ce conditionnement banlieusard, ce conditionnement qui consiste à penser « ils vont nous voler, ce sont des menteurs, ils nous prennent pour des idiots », et il y a la condescendance générale de l’industrie, et notamment des bien nés (et je ne les méprise pas). Le défi, c’est qu’il faut s’adapter à toutes les strates de la population, car dans le business on croise des gens différents.
Le problème, c’est que l’artiste aura rarement une carrière qui ira jusqu’à prendre conscience de tout ça. En cinq ans, il n’a pas le temps de comprendre les ficelles de l’industrie. À la base, il n’est pas venu pour cela, mais maintenant, on exige de lui autre chose. Si tu n’apprends pas, si tu ne comprends pas, si tu n’entoures pas, tu n’y arriveras pas. Des rappeurs comme PNL ont externalisé leurs éditions depuis la première heure, ils ont des trackers partout, ils sont forts. S’ils ont envie de vous faire croire qu’ils fument toute la journée, libre à vous de les croire. Et si Jul a envie de vous faire croire qu’il marche en claquettes et en chaussettes alors qu’il est multimillionnaire, très bien, croyez-le. Aujourd’hui, le modèle indé, c’est celui qui rendra le plus de justice. L’indépendance, c’est la justice. Et comme dans tout domaine, il y a des frais.
Cela vous arrive-t-il de craquer ?
Toutes les 48 heures. Mais j’ai un socle familial fantastique, et une trentaine, voire une quarantaine, de personnes qui attendent de savoir s’ils vont pouvoir payer leur loyer et remplir le frigo à la fin du mois. Cette responsabilité-là, je l’ai à cœur. Je ne joue pas avec la vie des gens, c’est la raison pour laquelle je n’ai pas signé d’artiste depuis trois ans, alors que j’ai des demandes tous les jours.
Est-ce qu’il vous reste du temps pour créer ?
Évidemment, c’est ma vie. Il y a un principe très simple : si tu ne respectes pas la punchline quand elle arrive, elle ne te respecte pas quand tu la cherches. Oui, j’écris des bribes, des idées, des bouts, des morceaux, des « un mot ». J’ai plus de chansons qui ne sortiront jamais que de chansons qui sont sorties. Je ne suis pas un rappeur, je suis un artiste. Je ne suis pas un chanteur, je suis un artiste. Cela me suit dans mon lit, me réveille, guide ma vie. Cette sensibilité d’artiste détermine presque 100 % de ma vie. Je suis un artiste et ce n’est pas snob de le dire. Je créerai toute ma vie, j’écris depuis que j’ai huit ans, c’est ma meilleure manière de communiquer jusqu’à aujourd’hui. Dans nos familles, il y a beaucoup de pudeur, on ne va pas se dire de « Je t’aime maman », mais quelquefois on se l’écrit. L’écriture, c’est le meilleur véhicule pour faire passer mes sentiments et mes émotions.
Quel est l’avenir selon vous ? Pensez-vous que les gens comme vous, qui prennent tout en main et comprennent les règles du jeu, demeureront une exception ? Les maisons de disques vont-elles rester à leur place parce qu’il n’y a personne pour ouvrir le capot ?
Évidemment. Et je ne suis pas Iznogoud, gardez la place du calife, grand bien vous fasse. J’ai beaucoup de respect pour les carriéristes en maisons de disques, qui partent du bas et qui montent l’échelle, mais moi ce modèle-là, où il faut faire la petite réunion du mardi, je ne pourrais pas. Nous, les indépendants, notre dénominateur commun c’est l’instinct de survie. C’est-à-dire qu’à un moment, on s’est organisés parce que l’on n’a pas eu le choix. Et par la suite cela peut être bénéfique, et on peut dire à tout le monde que l’on a été malin, mais la vérité c’est qu’au départ, on n’a pas le choix, on est au pied du mur.
Le truc le plus intelligent que le rap pourrait faire ce serait de créer et d’organiser le premier groupe média urbain et récupérer des canaux de communication. Ne serait-ce que pour qu’existe une antithèse des médias existants et de leur ligne éditoriale. Mais attention, avoir une influence comme celle des grands groupes médias, peser sur l’opinion, faire se rassembler des gens à un endroit, leur faire acheter un produit, c’est une énorme responsabilité.
Dans la musique, il y a des règles du jeu, et il faut former les gens à ces règles. Il faut que la Sacem et le CNM travaillent ensemble et s’inscrivent dans le début des carrières des artistes, développent des formations, des guides pratiques, des annuaires. Il faut créer un maximum d’entreprises dans le modèle 360 autour de l’artiste. Il y a tellement de choses à faire !
Propos recueillis par Robin Charbonnier et Céline Lugué