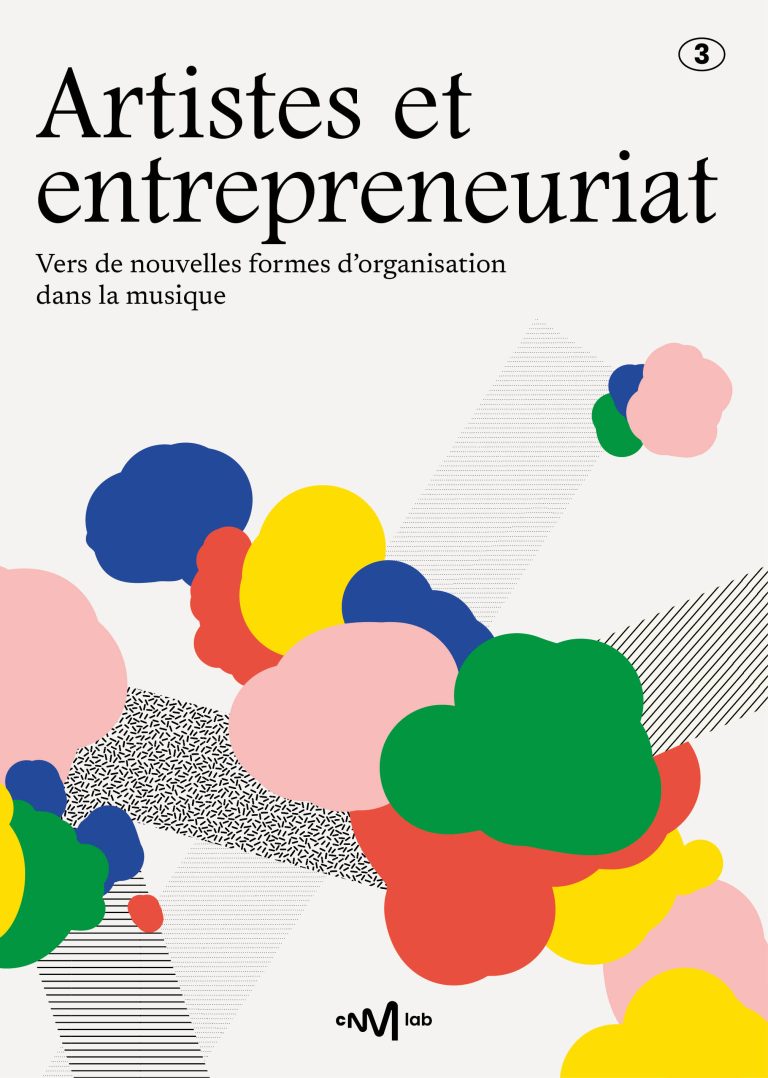Zaho de Sagazan et Lucie Guilloux – Entretien
Que vous évoque la notion d’artiste entrepreneur ?
Z : Cela m’évoque un mot, la liberté. Je trouve que c’est fondamental pour faire de l’art d’être libre, de faire ce que l’on veut, avec qui on veut, quand on veut et pour les raisons qu’on trouve bonnes. C’est faire sans concession, sans avoir une major au-dessus qui nous explique comment on fait de l’art et pourquoi on le fait. C’est reprendre le cœur du projet. J’ai été élevée par un père artiste peintre, qui a toujours fait seul et sans concession, parce que les peintres sont souvent des autoentrepreneurs. C’est le seul exemple d’artiste que j’avais dans ma vie, un artiste complète- ment libre. J’ai toujours vu mon père gagner que dalle et pourtant continuer à le faire, parce qu’il avait la chance d’avoir une femme qui lui disait : « On mangera des lentilles et on gagnera mon salaire de prof, et cela sera suffisant. » Ma famille en général a comme mantra la liberté et l’originalité. Un autre exemple en est ma sœur, qui est danseuse et chorégraphe, qui a monté son collectif, qui fait tout et qui est la boss ultime de sa vie. Pour moi, c’était cela faire de l’art. Le propre de l’art, c’est de faire de l’art pour l’art, pas pour d’autres raisons. Je pense qu’il y a de très bons labels qui font cela très bien, mais chez les majors j’ai quand même souvent l’impression que l’idée, à la fin, c’est de faire du fric, faire de la radio, de la synchro, du marketing, vendre quoi. Et même si ces choses-là font partie du truc, ce ne sont pas forcément les plus belles choses qui font du fric. L’art, c’est surtout une vérité qu’on a au fond du cœur, qui ne doit pas être manipulée par une envie de faire du fric.
Les premiers contacts avec l’industrie musicale vous ont-ils fait sentir qu’il y avait un discours tourné vers l’appât du gain ?
L : On s’est figuré ces discours avant même de toucher à ce monde : il y avait ce qu’on avait observé de l’extérieur, des bruits de couloir, des rumeurs, des histoires de projets qui avaient été un peu modelés, à qui on avait dit de faire des choses et interdit d’en faire d’autres. Cette logique de recherche du profit avant tout, c’était un truc que l’on sentait de loin. Ce n’était pas trop notre délire, on avait envie de mettre l’artistique avant tout. Quand on a fait le tour de la place de Paris, quand on a fait nos premières rencontres, c’était intéressant de voir les différentes approches : il y a des rendez-vous dans lesquels on n’a pas du tout parlé de musique. Pour nous, c’était rédhibitoire. Quand tu sors d’un rendez-vous pour potentiellement signer un artiste et ne pas avoir évoqué une seconde la question des chansons et de la musique, c’est lunaire. On ne savait pas exactement comment on allait faire parce qu’on ne l’avait jamais fait, mais on sentait que c’était à nous de le faire, parce qu’on était les mieux placées pour le faire.
Z : J’ai l’impression qu’avant même d’aller les voir, on savait déjà que c’était à nous de le faire. Quand Lucie est arrivée dans ma vie, non plus seulement en tant que copine, mais pour m’aider à faire de la musique ma vie, elle avait déjà monté une boîte. Au début, il faut bien l’admettre, la barrière de l’indépendance fait peur. Je n’aurais jamais monté une boîte toute seule. Sans Lucie, je n’aurais jamais pu faire ce que je fais, et quand je parle de ma liberté d’artiste, je sais que je n’aurais jamais pu l’avoir toute seule. C’est parce que Lucie m’a dit : « Je vais rendre cela possible, on va y arriver », qu’on est arrivées main dans la main à ces rendez-vous en se disant : « Toi, tu ne vas pas nous la faire à l’envers. »
L : Forcément, nous n’étions pas prises au sérieux, deux filles de 22 ans, qui n’avaient à peu près jamais rien fait et qui venaient en disant « On va monter notre label, on va tout gérer toutes seules, bien sûr que l’on va y arriver, on en est sûres », tout le monde nous demandait si on se rendait bien compte. Et on répondait : « Oui, oui », alors qu’on ne se rendait compte de rien, on ne savait pas encore vraiment ce qu’était l’intermittence ou un éditeur. Certaines personnes nous ont accueillies de manière bienveillante, parce qu’elles ont cru dans le projet et en notre association, d’autres nous ont accueil- lies avec un peu de condescendance – et, avec du recul, on est contentes de les avoir fait mentir. Nous étions pleines de conviction et de certitudes. J’ai connu Zaho quand j’avais 18 ans, elle en avait 15, je l’ai vue, j’ai tout de suite vu une star. Je n’ai jamais eu une aussi grande conviction de toute ma vie, un coup de foudre instantané, je n’avais aucune inquiétude. Comme j’avais un peu expérimenté le business de la musique (quand je faisais de la com avec des labels, des éditeurs, des managers, des tourneurs, plein de petites structures), je commençais à capter comment cela marchait. Et ce mélange de « voir comment ça marche » et « voir ce qu’elle est » m’a fait comprendre que j’avais les clés : j’étais capable de monter une boîte et développer un projet. La suite logique de ces trois éléments mélangés (qui elle est, qui je suis, et ce que j’ai vu), c’était de monter le label. On s’est dit très vite qu’on allait s’associer toutes les deux et travailler avec les meilleurs.
Z : Tu avais aussi un très fort sentiment de protection, tu avais peur qu’on « casse ce petit diamant ». Tu me disais que je ne pourrais faire confiance qu’à moi-même parce que je savais que moi, mes intentions étaient bonnes, et que je ne pourrais jamais être sûre des intentions des autres, même pas des tiennes ! Le seul moyen de me protéger au maximum, c’était de le faire moi, et d’être au cœur de toutes les décisions.
Pourquoi avez-vous commencé par créer un label ?
L : On a monté le label Disparate pendant que le live était en train de se monter. On savait qu’un jour il y aurait un album. Or, on voulait être propriétaires des œuvres, des masters, et posséder le pouvoir de décision.
Z : Le label, c’est celui qui décide car c’est lui qui donne l’argent et qui investit. Il détient la décision. Par exemple, il peut dire « Cette pochette, cela ne va pas du tout, je pense qu’il vaut mieux mettre ton visage en gros » ou « Cette chanson, elle ne passera pas en radio ». Je suis sûre que si j’avais été dans un label ou une major, on m’aurait par exemple dit de ne pas commencer l’album par « La Fontaine de sang », alors que j’étais persuadée qu’il fallait commencer par ce morceau.
L : Il y avait aussi le souhait de travailler dans la durée. On ne cherchait pas des partenaires pour un seul album, on voulait se structurer pour développer la carrière de Zaho tout au long de sa vie. On voulait posséder les titres, le pouvoir de décision, l’argent, les équipes, le timing, pour pouvoir écrire une histoire dans la durée. Cela nous semblait nécessaire d’être maîtres à bord.
Z : La première fois que j’ai parlé avec des labels, ils n’avaient pas cette vision de carrière. Ils pensaient pour cinq ans, alors que je pensais pour quarante ans. Posséder les choses, c’est décider de ce que l’on fait et avec qui on le fait. C’est hyper important : je ne travaille qu’avec mes potes. Quand j’avais 18 ans, on était déjà trois à bosser mon projet sur un coin de table dans un bar, maintenant on est seize sur cette table. L’important, c’est de pouvoir décider ce que tu fais, avec qui, quand et pourquoi.
L : Une autre différence avec les maisons de disques, c’est que l’on n’a pas d’autre projet. Notre projet n’est pas une priorité deux ou trois dans la liste des sujets que la ou le chef de projet doit gérer. On n’a pas de turnover, on n’est pas soumises à des résultats qui font que la personne bosse ou non pour notre projet. On n’a pas la contrainte de devoir travailler avec des gens salariés de sociétés qui dépendent d’objectifs plus grands que notre projet. On travaille avec des gens à qui on donne les moyens de travailler, de prendre le temps de travailler correctement, d’être payés à la hauteur de leur engagement, des gens que l’on a choisis et qui ont choisi de travailler ce projet parce qu’ils en ont envie.
Est-ce que le fait de monter ce label à deux, c’était aussi parce que d’autres vous ont inspirées ?
Z : Il y avait des exemples, oui, comme Billie Eilish. Mais on ne le voyait pas tellement, même dans nos rendez-vous, on nous donnait un peu l’impression que cela n’existait pas des masses. Le seul endroit où on le voyait, c’était dans le rap. Quand on donnait ces exemples, on nous disait : « Attention, l’économie d’un rappeur c’est complètement différent, il y a énormément de streams, et c’est ce qui procure énormément d’argent, ton genre de chanson n’a rien à voir ». Peu de personnes étaient persuadées qu’on allait toucher autant de gens, tout le monde nous décourageait en nous disant qu’on était l’inverse des rappeurs.
L : En France, on n’est pas un pays d’entrepreneurs à la base. Mais monter une boîte c’est très simple, un avocat, un expert-comptable et basta. C’est après que ça se com- plique : il faut gérer, développer, structurer, faire de l’administratif, etc. Le choix de cette structuration-là, c’est à la portée de tout le monde. Mais ce qui n’est pas à la portée de tout le monde, c’est de prendre les bonnes décisions, de réussir à s’entourer correctement. On ne parle que de nous deux depuis tout à l’heure, mais on a quand même reçu beaucoup d’aide au début, notamment de notre coéditeur Matthieu Tessier chez Warner Chapell.
Z : Il a été le premier à entendre notre envie, à croire dans ce modèle-là. Probablement parce qu’il avait déjà signé Angèle ou Orelsan, qui avaient aussi fait comme ça. Mais je pense qu’il a senti une gnaque chez nous, il a compris que ce n’était pas négociable, là où plein d’autres ont essayé jusqu’au bout de nous montrer comment cela pourrait être génial si on faisait comme ci ou comme ça. On a signé un contrat de coédition, ce qui nous a permis d’avoir des avances, et il nous a aidé à trouver des gens pour entrer dans notre boîte. Effectivement, on voulait tout faire toutes seules, mais on connaissait peu de gens dans le milieu. Il nous a guidées pour ne pas faire trop d’erreurs. Il nous a présenté un super attaché de presse, Florian Leroy, puis il nous a montré plusieurs tourneurs. Après pas mal de rendez-vous, on a rencontré Joran Le Corre de Wart, qui a complètement cette philosophie-là, un vrai indé. On n’a parlé que de musique et de choses concrètes. Il était plein d’humilité, il n’était pas là pour nous draguer, on sentait un vrai cœur.
Comment vous répartissez-vous les rôles toutes les deux par rapport à votre label ?
Z : C’est assez simple, je m’occupe principalement de la musique. Mais la stratégie, on la fait à deux avec Lucie, c’est là où on se rejoint vraiment. Je ne m’occupe pas du tout de la gestion de la comptabilité par exemple, je fais entièrement confiance à Lucie. Et je ne lis pas les mails, c’est Lucie qui reçoit tous mes mails. Cela fait partie des choses qui me permettent d’être plus sur l’artistique. On s’équilibre bien.
L : On est toutes les deux associées du label. Zaho est associée majoritaire et moi je suis associée, gérante et présidente. C’est difficile d’être mandataire social quand on est intermittent, et je ne le suis pas. On a aussi recruté pas mal de freelances, que Matthieu Tessier nous a présentés, à des moments où l’on avait des besoins. Lola Serres, notre cheffe de projet, a une place très importante pour la gestion des choix quotidiens dans le label et pour la stratégie, que l’on élabore avec elle. Elle a passé quinze ans chez Universal, et c’est très précieux d’avoir quelqu’un qui a été dans une major : cela nous fait prendre des raccourcis sur plein de sujets que l’on ne maîtrise pas (la promotion, le marketing, la négociation), et cela nous donne aussi beaucoup de pouvoir, on ne peut plus nous arnaquer. Olivia Barbier, notre business affair, est vraiment sur la partie administration comptable. Elle a une formation de juriste, travaille beaucoup avec des rappeurs. Elle est brillante elle aussi, et a beaucoup d’expérience. En fait, on travaille plutôt avec des profils seniors, trois femmes qui ont leur expérience, leurs réflexes, leur efficacité. Voilà, ces deux personnes, c’est le bras armé de Disparate au quotidien, auprès de nos partenaires, auprès des nombreuses sollicitations que l’on peut avoir, et c’est super plaisant de créer une équipe avec des profils vraiment experts, qui ont de l’expérience et qui nous en font profiter.
Z : Clairement sans elles, on ne serait pas bien, il faut aussi avoir l’humilité de savoir que l’on a besoin des autres. Et elles travaillent en freelance, parce qu’elles en ont marre de se faire imposer leur cadre de travail, elles croient en leur talent et veulent avoir des projets qu’elles aiment.
L : On travaille toutes à distance : on n’a pas de locaux, chacun travaille chez soi car tout le monde avait déjà ce modèle-là avant, et cela marche très bien. Mais cela implique de beaucoup échanger, on a beaucoup de groupes WhatsApp avec beaucoup de sujets, on passe notre vie au téléphone. C’est forcément une aventure collective, parce qu’il y a trop de travail et parce que le choix de l’indépendance, c’est de ne pas faire partie d’un label dans lequel les salariés changent de projet en cas de changement d’échelle. Nous, on a des changements d’échelle assez rapides dans le projet, que ce soit sur les rythmes de vente, le nombre de concerts, les sollicitations médias, mais on ne double pas pour autant notre équipe toutes les semaines. On a besoin d’être en place, d’être organisées, de trouver des méthodes, des outils, un rythme pour réussir à bien collaborer et à stabiliser notre croissance ;
Zaho, vous vous occupez de la création, de la stratégie, des réseaux sociaux : comment arrivez-vous à gérer tout cela ?
Z : Je dors peu et je n’ai pas de week-end. Dans l’équipe, tout le monde travaille beaucoup. De mon côté, il y a le label, mais aussi plein d’autres gens dans l’artistique. Effectivement, cela fait plein de sujets et on s’occupe de tout, mais c’est aussi ça qui est excitant. C’est pour cela que j’aime l’idée d’avoir monté ce label, je ne suis pas juste une potiche qui chante et qui écrit des chansons, je décide de tout : les clips, le design des T-shirts avec mon meilleur pote, le contenu pour les réseaux, les lives, etc. Il y a tout le temps mille sujets. Mais j’adore travailler donc ce n’est pas grave. Au contraire, cela t’implique, c’est ce qui est marrant justement. Une semaine de vacances, cela ne ferait pas de mal, mais je suis entourée de gens qui donnent leur âme pour mon projet, donc je peux donner au moins deux fois mon âme. Je suis très stimulée par mon équipe, que ce soit du côté du label ou du côté artistique : tout le monde bosse comme des tarés.
N’avez-vous pas peur que la charge de travail devienne trop lourde pour chacune de vous ?
Z : Si, parfois on s’appelle et on se dit qu’on est crevées. L’année dernière, on a fait des erreurs là-dessus, mais j’ai déjà l’impression qu’on grandit beaucoup et qu’on apprend tout sur le tas. En l’occurrence, l’année dernière, on avait 115 dates de programmées, un jour sur trois, voire deux jours sur trois, mobilisés si l’on compte les retours, auxquels il faut ajouter les temps de promo, de création, de clip, de réunion stratégique, etc. On s’est un peu fait dépasser, je me suis retrouvée pendant six mois à avoir un jour de pause par mois et zéro vacances. L’aspect santé mentale est important, c’est bien d’être indépendant et d’être libre, mais si tu es triste, cela ne vaut pas le coup. On apprend à dire non, mais c’est compliqué quand ce sont des propositions dont tu as toujours rêvé. On est très gourmandes et très bosseuses toutes les deux, donc on a tendance à s’oublier très vite dans le travail. C’est facile de dire « Montez un label, soyez libre », mais ce n’est pas du tout pour les flemmards de monter son label.
Avez-vous senti que cela pouvait prendre le pas sur votre créativité ou votre envie d’expression artistique ?
Z : Non. Là où j’ai eu beaucoup de chance, c’est qu’avec Lucie, au début, on parlait un peu de certains sujets, mais au bout d’un moment je n’en ai plus rien eu à faire de la thune, la comptabilité, l’administratif, etc. L’équipe m’a donné toutes les clés pour ne penser qu’à l’artistique, au live, aux clips, à la stratégie… J’ai sûrement moins écrit de chansons, j’ai très peu vu mon studio, mais chaque chose en son temps. J’ai passé quatre ans à écrire, et j’y reviendrai, donc cela ne me dérange pas du tout. Un jour, je n’avais pas d’inspiration pour un clip, en même temps je m’étais dit qu’il fallait le faire… J’avais la journée pour écrire le scénario. Cela m’a imposé une discipline qui est intéressante dans la création, parce que créer ce n’est pas juste « tac », ça vient, il faut aussi aller le chercher. Avec Lucie, on se ressemble sur plein de choses dont l’ambition. Je suis hyper ambitieuse dans le travail et, en même temps, je suis hyper simple dans la vie. J’aimerais avoir une vie très simple, mais j’ai aussi envie d’être une star internationale, c’est un peu schizophrénique. Il y a un an, on s’était dit qu’on terminerait la tournée par le Zénith de Paris et de Nantes. Mais après, il y a des festivals, une tournée de Zénith, et en 2025 une tournée internationale d’un an. On est un peu droguées au travail quand même !
L : Il y a un grand nombre de sujets, on peut ouvrir plein de tiroirs et y passer notre vie. On doit apprendre à prioriser, synthétiser, déléguer. Là, on va se frotter au travail des majors, donc on doit donner cette force de travail, sans avoir la même expérience ni les mêmes moyens. On commence seulement à générer des revenus, il faut stabiliser une économie. Ce sont des paris que l’on fait, on investit dans l’international, les clips, l’image, dans tout ce qui nous semble essentiel pour la création. On continue à prendre des risques.
Quel rapport avez-vous avec les majors ?
L : On est distribuées par Universal, par le label Virgin avec qui cela se passe très bien, ce sont de très bons distributeurs, pour le digital et pour le physique. On n’aurait jamais pu espérer une telle distribution avec un distributeur indépendant. Ils nous ont proposé une distribution améliorée, mais nous avons préféré dès le début tout internaliser chez Disparate. On a choisi les gens qu’on a recrutés.
Êtes-vous toujours avec Warner Chappell ?
Z : Oui, je parle beaucoup avec Matthieu Tessier. Matthieu, ce n’est vraiment pas qu’un éditeur, pas du tout, il fait beaucoup plus que la récolte des droits Sacem. Il a eu un rôle de directeur artistique sur l’album, il a tout réécouté, il a donné son avis sur l’arrangement, m’a beaucoup aidée sur le mix qu’on a fait avec Nk.F. Je l’appelle dès que l’on fait un clip, son avis est hyper important et on s’entend hyper bien.
Pour les tournées, vous n’avez pas essayé d’internaliser ?
L : Non, parce qu’avec Wart, cela se passe très bien depuis le début, et ils ont investi sans se poser de questions. Ils nous ont toujours envoyé les offres et les ventes en toute transparence. Ils ont toujours accepté nos demandes, parce qu’elles étaient raisonnables. C’est Zaho qui décide de son équipe de tournée, ils nous ont rendues assez autonomes sur la production. Récemment, on a contractualisé une coproduction sur la tournée, on intègre donc les réflexions sur les choix stratégiques, le timing, le budget, l’investissement, le recrutement de l’équipe, etc. Disparate est aussi coproducteur de la tournée de Zaho.
Et pour l’international ?
L : Cet aspect est travaillé par d’autres tourneurs. On a des agents par territoire.
Z : Si on devait un peu résumer, Joran est notre tourneur en France, Florian notre attaché de presse et Lola notre cheffe de projet. Ensuite, il nous faut cela dans chaque pays où l’on souhaite se développer. Le but c’est de répliquer à grande échelle le modèle qui a fonctionné en France, à savoir choisir des gens qu’on apprécie, qu’on manage, qu’on paye et qu’on pilote. On a la chance de travailler avec des structures comme Warner Chappell ou Virgin, parce que nos contrats sont pour le monde. Par exemple, en étant distribués mondialement par Virgin, on bénéficie de ces canaux dans tous les territoires que l’on veut développer.
Comment votre modèle est-il perçu autour de vous ?
L : Beaucoup de gens nous disent que c’est inspirant, que cela donne l’impression que c’est possible.
Z : Quand je parle avec d’autres artistes, je me rends compte que peu de monde fait comme nous. En nous voyant signées chez Virgin, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du boulot qu’on fait toutes seules, parce qu’on ne le montre pas non plus, on n’est pas du genre à se vendre.
L : Quand je parle à des managers et manageuses signés en contrat d’artiste dans un label, quand je vois le spectre de leur mission et que je leur demande : « Donc, tu ne t’occupes pas de cela, ni de payer la promotion ? Ah non ? Ah… » Et je réalise que je ne sais pas du tout ce que c’est qu’être manager. Moi, je suis autant manageuse que productrice, directrice du label, responsable des équipes, je ne me contente pas juste de faire le lien entre Zaho et les partenaires. Je ne sais pas où est la frontière avec le label, honnêtement. Et, à l’inverse, je ne comprends pas comment font les managers qui gèrent quinze projets. Mais on sent que cela change, et qu’un projet comme le nôtre fait aussi bouger les lignes. C’est ce que Thomas Lorain [directeur général de Virgin] nous dit beaucoup : lui, il a toujours cru à ce modèle où les artistes se structurent et sont autonomes. Et en ayant des résultats avec un projet comme le nôtre, il peut dire : « Vous voyez, c’est possible. » Cela contribue à se dire que c’est un modèle qui est viable financièrement pour les labels, pour les artistes, et pour les distributeurs. Être disque de platine en un an sur un premier disque, c’est très rare et être disque de platine en un an sur un premier disque en contrat de distribution comme on l’a fait, c’est peut-être inédit. Du moins dans notre esthétique musicale, puisque les rappeurs l’ont probablement fait 50 000 fois avant nous. Mais dans la chanson française, dans la musique électronique, dans la chanson à texte, dans les trucs un peu expérimentaux, ce n’était pas gagné d’avance de vendre 100 000 disques.
Z : Mine de rien, on a eu de la chance d’avoir les médias derrière nous, on n’a pas eu non plus un hit radio, une énorme synchro ou un buzz TikTok. On s’est quand même beaucoup développés par le live, alors que ce sont des canaux qui étaient complètement d’actualité dans les années rock, mais qui ne le sont plus trop. On a eu le buzz des pros en fait, le buzz où tout le monde parle de nous à Bourges. Et je trouve cela génial. Cela me donne beaucoup d’espoir parce qu’on aurait pu penser que les pros se disent qu’on n’avait pas besoin d’eux et, en réalité, on a été plutôt embrassées par la profession, ne serait-ce que sur les Victoires de la musique. Normalement gagner autant, c’est réservé aux artistes de gros labels. Donc merci les professionnels.
Pensez-vous que le modèle d’avenir, c’est plutôt ce que vous faites, ou que vous resterez une exception ?
Z : En vérité, tout le monde n’aura pas le courage. Mais je pense aussi que beaucoup de gens auraient le courage, mais ne savent pas encore que c’est possible. Il y en aura de plus en plus, c’est évident. Je pense qu’il y a beaucoup d’artistes qui ont besoin d’indépendance, qui auraient le courage et la gnaque, mais qui pour l’instant ne l’envisagent pas. Je suis en revanche persuadée que beaucoup n’en ont rien à faire d’être indépendants, ils n’ont pas besoin de ça pour être heureux. L’industrie musicale est traversée par des mutations constantes, que ce soit l’arrivée de l’IA, les questions de découvrabilité, les enjeux environnementaux, etc.
Est-ce que vous arrivez à intégrer cela dans vos visions stratégiques à plus long terme ?
Z : Concernant les sujets environnementaux, je prends la plupart du temps le train plutôt que l’avion. Mais, effectivement, tourner à l’international, cela signifie prendre l’avion. On a beau avoir mentionné à notre agent qu’on voulait l’éviter dès que c’était possible, mine de rien, en allant sur quatre continents différents dans l’année, on prend huit fois l’avion. J’en suis à me demander si c’est encore moderne de viser l’international, ou s’il ne faut pas juste être un peu moins gourmand et rester en France ? C’est compliqué parce j’écoute tellement de musique internationale, et je n’attends qu’une chose, c’est de voir ces artistes jouer en France.
Le fait que vous ne travailliez qu’avec des femmes a-t-il été permis par le modèle que vous avez mis en place ? Était-ce un objectif ?
L : Ce n’était pas vraiment un objectif, le fait que beaucoup de nos partenaires soient des femmes s’est fait très naturellement, c’est une suite de rencontres, de coups de cœur et d’affinités. Ce n’est pas un truc qu’on a fait de manière militante, mais cela fait partie des choses dont on est fières.
Z : Dans le label, on n’est que des femmes, en revanche sur la route c’est un autre délire : nous sommes quatorze en tout dont quatre femmes, donc en termes de diversité on n’y est pas. Je n’ai pas l’impression de voir si peu de femmes dans le monde de la musique, à part dans la technique. Sur la route, on est toujours accueillies par des mecs, c’est dommage, il faudrait rajouter des filles ce serait cool. Quand on a commencé, on ne faisait vraiment cela qu’entre copains, qu’ils soient filles ou garçons. Pour nous, la diversité c’est important, mais le plus important c’est de bosser avec des gens bien. Moi, je ne bosse qu’avec des très gentils. Après, c’est tellement une histoire de rencontres… Moi, j’ai beau avoir la gnaque, les capacités et tout ce que tu veux, si je n’avais pas rencontré Lucie, Pierre, Matthieu, je n’en serais pas là. Je sais juste que j’aime bien l’idée de bosser comme une dingue. Du coup, quand on va enfin prendre des vacances, cela va être de la folie !
Propos recueillis par Robin Charbonnier et Céline Lugué